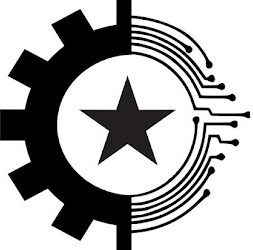Interview de Manuel Pérez Martínez (« Camarade Arenas ») après 32 ans de prison (El salto 30 mars 2025) : « Nous exigions du gouvernement qu’il reconnaisse que nous n’étions pas des terroristes »
Manuel Pérez Martínez, connu sous le nom de « camarade Arenas » dans la clandestinité, a 80 ans et vient de sortir de prison il y a à peine deux semaines. Au total, il a passé 32 années de sa vie derrière les barreaux. Né dans une famille ouvrière de Melilla, il était le troisième de treize enfants. Illettré jusqu’à l’âge de 16 ans, il a rapidement pris conscience de la réalité brutale qui frappait la classe ouvrière et a milité au sein du Parti communiste d’Espagne (PCE). Il a rompu avec la ligne défendue par Santiago Carrillo et est devenu secrétaire général du PCE reconstitué (PCEr) en 1975.
Dans cette interview, la première depuis sa libération définitive, Pérez raconte son passé militant en Espagne, sa vie clandestine en France et son extradition finale.
Vous êtes arrivé à Vallecas (Madrid) depuis Tétouan en 1956. C’est là que votre conscience politique a commencé à s’éveiller ?
J’ai travaillé dès l’âge de sept ans, d’abord dans un atelier de plombs de chasse, puis dans le bâtiment comme plâtrier, déjà à Madrid à 12 ans. Ma conscience a commencé à germer à partir du moment où j’ai vu les conditions dans lesquelles nous, les ouvriers, devions travailler et vivre. Toute ma famille vivait dans un bidonville sans électricité, ni eau, ni sanitaires. Je n’ai pas trouvé d’échappatoire dans le travail, mais dans le quartier, le Pozo del Tío Raimundo.
Vous avez connu le père Llanos ?
Sa chapelle était le seul endroit où l’on pouvait trouver un peu de « civilisation ». Nous, les gamins, on y allait, parce que les adultes étaient tellement écrasés qu’ils ne s’approchaient pas de l’église. Là-bas, j’ai rencontré ceux que je considère comme mes premiers camarades, des membres du PCE, et j’ai lu mes premiers textes marxistes qui m’ont ouvert les yeux. C’est comme ça que j’ai commencé dans le difficile métier d’être un homme.
Vous êtes même allé en prison quelques mois en 1970, accusé de propagande.
J’ai été arrêté à Carabanchel en train de distribuer des tracts, et on m’a emmené à la prison de Carabanchel. À cette époque, j’avais déjà rompu avec les carrillistes du PCE et je commençais à me rapprocher du PCE international de Catalogne. J’ai partagé une cellule avec un membre de leur comité central et j’ai vu qu’ils étaient trotskistes, alors je me suis éloigné de cette organisation.
Comment êtes-vous devenu le principal représentant au niveau national de l’Organisation des Marxistes-Léninistes d’Espagne ?
Ce collectif est né en 1968 à l’étranger et s’organisait sur une base fédérative. Lors de la cinquième réunion générale que nous avons tenue, depuis Madrid, nous avons défendu le centralisme démocratique et formé un comité directeur en 1972. À partir de là, nous avons vraiment mené un travail communiste pour la révolution. Petit à petit, nous avons compris que le régime était en crise et que la répression ne s’arrêterait pas, malgré tout le discours d’ouverture qu’ils affichaient. Il fallait donc nous préparer à ce qui allait venir. Notre idée était de reconstituer le PCE.
Le 8 juin 1975 s’est tenu le I Congrès Reconstituant. C’est de là qu’est né le PCEr, dont vous êtes également devenu le secrétaire général. Votre parti a toujours été associé aux Groupes de Résistance Antifasciste Premier Octobre (GRAPO). Y avait-il un lien ?
Nous voulions nous préparer politiquement, mais certains pensaient qu’il fallait frapper plus fort, et des volontaires se sont proposés. Moi, j’ai dit qu’il fallait écarter ces gens du parti parce que nous n’étions pas une organisation armée pratiquant la lutte par ce moyen. S’ils voulaient en découdre, qu’ils le fassent sous d’autres sigles et avec leurs propres plans.
Pourtant, le PCEr a soutenu certaines des actions armées des GRAPO.
Nous soutenions ce qui nous semblait juste sur le moment. Nous analysions la situation et nous nous positionnions en conséquence. Si un tortionnaire était abattu, nous trouvions ça très bien. Mais le PCEr n’avait ni mené cette action ni l’avait planifiée.
Ces militants du PCEr, qui étaient aussi membres des GRAPO, ont-ils rompu avec le parti à un moment donné ?
Il n’y a jamais eu de lien organique avec eux sur le plan opérationnel. Ça n’a jamais existé, et aucune preuve n’a pu l’établir.
Vous avez été arrêté le 1er octobre 1977 avec le reste de la direction du PCEr à Benidorm. Que s’est-il passé ?
La police nous est tombée dessus. Ils ont saisi les procès-verbaux de notre réunion et d’autres documents, mais n’ont rien obtenu. La presse a écrit qu’on avait arrêté la direction des GRAPO, mais ils n’ont jamais trouvé d’armes, ni de plans, ni de documents compromettants.
Lors de cette affaire, vous avez été condamné à sept ans de prison : cinq pour association illicite et deux pour détention illégale d’armes. Mais il n’y avait pas d’armes ?
J’avais un petit pistolet de calibre 22, un cadeau. C’est drôle que les journaux qui parlaient de cette saisie ne mentionnaient pas le calibre. En le voyant, ils m’ont dit : « Soit on t’inculpe toi, soit ta camarade. » J’ai dit que c’était à moi, mais c’est tout.
Vous n’avez jamais tiré avec cette arme ?
Avec celle-là, ni avec aucune autre.
Avez-vous participé à des contacts entre le gouvernement de l’époque, à partir de novembre 1982, et les GRAPO ?
À ce moment-là, il y a eu des négociations où nous exigions que le gouvernement reconnaisse que nous n’étions pas des terroristes — aucune preuve n’ayant jamais été trouvée — ainsi qu’une réparation morale. Sous ces conditions, nous nous engagions à utiliser notre influence pour convaincre les GRAPO qu’une action politique large était possible sans recours aux armes. Il y a eu d’autres pourparlers, mais c’est devenu un jeu politique qui n’a jamais abouti.
Le PCEr a-t-il été légalisé à un moment donné ?
Nous avons toujours été alégaux. Nous n’avons même jamais tenté de nous enregistrer comme parti politique. Et aujourd’hui encore, nous sommes victimes de la loi sur les partis.
Vous êtes sorti de la prison de Soria le 9 juin 1984. Qu’avez-vous fait ensuite ?
Je suis resté quelques mois à Vallecas, mais la surveillance était si étroite que j’ai dû passer à la clandestinité en France. D’abord réfugié dans les Pyrénées en plein hiver, j’ai erré dans les montagnes avant de m’installer à Paris. Je ne savais même pas parler français — par mesure de sécurité, j’évitais tout contact avec des inconnus.
Certaines informations de l’époque évoquent votre intention de vous rendre aux autorités espagnoles début 1991.
Faux. Absolument faux. C’est ce qu’ils voulaient, mais j’ai résisté en France.
Vous avez vécu 15 ans dans la clandestinité jusqu’à votre arrestation en 2000. Que faisiez-vous pendant cette période, et pourquoi vous a-t-on arrêté ?
Reconstruire le parti, car nous avions perdu nos cadres. Notre première réunion a même eu lieu en pleine montagne. Puis nous avons tenu notre 3e congrès en 1993 et le 4e en 1998.
Mon arrestation ? Juste pour une fausse carte d’identité. Condamné à 10 ans, réduits à 8 en appel, j’en ai purgé 6 avant mon extradition vers l’Espagne.
En 2009, vous avez été condamné pour l’enlèvement et la disparition de Publio Cordón, entrepreneur enlevé par les GRAPO en 1995 à Saragosse.
Un accident. On dit qu’ils le traitaient bien, comme un invité. Il a tenté de fuir par une fenêtre, est tombé du toit et s’est tué. Mort dans la rue, sur le coup.
Sa famille a payé 400 millions de pesetas, les GRAPO ont affirmé l’avoir libéré.. Connaissez-vous l’emplacement du corps ?
Je n’en sais pas plus — je n’ai jamais été des GRAPO. Et cette obsession pour ce cas est étrange : comme si en 50 ans d’histoire, le PCEr n’avait fait qu’enlever cet homme !
Pourquoi votre condamnation alors ?
Les tribunaux ont inventé la « responsabilité par omission ». Sous prétexte qu’étant secrétaire général, je contrôlais les GRAPO — ce qui est faux. Ils estiment que j’aurais pu empêcher l’enlèvement. Sept ans de prison pour ça ? Si j’avais vraiment tué quelqu’un, la peine aurait été différente. Depuis, ils utilisent cette théorie pour tout me reprocher.
En 2010, la Audiencia Nacional vous condamne à 3 ans et demi pour un attentat contre des relais de la RTVE.
Je n’ai aucun lien avec ça.
En 2011, 3 ans pour un engin explosif placé au siège du PSC à Barcelone en 2000.
Rien. Zéro. Moi, donner des ordres ? Jamais.
Fernando Silva Sande, ex-membre des GRAPO, a déclaré sous serment que vous décidiez « quoi faire, comment et quand », vous qualifiant de « responsable suprême ».
Laissez-moi vous parler de Silva : lors d’une réunion clandestine, une camarade l’a accusé de viol. On ne l’a pas exécuté — nous ne recourons pas aux armes — mais expulsé. Depuis, il collabore avec la police. Même au procès de 2012, une autre femme l’a accusé de viol. [Note : Son avocate a plaidé des relations consenties et une vengeance pour sa défection.]
Il a menti ?
Tout son témoignage était dicté par la police.
En 2012, votre plus lourde condamnation : 17 ans pour un attentat contre une agence d’intérim madrilène en 1998. C’est ce qui vous a maintenu en prison jusqu’à récemment.
Aucune preuve ne me lie à cet acte. On me punit pour un « délit d’opinion ». Refuser de se soumettre ou de se repentir, c’est ça, mon crime. Tout repose sur cette fumeuse « responsabilité par omission ».
Votre libération définitive le 5 mars dernier. Quel monde découvrez-vous ?
La situation mondiale confirme nos analyses : l’ultra-impérialisme américain, les contradictions du capitalisme qui éclatent (comme avec l’opération russe en Ukraine). L’OTAN voulait démembrer la Russie pour ses ressources, mais la bourgeoisie russe — sans être communiste — a défendu son territoire.
L’Europe marginalisée dans les négociations sur l’Ukraine accélérera le rééquilibrage des forces perdu depuis l’URSS. Poutine adopte même des mesures proches du socialisme. Le retour du socialisme en Russie est inévitable. Seules les armes nucléaires russes ont stoppé l’Occident. Trump l’a dit à Zelensky : on joue avec la 3e guerre mondiale.
Quelles sont les priorités actuelles du PCEr ?
Justement cette crise internationale. Nos thèses se vérifient : nous analysons en profondeur, car l’enjeu est colossal.
Vos dernières condamnées vous ont fait passer 25 ans en prison sans interruption. Qu’est-ce qui vous a le plus manqué pendant tout ce temps ?
Oh… [il s’émeut] Ma famille, évidemment. Je préfère ne pas trop en parler. Je n’ai jamais connu mes petits-enfants, cela résume tout. Je n’ai pas pu non plus assister aux enterrements de mes proches disparus pendant ces années. Et puis mes camarades m’ont terriblement manqué — ces frères de lutte, ma seconde famille, des êtres désintéressés et courageux.
Enfin, y a-t-il quelque chose dans votre passé que vous aborderiez différemment aujourd’hui ?
Nous avons commis beaucoup d’erreurs, surtout par subjectivisme. Nous avons mal évalué nos forces, cru que le mouvement progresserait plus vite, qu’on aurait plus de soutien. L’oligarchie a manœuvré, le révisionnisme y a collaboré. Mais tout doit se comprendre dans son contexte : nous agissions selon nos conditions d’alors. Nous étions jeunes, inexpérimentés, face à une difficulté monstrueuse — un État entier contre nous.
Et sur le plan personnel ?
Je ne suis pas un saint, j’ai sûrement fait bien des fautes… Je regrette particulièrement d’avoir empêché l’exécution de Silva après l’accusation de viol. Des camarades voulaient le châtier, je m’y suis opposé. J’ai eu tort.
Pour plus d’informations : Socorro Rojo Internacional