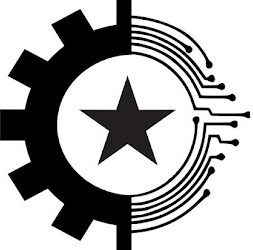Entretien avec l’écrivaine et universitaire marxiste africaine Patricia McFadden :: « Mandela a trahi la révolution pour laquelle tant de gens sont morts et pour laquelle beaucoup d’autres ont risqué leur vie ».
Patricia McFadden (Esuatini – anciennement Swaziland -, 1952) est l’une des intellectuelles les plus éminentes d’Afrique australe. Elle se décrit comme une « féministe écologiste radicale qui se trouve dans le dernier quart de sa vie et qui vit en Afrique ». Elle a enseigné à l’université Cornell (Atlanta) et à l’université de Syracuse (New York), entre autres, et a participé à des conférences et des débats dans le monde entier. Elle vit à Esuatini, dans une maison située sur la montagne Lebombo, où elle combine ses activités de penseuse et d’agricultrice.
Pouvez-vous nous décrire le contexte de l’Afrique australe et comment il a façonné votre identité politique ?
L’Afrique australe a joué un rôle crucial dans l’expérience de la résistance à la colonisation en raison de la présence du colonialisme blanc (britannique et centre-européen) et du colonialisme portugais en Angola ou au Mozambique. Nous avons été colonisés par des occupants qui ont collaboré entre eux pour maintenir la région sous leur contrôle. Ils ont partagé les mêmes rangs dans les armées, se sont soutenus mutuellement, ont tué des Africains ensemble. C’est pourquoi l’Afrique australe a une historiographie spécifique sur la manière dont les populations ont résisté à la colonisation, avec le plus grand nombre de mouvements de libération soutenus dans le temps. J’incarne ce contexte où il existe un sentiment de destin commun au-delà des frontières coloniales. Je me considère comme une personne régionale, mais mon identité est ancrée dans une notion plus large du continent africain.
Comment devons-nous comprendre les principales figures qui ont marqué les luttes anticoloniales en Afrique australe, et plus particulièrement celle de Nelson Mandela ?
Les personnages des luttes de libération en Afrique australe ont défini le caractère de ces luttes. Au Mozambique, nous avons Eduardo Mondlane et Samora Machel, qui se sont inspirés des idées marxistes radicales. En Afrique du Sud, il y a Nelson Mandela, Walter Sisulu, Govan Mbeki, Chris Hani ou Steve Biko. Mandela n’a jamais été communiste ni radical, c’était un nationaliste. Ses camarades communistes, comme Govan Mbeki, ont été écartés.
Je me souviens de Mandela déclarant lors du procès de Rivonia : « J’ai toujours nié être communiste ». Plus tard, lorsqu’il a conclu l’accord avec les colons, nous l’avons vu main dans la main avec Frederik de Klerk [dernier président raciste de l’apartheid et vice-président de Mandela]. Ce fut un moment horrible, et j’ai compris que Mandela n’était pas un intellectuel progressiste, mais un conservateur et un féodal.
Il a négocié l’installation des colons blancs. Il s’agissait de garantir l’accès à la consommation, et non aux moyens de production, de sorte que les Blancs ont conservé la propriété des terres, de la technologie et des infrastructures de production. Ils continuent de contrôler l’économie sud-africaine 32 ans après 1994. Il existe une distinction claire entre indépendance et libération.
Expliquez-nous votre participation à la lutte contre l’apartheid.
J’ai commencé dans la faction syndicale de l’ANC [African National Congress, le parti de Nelson Mandela] en tant qu’intellectuel. Mon premier article portait sur les femmes qui travaillaient dans l’industrie de l’ananas à Esuatini. J’ai été influencé par les écrits de syndicalistes communistes tels que Moses Kotane et le Malawien Clements Kadalie. Mais aussi par ceux de Govan Mbeki, auteur de « The peasant’s revolt » (« La révolte paysanne »), un texte radical sur les luttes paysannes dans la province du Cap-Oriental. J’ai découvert le marxisme et l’idée du socialisme à travers mon travail syndical.
Je me suis ensuite engagé dans la branche armée de l’ANC. J’ai transporté de nombreux jeunes du Mozambique vers l’Afrique du Sud, des hommes et des armes, pour lutter contre l’apartheid. La plupart d’entre eux ont été tués par le régime suprémaciste blanc. Mon jeune frère a été recruté par la branche armée de l’ANC et a été tué par les Boers [colons sud-africains] à l’âge de 31 ans. Ils ont appelé ma mère et lui ont dit : « Venez chercher votre chien ». Mandela a trahi la révolution pour laquelle tant de gens sont morts et pour laquelle beaucoup d’autres ont risqué leur vie. Il a vendu les rêves de tous ces jeunes. C’étaient mes camarades.
Le féminisme a été l’un des éléments clés de votre travail en tant qu’intellectuelle et militante. Comment avez-vous découvert le féminisme ?
J’étais adolescente et j’adorais les livres. Mon père m’emmenait souvent à Manzini pour faire les courses. Là-bas, il y avait une femme blanche qui vendait des livres d’occasion dans la rue. J’achetais des livres et je les lisais sur le trottoir en attendant mon père. Il y avait une bibliothèque juste à côté. Je me souviens du terrible désir que je ressentais en regardant cette bibliothèque, où seuls les Blancs pouvaient entrer.
Depuis, toute ma vie s’est déroulée entre les livres et les bibliothèques. À ce stand de livres d’occasion, j’ai acheté Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir. J’avais 15 ans et je pensais que ce livre parlait de sexe. Je n’ai pas tout compris, mais il a changé ma vie pour toujours.
Je n’ai réalisé l’impact qu’il a eu sur moi qu’après avoir divorcé de l’homme que ma mère m’avait forcée à épouser à l’âge de 20 ans. C’était un homme brutal qui m’a violée et je suis tombée enceinte. J’ai divorcé trois mois après mon mariage. J’ai dit à ma mère : « Tu peux le garder si tu veux, je ne passerai pas ma vie avec lui ». Après cela, mon féminisme s’est construit à travers le nationalisme noir, qui m’a appris la fierté noire, et les féministes blanches, qui m’ont appris à comprendre le patriarcat.
Vous avez parfois affirmé que la théorie décoloniale est patriarcale et nationaliste. Pouvez-vous développer cette idée ?
Ce que la théorie décoloniale soutient fondamentalement, c’est que nous devons revenir au passé. Elle s’appuie sur les luttes écologiques pour la survie des systèmes de connaissances et des modes de vie précoloniaux. C’est pourquoi elles utilisent l’Amazonie et ces endroits où les gens luttent pour survivre au capitalisme extractiviste. Lorsque vous lisez des auteures décoloniales qui se proclament féministes, vous constatez que, sous-jacente à leur épistémologie, se trouve cette retour à un passé patriarcal présenté comme un rempart contre la modernité et l’occidentalisme.
La théorie décoloniale est également féodale, car elle aspire au passé et à la place « authentique » des personnes noires et des femmes. Dans certaines régions, les processus de résistance n’ont pas encore atteint le stade où les gens ont développé une conscience au-delà de l’idée d’indépendance, ce qui explique que le nationalisme reste hégémonique. Mais dans des endroits comme l’Afrique du Sud, où il y avait un parti communiste, des syndicats, un prolétariat industrialisé, un accès à la littérature, au savoir et aux débats, on ne peut en aucun cas dire que l’Afrique doit revenir au passé. Nous ne sommes pas arrivés jusqu’ici pour revenir au passé.
Cela renvoie à l’un de vos concepts principaux, la « contemporanéité ». Pouvez-vous nous expliquer ce concept et son importance dans votre travail ?
Patricia McFadden
Je cherchais un moyen de m’expliquer qui je devenais dans ce contexte sud-africain, où nous étions si proches des notions de modernité induites par l’impérialisme. L’idée de modernité est un piège pour les personnes noires, cela signifie devenir une réplique des colons. Je rejetais cela, mais je ne voulais pas être le passé, j’ai toujours voulu être le futur. Lorsque j’observais le lexique féministe, je trouvais qu’il manquait des concepts qui définissaient qui je devenais en tant que personne. Je vivais déjà ici dans la montagne, établissant une nouvelle relation avec la nature, traduisant mon radicalisme en un féminisme écologique. C’est cela, la « contemporanéité ». Devenir « contemporaine », c’est laisser derrière soi le poids des cinq cents dernières années de rencontre coloniale, en tant que femmes noires vivant sur ce continent, en s’efforçant d’amener l’avenir dans le présent.
La tradition socialiste en Afrique a été ignorée, même par la gauche occidentale. Quels sont les noms et les enseignements que nous devons retenir de cette tradition ?
Nous avons connu de nombreuses expériences socialistes en Afrique. Depuis Ahmed Ben Bella en Algérie, Julius Neyrere en Tanzanie ou le Parti communiste sud-africain (SACP). Il y a eu des tentatives de révolution socialiste en Afrique, comme au Mozambique avec le FRELIMO, en Angola ou en Guinée-Bissau avec Amílcar Cabral. Mais ceux qui ont tenté leur chance ont été assassinés.
Les Africains qui aspiraient au socialisme ont été ridiculisés et éliminés : de Patrice Lumumba à Thomas Sankara et Chris Hani, et maintenant avec la tentative de la France de renverser Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. La même chose s’est produite dans les Caraïbes avec l’élimination de Maurice Bishop et de ses compagnons.
Les socialistes ont toujours été aimés sur ce continent, et cet amour est une terreur pour les élites conservatrices noires et les élites coloniales blanches. Samora Machel au Mozambique était très aimé. Thomas Sankara au Burkina Faso était très aimé. Patrice Lumumba en République démocratique du Congo était très aimé. Lorsque les Noirs embrassent le socialisme, ils font les premiers pas vers leur liberté. La littérature socialiste est fondamentale car nous devons aller au-delà du simple désir d’être libres, nous devons redéfinir qui nous voulons être.
La colonisation expose crûment le lien entre écocide et génocide. Comment expliqueriez-vous ce lien dans le contexte de l’Afrique australe ?
Le génocide est un fait historique occulté en Afrique australe. Le Cap faisait partie d’un vaste réseau visant à asservir les Africains, à les sélectionner et à les emmener de l’autre côté de l’océan. Le système esclavagiste était une activité génocidaire qui a perduré pendant 500 ans en Afrique. Il était au cœur des Lumières européennes et du capitalisme moderne. L’Europe est ce qu’elle est parce qu’elle a commencé par piller les êtres humains eux-mêmes. La colonisation nous a appris que la destruction de la vie humaine peut être un motif de progrès et a célébré l’extermination des Africains comme un élément de supériorité blanche.
L’écocide est l’expression écologique du génocide et célèbre la destruction de la nature, également comme expression de supériorité. Mais la vie humaine et toutes les multiples et belles expressions de la vie sur notre planète font partie d’un tout. Le génocide et l’écocide expriment un manque de respect absolu pour la vie et l’idée de liberté. Lumumba était l’expression personnelle des vies noires. Les agents belges l’ont jeté dans un tonneau d’acide parce qu’ils voulaient éliminer l’idée de liberté.
La colonisation a également transformé l’agriculture, la terre, l’alimentation et les régimes alimentaires. Aujourd’hui, les pratiques agricoles et les régimes alimentaires en Afrique du Sud sont profondément industrialisés et occidentalisés. Cela a un impact très négatif sur la santé, les moyens de subsistance des populations et les écosystèmes. Quel a été l’impact de la colonisation sur l’alimentation en Afrique australe ?
J’ai fait ma thèse sur l’industrie sucrière il y a 40 ans. J’ai compris que là où l’alimentation devient une marchandise et où l’agro-industrie se développe, la population noire est contrainte de quitter ses terres. La canne à sucre a entraîné l’introduction de la toxicité, des pesticides, la destruction de la biodiversité, le déplacement des populations de leurs territoires et de leurs traditions de guérison et de célébration. Les gens sont devenus des migrants forcés.
Avant, les gens se déplaçaient, mais la notion de migration est profondément enracinée dans l’agriculture capitaliste et la colonisation. Ce régime (Esuatini) a maintenu les liens coloniaux. Ils étendent les plantations de sucre pour l’exporter vers l’UE et les États-Unis au détriment de la vie du peuple swazi, qui manque de nourriture et de terres. L’alimentation est fondamentale en ce qui concerne notre identité en tant qu’êtres humains et nos liens avec les autres êtres vivants. Je me suis politisée grâce à des penseuses telles que Vandana Shiva, Bella Abzug ou Genevieve Vaughan. Elles m’ont poussée vers la prochaine étape de ma vie.
Vous vivez dans les montagnes de Lebombo, où vous cultivez votre magnifique potager biologique. Comment votre pratique agricole et votre pratique intellectuelle sont-elles liées ?
Vivre à Lebombo m’a amenée à être confrontée à l’écocide. Cela fait 20 ans que je m’assois sur ma véranda et que je vois tout le spectre de la vie se déployer devant moi : des lézards orange et violets, des oiseaux, des papillons… Tous ces animaux ont disparu. Lorsque je cultive, je nourris mon corps, mais aussi mes idées. En cultivant des aliments, j’apprends que la coexistence avec d’autres êtres vivants n’est pas un conte de fées, mais qu’elle est conflictuelle et confuse.
La résilience de la nature face à l’écocide inspire mes idées sur la manière de résister à ce stade du capitalisme. La beauté du papillon à la recherche d’une fleur me rappelle que dans la vie, les petites choses que nous trouvons sont une source de joie et sont inestimables. L’abondance de la pluie me procure beaucoup d’avocats que je donne à mes amis. Donner est un cadeau que l’on se fait à soi-même. L’arbre donne des fruits pour lui-même, pas pour vous. Vous êtes le bénéficiaire de la générosité de l’arbre. Ce sont là des leçons que j’ai apprises de la beauté et de l’immensité de la nature. C’est ce que signifie être « contemporain », vivre une vie végétalienne ici, dans cette montagne, et chercher des moyens de coexister avec les autres êtres vivants. Je resterai ici jusqu’à ce que je parte pour retourner dans la montagne.