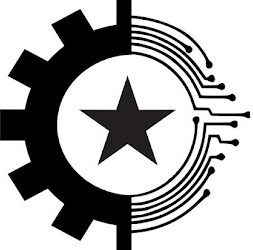Le Parti communiste marxiste du Kenya, un projet visant à créer un parti d’avant-garde capable de mener le peuple kenyan vers le socialisme
« Le chemin vers la liberté est semé de sacrifices, de larmes, de famine, de vêtements infestés de poux, de sang et de mort. »
― Dedan Kimathi
« On ne grimpe pas à un arbre par le sommet. »
— Proverbe africain
La nécessité du parti
Dans la tradition marxiste, le parti d’avant-garde est un vecteur indispensable dans la lutte pour la libération. Dans un monde structuré par l’impérialisme, la démocratie est sévèrement limitée, en particulier dans la périphérie mondiale. Elle sert principalement les intérêts des puissances impériales et des élites nationales qui travaillent pour leur compte. Ces relations sociales déterminent non seulement la vie quotidienne de milliards de personnes, mais maintiennent également une emprise étroite sur les sphères de la politique, de la culture, de l’éducation et de l’information. Dans la plupart des cas, les élections offrent un choix entre des partis politiques qui, à divers égards, s’engagent tous à préserver le capitalisme. Dans ce contexte, les travailleurs, les paysans et les pauvres des villes sont contraints de s’aligner sur les horizons politiques établis par leurs oppresseurs, qui ne remettent pas fondamentalement en cause les relations sociales imposées par le capitalisme et l’impérialisme. C’est pourquoi les opprimés ont besoin d’un véhicule politique capable de les représenter en tant que classe. C’est le rôle du parti révolutionnaire, qui cherche à développer, à faire progresser et à porter les aspirations des travailleurs et des opprimés sur la voie du socialisme.
Pourquoi un parti révolutionnaire est-il nécessaire ? Dans Le Manifeste communiste, Karl Marx et Friedrich Engels ont écrit que le capitalisme « crée ses propres fossoyeurs ».1 La concentration du capital entre les mains d’une seule classe crée également une classe ouvrière, qui est la créatrice de toute la richesse de la société. Cette classe, comme l’ont montré Marx et Engels, peut s’emparer des moyens de production et réorienter les profits vers l’amélioration de la vie humaine. Mais ce processus ne se produit pas spontanément. Au départ, les travailleurs subissent leur exploitation individuellement plutôt que collectivement, et l’idéologie de la classe dirigeante imprègne la société, rendant difficile toute organisation collective. Le parti révolutionnaire sert de vecteur pour surmonter ces limites, en concentrant l’expérience de la classe ouvrière, en engageant, développant et partageant la théorie révolutionnaire, et en fournissant une orientation stratégique à la lutte des classes.
La révolution d’octobre 1917 a servi de terrain d’essai. Vladimir Lénine a montré que la classe ouvrière, limitée à l’activisme syndical, qui avait tendance à se concentrer étroitement sur les questions de salaires et d’heures de travail, ne développait pas d’elle-même des revendications plus larges en matière de représentation politique. Elle n’était pas consciente de sa capacité à gouverner un État tout entier. Il fallait un parti de révolutionnaires professionnels pour introduire la conscience socialiste dans le mouvement ouvrier, l’aider à s’organiser et l’aider à réaliser sa mission de prise du pouvoir d’État. De cette manière, le parti révolutionnaire devient l’expression concentrée de la conscience de classe, l’institution qui transforme la classe ouvrière d’une « classe en soi » (une catégorie économique objective) en une « classe pour soi » (un acteur politique conscient et un agent de l’histoire). Cette mission ne peut être accomplie par une ONG, un club de débat ou un véhicule électoral creux. Elle exige un parti ancré dans l’expérience historique, enraciné dans le peuple et renforcé par la théorie.
Aujourd’hui, dans une grande partie de la périphérie mondiale, les rangs des opprimés comprennent également une importante population rurale et, de plus en plus, un nombre croissant de personnes qui sont totalement exclues du marché du travail. Partout dans le monde, on assiste à un exode historique des travailleurs ruraux vers les villes, causé par des facteurs tels que l’accaparement des terres et le changement climatique. Ces populations sont contraintes de s’installer dans des bidonvilles urbains en pleine expansion, où elles tombent dans des emplois informels ou précaires, ou n’ont aucune perspective d’emploi. Sur le continent africain, environ 40 % de la population se trouve aujourd’hui dans cette situation, pour laquelle un changement politique révolutionnaire est une nécessité existentielle.2 Dans ce contexte, le rôle du parti d’avant-garde dans l’unification des opprimés et la transformation de leur résistance souvent spontanée en action révolutionnaire consciente devient essentiel.
Le Parti communiste marxiste du Kenya (CPMK) est une initiative contemporaine visant à construire une telle organisation, un parti d’avant-garde des travailleurs, des pauvres des villes et des paysans du Kenya, qui vise à jouer un rôle de premier plan dans la lutte actuelle contre le capitalisme, le néocolonialisme et l’impérialisme. Son expérience révèle non seulement la vitalité continue de la pensée marxiste révolutionnaire, mais aussi les façons dont le marxisme est appliqué aux conditions particulières du Kenya contemporain.
De la colonie à la néocolonie : le parcours du Kenya sous l’impérialisme
Le CPMK est né dans le contexte d’une lutte prolongée contre la domination coloniale et la subversion impériale, c’est-à-dire l’affaiblissement ouvert, puis dissimulé, de la souveraineté nationale. Le colonialisme britannique, établi à la fin du XIXe siècle, s’est approprié les meilleures terres et ressources naturelles au profit des colons blancs et de la puissance coloniale. Grâce à des instruments juridiques tels que l’ordonnance de 1902 sur les terres de la Couronne, l’Empire britannique a déclaré que toutes les terres « inoccupées » étaient la propriété de la Couronne, criminalisant ainsi les formes africaines de propriété foncière et dépossédant des millions de personnes de leurs territoires ancestraux. Les terres les plus fertiles, les tristement célèbres « White Highlands », étaient réservées exclusivement aux colons européens, tandis que la majorité africaine était parquée dans des réserves indigènes ou réduite à squatter ses propres terres. Pour contraindre les Africains à travailler comme salariés dans les fermes des colons et dans les industries naissantes, l’administration coloniale a imposé des taxes sur les huttes et des impôts par tête, mis en place des couvre-feux pour contrôler les déplacements et cherché à écraser la résistance par des châtiments corporels et des exécutions.
La résistance à la domination coloniale s’est manifestée très tôt, avec diverses formes de révoltes spontanées qui ont éclaté parallèlement à des mouvements organisés en faveur de la libération nationale. La Kikuyu Central Association, fondée en 1924, et la Kenya African Union, créée en 1944, ont été les premières tentatives d’organisation politique contre la domination coloniale. L’administration coloniale a réagi par une répression accrue, interdisant les organisations politiques africaines et arrêtant leurs dirigeants.
La lutte pour la libération nationale a atteint son apogée avec le soulèvement des Mau Mau dans les années 1950, un mouvement paysan révolutionnaire qui a pris les armes contre l’occupation britannique. La rébellion, menée par l’Armée de la terre et de la liberté du Kenya, s’est organisée sous le slogan Gĩthaka na Wĩtĩkio ! — Terre et liberté ! — qui reflétait la réalité de la vie de millions de Kenyans confrontés à l’aliénation de leurs terres, à l’exploitation économique et à l’exclusion politique. La rébellion a ébranlé le régime colonial dans ses fondements. La réponse britannique a été brutale. Plus de 1,5 million de personnes — principalement issues de la communauté Kikuyu — ont été envoyées de force dans des camps de concentration. Des milliers d’entre elles ont été torturées, exécutées ou soumises à des travaux forcés et à des conditions inhumaines. Des communautés entières ont été déracinées et les punitions collectives sont devenues monnaie courante. Ce qui a été présenté comme une contre-insurrection était en réalité une campagne de terreur visant à écraser la résistance et à réaffirmer le contrôle colonial. Les chiffres officiels font état d’environ 11 000 combattants Mau Mau tués, mais le nombre réel de Kenyans morts à la suite des violences britanniques est nettement plus élevé.
Alors que la lutte armée s’intensifiait, la Grande-Bretagne a changé de stratégie, passant de la répression directe à l’orchestration d’une transition du pouvoir qui, sous le couvert d’une libération formelle, préserverait ses intérêts économiques. Cela a conduit à la « fausse indépendance » de 1963, un moment qui n’a pas démantelé l’État colonial, mais a transformé les mécanismes par lesquels il exerçait son pouvoir. Lors de conférences à Lancaster House, dont l’aile radicale de la lutte anticoloniale était exclue, la Grande-Bretagne a remis les rênes du pouvoir à une bourgeoisie compradore loyale, une classe qui, grâce à son propre enrichissement, allait maintenir la logique économique du colonialisme sans ses attributs politiques officiels. Cette nouvelle élite a accepté un arrangement néocolonial qui laissait intacts les intérêts commerciaux, la propriété foncière et l’influence militaire britanniques. Il en a résulté la naissance d’un État néocolonial, une façade noire pour un contrôle blanc permanent. Comme le note le manifeste du CPMK :
« À l’exception de quelques réformes limitées, les gouvernements qui ont succédé au colonialisme ont maintenu le système qui recycle les problèmes contre lesquels notre peuple s’est battu. Ceux dont les terres ont été confisquées de force par les colons sont toujours sans terre… Des conditions de travail proches de l’esclavage persistent dans les plantations étrangères et locales qui versent des salaires de misère à une main-d’œuvre mal organisée. »
L’ère post-indépendance sous Jomo Kenyatta a consolidé l’ordre néocolonial au Kenya. Des radicaux comme Pio Gama Pinto, un marxiste engagé dans la libération panafricaine, ont été assassinés, tandis que l’Union populaire du Kenya (KPU), un parti de gauche qui appelait à une transformation plus profonde, a été interdite en 1969. Dans les années qui ont suivi, les écrivains et les intellectuels qui se sont ralliés à la lutte des paysans et des travailleurs ont également été pris pour cible, notamment Ngũgĩ wa Thiong’o, qui a été détenu sans procès en 1977 après avoir mis en scène une pièce radicale en gikuyu avec une troupe de théâtre communautaire.
Lorsque Daniel arap Moi a pris la présidence en 1978, le Kenya est tombé dans une dictature à parti unique caractérisée par une répression sévère, une torture généralisée, notamment dans la tristement célèbre Nyayo House, et l’imposition de programmes d’ajustement structurel par le FMI et la Banque mondiale, qui ont privatisé les actifs de l’État, aggravant les inégalités et sapant les dispositions sociales déjà faibles qui existaient dans le pays.
La réintroduction du multipartisme dans les années 1990 s’est avérée être une illusion. Les élites ont réussi à se reconfigurer en une série de factions rivales au sein de la même classe compradore. Du KANU et du NARC au Jubilee et au Kenya Kwanza, elles ont utilisé les partis politiques nouvellement créés pour se disputer le contrôle de l’appareil d’État, souvent en mobilisant délibérément les identités ethniques, ce qui a servi à masquer les divisions matérielles et à consolider le pouvoir des élites. Même la célèbre Constitution de 2010, bien qu’elle contienne des réformes progressistes, reste fondamentalement capitaliste dans son orientation. « La vérité est que les valeurs nationales décrites par la Constitution », déclare le CPMK, « ne peuvent être réalisées sous le capitalisme, mais seulement sous le socialisme ».
Souveraineté nationale et lutte en deux étapes
Pour briser le cycle de la domination néocoloniale, le CPMK a tracé une voie révolutionnaire fondée sur l’application de la théorie marxiste-léniniste aux conditions spécifiques du Kenya. Cette stratégie rejette la voie du réformisme. L’État néocolonial, forgé pour maintenir la subordination du Kenya à l’empire, ne peut être réparé. Il doit être renversé et reconfiguré pour servir les travailleurs, les paysans et la masse croissante de personnes vivant et travaillant de manière informelle dans les villes. Le cœur théorique de cette stratégie est la théorie de la révolution en deux étapes, qui affirme que dans une société semi-féodale et néocoloniale comme le Kenya, la lutte doit passer par deux phases distinctes mais dialectiquement liées.
La première étape, immédiate, est la révolution démocratique nationale (RDN). Il s’agit d’une étape révolutionnaire-démocratique dont l’objectif principal est la destruction complète du néocolonialisme et de ses piliers nationaux. Ses tâches consistent notamment à écraser la classe des propriétaires terriens afin de rendre « la terre à ceux qui la travaillent », à mettre fin à la domination impérialiste en expulsant les forces militaires étrangères et en se libérant du contrôle financier du FMI et de la Banque mondiale, et à abolir l’appareil d’État néocolonial pour le remplacer par des organes du pouvoir populaire. Le parti soutient que sauter cette étape revient à ignorer les réalités matérielles du Kenya : la question foncière non résolue, la vaste paysannerie en tant que force révolutionnaire et le pouvoir bien établi d’une classe compradore au service du capital étranger.
La lutte pour la reconquête de la souveraineté nationale est au cœur de la NDR. Le CPMK définit la souveraineté non pas comme une expression juridique ou un drapeau à l’ONU, mais comme la capacité matérielle d’un peuple à contrôler ses propres terres, sa main-d’œuvre, ses ressources et son destin. La souveraineté du Kenya a été trahie par la classe compradore lors de l’indépendance et continue d’être bradée par le biais de la dette, d’accords commerciaux inégaux et de pactes militaires. La reconquête de la souveraineté est donc une condition stratégique préalable à l’engagement sur la voie de la construction socialiste. Sans contrôle sur l’économie, les ressources et l’État, toute tentative de construire le socialisme serait freinée par les puissances étrangères.
La deuxième phase de la lutte révolutionnaire est la révolution socialiste. Cette phase implique la socialisation des moyens de production, l’établissement d’une dictature du prolétariat pour défendre la révolution contre les ennemis externes et internes, et la transformation complète de la société pour éliminer la pauvreté, les inégalités et toutes les formes d’oppression.
Ce cadre en deux étapes se reflète dans le programme politique du CPMK. Le programme maximal du parti représente les objectifs ultimes du socialisme et du communisme. Son programme minimal consiste en les tâches révolutionnaires-démocratiques de la NDR — il ne s’agit pas de revendications réformistes et social-démocrates, mais d’aspirations claires nécessaires pour avancer à travers les deux étapes du processus révolutionnaire. Cette distinction est au cœur de la théorie du changement du CPMK et reflète sa relation avec le pouvoir électoral. Si le parti peut participer tactiquement aux élections, son objectif stratégique n’est pas de remporter des sièges au sein de l’État néocolonial, mais d’utiliser le processus électoral pour construire le pouvoir organisé des masses.
Genèse et rectification : forger l’avant-garde
Le CPMK n’est pas apparu ex nihilo. Il est issu de ce qu’il appelle « le long fil du communisme kenyan », une tradition révolutionnaire enracinée dans la résistance anticoloniale et contrainte à la clandestinité pendant des décennies. Cette lignée remonte à l’aile radicale et proto-révolutionnaire du Mau Mau, qui terrifiait à la fois le capital colonial et le cœur impérial avec ses revendications de redistribution des terres et d’anti-impérialisme. Cette étincelle a été reprise par des figures telles que Bildad Kaggia, nationaliste radical, Pio Gama Pinto, martyr marxiste, et Oginga Odinga, qui dirigeait le KPU, parti de gauche. Après l’assassinat de Pinto et l’interdiction du KPU, l’organisation de gauche a été brutalement réprimée, ne survivant que dans des formations clandestines telles que le Mouvement du 12 décembre et les cercles d’étude socialistes qui ont défié la dictature de Moi au prix de lourdes pertes.
Le parti dans sa forme actuelle est issu du Parti social-démocrate du Kenya (SDP), qui s’est formé après la réintroduction du multipartisme dans les années 1990. Pendant des années, l’étiquette « social-démocrate » a été une concession pragmatique à un environnement politique imprégné d’anticommunisme. Mais en 2019, le noyau gauche du parti a estimé que les conditions étaient réunies pour une rupture décisive avec le réformisme. Lors de son troisième congrès national, le parti s’est officiellement transformé en Parti communiste du Kenya (CPK). Cela a marqué une rupture définitive avec les contraintes de la politique et des idées social-démocrates.
La réaction de l’État a été rapide. Le registraire des partis politiques a refusé d’enregistrer le nouveau nom, affirmant que le Kenya « ne peut pas autoriser les partis socialistes/communistes ». Le parti a riposté par des actions en justice et une mobilisation publique, remportant en avril 2019 une victoire judiciaire historique qui a confirmé son droit d’exister et créé un précédent pour le pluralisme idéologique au Kenya. Le changement de nom qui a suivi, en Parti communiste marxiste – Kenya (CPMK), a constitué une consolidation idéologique supplémentaire, affirmant son ancrage dans le marxisme-léninisme et son application aux conditions kenyanes, et répondant à une crise au sein de ses rangs.
Lors des élections de 2022, deux hauts responsables du parti, Mwandawiro Mghanga et Benedict Wachira – appelés « le gang des deux » dans les documents internes – ont trahi la position officielle de non-alignement du parti et ont déclaré unilatéralement leur soutien à la coalition bourgeoise Kenya Kwanza. La majorité du parti a rejeté cet acte de « collaboration de classe » et s’est engagée dans un vaste processus d’introspection et de rectification afin de garantir une plus grande discipline et une meilleure cohérence au sein de ses rangs. La crise a mis en évidence les faiblesses organisationnelles héritées du CPK, qui a développé une base militante massive en luttant contre l’interdiction de son enregistrement et a établi ce qu’il appelle une « fondation compromise » avec une direction qui comptait de plus en plus d’éléments bourgeois dans ses rangs. La scission de 2022 et le changement de nom du parti ont contribué à consolider le CPMK autour d’un bloc d’avant-garde discipliné, dont la détermination a été mise à l’épreuve par les contradictions de la lutte des classes interne.
Les outils de la révolution : organisation, discipline et ligne de masse
En tant que parti d’avant-garde, le CPMK a cinq tâches principales. Il développe la conscience des cadres par l’éducation marxiste-léniniste, afin que chaque membre du parti devienne un penseur, un organisateur et un agitateur. Il s’organise en créant des cellules dans les usines, les écoles, les fermes, les universités, les quartiers informels et les communautés de la diaspora. Il agite, en appliquant la ligne politique à chaque lutte de masse, qu’il s’agisse du logement, de la faim, de l’oppression des femmes ou du manque de terres. Il unit, en construisant un front commun des forces progressistes, sans diluer le leadership de la classe ouvrière dans le mouvement. Et il se prépare à des crises plus profondes, à une répression plus forte et à une future insurrection.
La force du parti d’avant-garde est donc déterminée non seulement par son idéologie et sa ligne politique, mais aussi par son organisation révolutionnaire, qui doit être capable d’institutionnaliser et de systématiser le pouvoir collectif des travailleurs, des pauvres des villes et des paysans, transformant ainsi la théorie en force matérielle. Le principe organisationnel fondamental du parti est le centralisme démocratique, une tradition clé dans l’histoire des partis révolutionnaires. Il repose sur quatre piliers : la démocratie dans la discussion, qui permet un débat interne complet ; le centralisme dans l’action, qui exige de tous les membres qu’ils respectent une décision une fois qu’elle a été prise ; la minorité obéissant à la majorité ; et les organes inférieurs du parti obéissant aux organes supérieurs. Cette structure vise à permettre à la fois une véritable démocratie interne, qui peut tirer parti des connaissances et de la sagesse collectives du parti, et une action unifiée. Le système est conçu pour empêcher le parti d’être paralysé par les factions.
Le pont entre le parti et le peuple est connu sous le nom de ligne de masse, une méthode de direction tirée des processus élaborés par Mao Zedong au cours de la révolution chinoise. L’idée et la pratique de la ligne de masse reflètent un processus dialectique continu qui consiste à étudier les opinions diffuses et non systématiques du peuple, à les systématiser en une ligne politique claire et à revenir vers le peuple avec une ligne capable de l’unifier et de le diriger dans une lutte politique organisée. Le processus de formulation d’une ligne de masse est une caractéristique centrale de la démocratie socialiste. Il garantit que la direction du parti est ancrée dans la réalité concrète des opprimés, empêche la bureaucratisation des cadres du parti et veille à ce que les besoins du peuple guident les actions et les théories de la lutte au sens large.
Afin d’institutionnaliser son travail, le CPMK a développé des branches organisationnelles spécifiques. L’École idéologique Pio Gama Pinto (PGPIS) sert de « creuset de l’éducation marxiste » et de « quartier général théorique de la révolution ». Elle est chargée de former les cadres au marxisme-léninisme, de développer du matériel éducatif bilingue en anglais et en kiswahili, et d’apporter une clarté théorique au mouvement. Le parti a également créé des organisations de masse pour mener des luttes sur des fronts spécifiques. Il s’agit notamment de la Ligue révolutionnaire des femmes (RWL) et de la Ligue révolutionnaire de la jeunesse (RYL). Ces ligues fonctionnent avec une relative autonomie sous la direction politique du parti, chargées de mobiliser leurs électorats respectifs et de former de nouvelles générations de dirigeants.
L’objectif de toute cette structure est le développement des cadres. Le parti vise à former des « guerriers-érudits », des militants engagés qui ont des bases théoriques solides, sont ancrés dans les masses et endurcis par la discipline révolutionnaire. Cet objectif est atteint grâce à une combinaison d’études théoriques au PGPIS et d’application pratique dans le feu de la lutte des classes, un processus qui vise à élever la conscience du spontané vers l’organisé. Cette institutionnalisation marque une évolution cruciale, passant d’un réseau informel de militants à une organisation mature dotée des structures nécessaires pour soutenir et développer une lutte prolongée.
Le large front de lutte : unir les opprimés
À elle seule, la classe ouvrière ne peut progresser dans la lutte pour la NDR. Elle a besoin d’une alliance stratégique plus large entre les forces progressistes de toutes les classes et de toutes les couches sociales, capables de lutter ensemble contre les principaux ennemis de l’État : l’impérialisme, la classe compradore et les propriétaires fonciers. Dans la tradition maoïste, le CPMK appelle cela le Front uni. Au cœur de cette coalition se trouve « l’alliance fondamentale » entre la classe ouvrière, les pauvres des villes et les paysans — les classes les plus exploitées du Kenya, dont la force combinée constitue l’épine dorsale de la révolution. Le rôle du parti est d’assurer la direction idéologique et politique de ce front, en veillant à ce qu’il ne se transforme pas en un bloc populiste mûr pour être manipulé par les intérêts de la classe dirigeante.
S’appuyant sur une analyse de la structure de classe du Kenya, le CPMK intègre d’autres questions sociales dans sa lutte. Selon le parti, celles-ci sont des expressions intégrantes de la lutte des classes dans le contexte néocolonial du Kenya. Sur la question du genre, par exemple, le parti rompt avec les cadres féministes libéraux impulsés par les ONG et avance une position de « féminisme prolétarien ». Les femmes de la classe ouvrière et paysanne kenyane sont confrontées à une « triple oppression » : en tant que membres d’une classe exploitée, en tant que femmes soumises au patriarcat et en tant que sujets d’une nation néocoloniale. Le RWL a pour mission de mener cette lutte, en se battant pour tout, des droits fonciers et l’égalité salariale à la fin de la violence contre les femmes, tout en reliant ces questions à la lutte révolutionnaire contre l’impérialisme et pour le socialisme.
En ce qui concerne les droits des LGBTQ+, le CPMK lutte contre l’oppression subie par ses camarades LGBTQ+, qu’il reconnaît comme étant le produit des lois de l’époque coloniale, du fondamentalisme religieux et des traditions patriarcales qui continuent de peser sur la culture et la société kenyanes. Le CPMK rejette la politique du sectarisme. Dans le même temps, il reste critique à l’égard de la « politique identitaire » libérale, qui fragmente l’unité de classe, et du « capitalisme arc-en-ciel » promu par les ONG impérialistes, qui marchandise l’identité tout en laissant intacts les systèmes d’exploitation. En d’autres termes, le parti cherche à intégrer la lutte pour la libération sexuelle et de genre dans un cadre marxiste-léniniste, en évitant les pièges du rejet dogmatique et de la cooptation libérale.
Le CPMK considère la crise écologique comme une composante indissociable d’une « guerre des classes » plus large et comme un produit direct de l’accumulation impérialiste. L’impérialisme est responsable de plus de 80 % des émissions historiques de CO2, et pourtant, ceux qui subissent le plus durement les conséquences de cette crise sont les paysans africains, et non les propriétaires terriens européens ; les pêcheurs de Lamu et du lac Victoria, et non les dirigeants de Wall Street ; et les pauvres des bidonvilles de Mathare et Kibera, et non les milliardaires de Davos. Le parti rejette le greenwashing du capitalisme et les fausses solutions telles que les marchés du carbone, qu’il qualifie d’« impérialisme vert », une nouvelle forme de contrôle colonial. Il prône plutôt une « écologie populaire », une lutte ancrée dans la ligne de masse qui relie la lutte pour la justice environnementale à la révolution agraire, à la souveraineté alimentaire et à l’anti-impérialisme, exigeant des réparations écologiques de la part des puissances impérialistes.
Enfin, le parti maintient un engagement fort en faveur de l’internationalisme et du panafricanisme révolutionnaire. Il rejette le panafricanisme inefficace et dirigé par les compradores d’institutions telles que l’Union africaine, appelant plutôt à une unité continentale fondée sur la lutte pour le socialisme et contre l’impérialisme. Les courants progressistes de la diaspora kenyane sont considérés comme un détachement stratégique de la révolution, chargé de l’éducation politique, de l’organisation et de la construction de la solidarité. Ce travail international est coordonné par un département international dédié du Comité central d’organisation (IDCOC), qui forge des liens avec les mouvements révolutionnaires du monde entier, de la Palestine et des Philippines à Cuba et au Venezuela.
Vers la victoire
L’histoire de la lutte révolutionnaire africaine a été marquée par de graves trahisons et défaites. Les dirigeants qui ont cherché à développer des stratégies de souveraineté nationale — de Pio Gama Pinto à Thomas Sankara, de Patrice Lumumba à Mouammar Kadhafi — ont été destitués et exécutés par les puissances occidentales, de mèche avec les élites compradores nationales. Chacune de leurs luttes s’appuyait sur des organisations de masse qui cherchaient à unir le peuple dans une lutte commune pour la libération et le socialisme. À travers le continent, cette lutte a subi un revers lorsque les dogmes néolibéraux se sont enracinés et que les ONG ont démobilisé le peuple, transformant les questions de libération en appels à la réforme.
Mais la lutte doit continuer. L’Afrique reste le continent le plus exploité de la planète. Ses ressources sont pillées. Sa main-d’œuvre est sous-évaluée au point d’être systématiquement détruite. Ses terres sont volées. Les dettes imposées à ses nations paralysent leur capacité à gouverner. Ses nations sont occupées par des armées étrangères qui agissent comme garantes des intérêts impérialistes. Les ONG, les médias et les projets universitaires financés par l’Occident exercent un pouvoir considérable dans les pays du continent. En conséquence, la vie des Africains est tragiquement écourtée, une crise que le changement climatique et la dévastation de l’environnement menacent de généraliser.
Le CPMK s’inscrit donc dans une longue tradition historique qui reconnaît que la transformation révolutionnaire du Kenya – et des nations au-delà – est à la fois une condition préalable à la survie et le résultat nécessaire des profondes contradictions entre les opprimés et leurs oppresseurs. Le parti évolue dans le sens de l’histoire, s’appuyant sur les succès et les échecs du passé pour s’implanter dans chaque lieu de travail, chaque village rural et chaque agglomération urbaine, renforçant l’organisation et la conscience des masses afin de permettre leur victoire finale.
Communist Party Marxist – Kenya
Références
01
Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du Parti communiste, trad. Samuel Moore (1888 ; rééd., Londres : Penguin Classics, 2002),
02
Paris Yeros, « The Fifth Great Power and Polycentrism in the 21st Century », Agrarian South: Journal of Political Economy 13, n° 1 (2024) : 6-32.