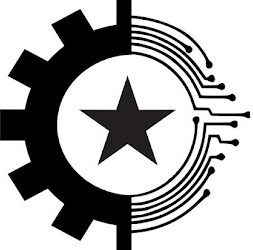Comuna o Nada : la question du pouvoir à l’ère de la guerre impérialiste
Camarades, le slogan « Comuna o Nada » — la commune ou rien — n’est pas seulement une proclamation vénézuélienne ; c’est un cri universel du prolétariat à notre époque de crise. Il affirme que sans transformer les rapports de production, sans déraciner la domination impérialiste et sans transférer le pouvoir des classes exploiteuses aux travailleurs, il ne peut y avoir de socialisme.
Aujourd’hui, l’humanité vit sous la menace d’une nouvelle guerre mondiale impérialiste — une guerre qui n’a pas encore été déclarée, mais qui fait déjà rage. De la Palestine au Donbass, du Sahel aux Caraïbes, du bassin du Congo à la mer de Chine méridionale, l’impérialisme cherche à préserver un ordre moribond par la violence, les blocus et le fascisme. Les États-Unis, l’OTAN et leurs alliés compradores ont transformé des continents entiers en champs de bataille pour maintenir les profits du capital monopolistique.
Pourtant, au milieu de cette tempête, un nouveau monde est en train de naître. La révolution bolivarienne au Venezuela, qui résiste fermement à l’agression impérialiste, continue d’éclairer la voie du pouvoir populaire. Lorsque le président Hugo Chávez, dans son historique Golpe de Timón du 20 octobre 2012, a déclaré « Comuna o nada ! », il ne s’agissait pas d’un appel rhétorique, mais d’une définition de la question stratégique de la révolution : comment construire le socialisme non pas par le haut, mais par le bas ; non pas par des décrets, mais par le pouvoir organisé des masses.
La commune, dans son expression vénézuélienne, perpétue l’esprit de la Commune de Paris, des Soviets de 1917, des communes populaires chinoises et des traditions africaines de production collective et de solidarité communautaire que l’impérialisme a cherché à détruire. Elle est l’embryon du nouvel État, la forme du pouvoir prolétarien qui fusionne l’autorité politique avec la production sociale, l’administration et la défense.
Pour le Parti communiste marxiste du Kenya (CPMK), Comuna o Nada n’est pas seulement un slogan vénézuélien, c’est une nécessité historique pour toutes les sociétés néocoloniales prises au piège dans le cercle vicieux de la dépendance, du sous-développement et de la trahison des compradores. Au Kenya, comme dans une grande partie de l’Afrique, l’indépendance politique des années 1960 a masqué une asservissement économique et structurel plus profond. Les classes capitalistes compradores et bureaucratiques ont remplacé les colons comme agents locaux du capital impérialiste. La question du pouvoir reste donc sans réponse.
Notre révolution doit donc répondre à la même question que Chávez a posée et que Marx a résolue dans les flammes de la Commune de Paris : qui gouverne ? Entre les mains de qui se trouve le pouvoir ? La commune, dans nos conditions, devient l’organe révolutionnaire par lequel les travailleurs, les paysans et les pauvres exercent leur autorité collective — politiquement, économiquement et idéologiquement.
En participant à cette conférence, le CPMK affirme sa solidarité indéfectible avec la révolution bolivarienne, avec la classe ouvrière vénézuélienne et avec toutes les forces anti-impérialistes qui résistent au nouvel ordre fasciste du capital. Notre document vise à contribuer à l’avancée théorique collective du mouvement mondial en ancrant les principes de Comuna o Nada, de l’anti-impérialisme et de l’antifascisme dans les conditions matérielles de l’Afrique semi-féodale et néocoloniale.
Il proclame que la révolution africaine ne triomphera que lorsque les travailleurs prendront le pouvoir par le biais de leurs propres organes : les communes, les assemblées populaires et les comités révolutionnaires.
Les racines historiques de la domination néocoloniale au Kenya
« L’impérialisme laisse derrière lui des germes de pourriture que nous devons éliminer cliniquement de notre sol si nous voulons que notre indépendance soit réelle. »
— Amílcar Cabral
Toute révolution doit d’abord affronter sa propre histoire. Pour le Kenya, la crise actuelle de dépendance, de pauvreté et de domination compradore ne peut être comprise en dehors du long arc de la domination coloniale et néocoloniale. La chaîne qui lie aujourd’hui les travailleurs kenyans a été forgée dans les fourneaux du colonialisme britannique et ensuite remodelée par l’impérialisme à travers des agents locaux : les classes capitalistes compradores et bureaucratiques.
De la conquête coloniale au capitalisme colonial
L’impérialisme britannique s’est emparé du Kenya non pas pour le civiliser, mais pour s’approprier ses terres, sa main-d’œuvre et ses profits. À l’aube du XXe siècle, de vastes étendues de terres fertiles dans les White Highlands ont été expropriées par une poignée de colons. L’État colonial est devenu le gendarme armé de cette expropriation, fondée sur le travail forcé, les impôts sur les huttes et les têtes, et les baïonnettes des King’s African Rifles. Les paysans ont été déracinés et prolétarisés, contraints de servir de main-d’œuvre bon marché dans les plantations des colons, les chemins de fer et les villes coloniales émergentes.
L’économie coloniale n’a jamais été conçue pour le développement du Kenya, mais pour l’enrichissement du capital financier britannique. Chaque ligne de chemin de fer menait au port, chaque plantation produisait pour les marchés londoniens, chaque décret administratif garantissait la suprématie des profits impériaux sur le bien-être des autochtones. C’est dans cette fournaise d’oppression que les premières braises de la résistance se sont allumées, depuis les soulèvements des squatters dans les années 1920 jusqu’à la guerre révolutionnaire des Mau Mau pour la terre et la liberté dans les années 1950.
La trahison de l’indépendance
La cérémonie de lever du drapeau de 1963 n’a pas mis fin à la domination coloniale, elle en a simplement changé la couleur. Le drapeau des colons a été abaissé, mais la domination impérialiste a persisté à travers le contrôle économique, militaire et politique. Les élites compradores et bureaucrates du Kenya ont hérité intact de l’État colonial et en sont devenues les nouveaux administrateurs. La constitution dite « d’indépendance » protégeait la propriété privée et les capitaux étrangers, garantissant ainsi à l’impérialisme le contrôle de l’économie du pays par le biais des banques, de l’agro-industrie et des multinationales.
Cette trahison n’était pas accidentelle, elle était structurelle. L’impérialisme a restructuré sa domination par le néocolonialisme, comme Lénine l’avait prévu dans son analyse du capital financier. L’impérialisme britannique, puis américain, est passé d’une domination directe à un contrôle indirect par le biais de prêts, d’accords commerciaux et d’« aide au développement ». Les anciens gouverneurs coloniaux ont été remplacés par des présidents formés à l’idéologie du nationalisme bourgeois, des hommes qui portaient la peau africaine mais avaient l’esprit étranger.
La classe compradore est née de cette trahison. C’est la classe qui vit en jouant le rôle de médiateur entre l’impérialisme et l’économie nationale, s’enrichissant grâce aux commissions, aux appels d’offres et aux contrats, tout en étranglant les forces productives de la nation. À ses côtés se trouve la classe capitaliste bureaucratique, ceux qui utilisent l’appareil d’État pour s’enrichir personnellement, piller les ressources publiques et réprimer les masses. Ensemble, ils forment les deux piliers de la domination néocoloniale.
La structure de la dépendance néocoloniale
Au cours des décennies qui ont suivi, l’impérialisme a perfectionné son emprise sur le Kenya grâce aux mécanismes de la dette, du commerce et de la militarisation.
-
Dette : le FMI et la Banque mondiale ont imposé des programmes d’ajustement structurel qui ont démantelé les services publics, désindustrialisé l’économie et ouvert les marchés nationaux aux monopoles impérialistes.
-
Commerce : l’économie d’exportation du Kenya était liée à la production de matières premières (thé, café, fleurs) dont les prix sont dictés par les marchés étrangers, tandis que le pays importe des produits manufacturés à des prix gonflés.
-
Militarisation : grâce à l’AFRICOM, aux partenariats avec l’OTAN et aux pactes de renseignement, l’impérialisme a transformé le Kenya en une base avancée pour les opérations militaires américaines dans la Corne de l’Afrique. Cette militarisation est le bras armé de la dépendance économique.
Il en résulte une économie hybride et déformée, mi-féodale, mi-capitaliste, où les propriétaires fonciers dominent les campagnes et le capital étranger domine les villes. Il s’agit d’un système de capitalisme dépendant, incapable de développer les forces de production sans aggraver l’exploitation des travailleurs et des paysans.
Le caractère de classe de l’État kenyan
L’État kenyan, héritage du colonialisme, reste un instrument de domination de classe. Il n’est pas un arbitre neutre, mais une arme entre les mains des classes exploiteuses. Tous les gouvernements depuis l’indépendance, qu’ils se drapent dans la démocratie libérale ou dans la rhétorique du « développement », ont préservé la même base économique : propriété privée des moyens de production, soumission au capital étranger et répression de la classe ouvrière.
La façade de la démocratie parlementaire masque la dictature de la bourgeoisie. Derrière le cirque électoral, l’élite compradore gouverne au nom de l’impérialisme, utilisant la police, l’armée et le pouvoir judiciaire pour protéger ses intérêts. La violence de l’État contre les travailleurs en grève, les paysans sans terre et les jeunes qui manifestent révèle sa véritable nature de dictature bourgeoise de la classe compradore.
La persistance des relations semi-féodales
Dans les campagnes, les relations foncières coloniales persistent. Des millions de paysans restent sans terre ou confinés à de petites parcelles sous la domination des propriétaires fonciers et des entreprises agro-industrielles. Les soi-disant réformes agraires de l’indépendance n’ont fait que redistribuer les titres de propriété parmi l’élite, et non la terre parmi ceux qui la cultivent. Cette structure semi-féodale maintient les paysans dans la dette et la dépendance, perpétuant la faim au milieu de l’abondance.
Comme l’écrivait Marx, « la tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants ». Au Kenya, ce cauchemar est la persistance des relations de propriété coloniales sous des drapeaux néocoloniaux.
La leçon révolutionnaire
La leçon est claire : il ne peut y avoir de libération nationale sans la destruction de l’ordre compradore-bureaucratique. La classe ouvrière kenyane ne peut se libérer sans renverser les agents locaux de l’impérialisme. Une véritable indépendance exige la création d’un nouvel État, enraciné dans l’alliance des travailleurs et des paysans, qui s’exprime à travers leurs propres organes de pouvoir : les communes.
C’est pourquoi la question de Comuna o Nada n’est pas étrangère au Kenya. C’est la question même à laquelle notre révolution doit répondre. L’ancien État ne peut être réformé, il doit être détruit et remplacé par la dictature démocratique du peuple. Ce n’est que par ce processus que nous pourrons réaliser ce que Dedan Kimathi a proclamé depuis la potence : « Nous nous battons pour l’autonomie, pour la terre et pour le droit du peuple à se gouverner lui-même. »
La structure de classe et la question du pouvoir
« Sans une compréhension correcte des classes et de la lutte des classes, il ne peut être question de révolution. »
— Mao Zedong
La révolution ne naît pas de slogans, ni ne se nourrit de sentiments. Elle naît des contradictions qui déchirent une société, et elle ne progresse que lorsque la classe révolutionnaire saisit consciemment ces contradictions. La tâche centrale du marxisme-léninisme au Kenya aujourd’hui est donc d’identifier la structure de classe de la société néocoloniale, de définir l’ennemi principal et d’unir les forces motrices de la révolution autour de la lutte pour le pouvoir.
Les principales classes du Kenya néocolonial
La réalité matérielle du Kenya révèle la coexistence de relations capitalistes et semi-féodales. Le mode de production dominant reste le capitalisme dépendant, lié à la finance impérialiste, à l’agro-industrie et à l’accumulation compradore. Sous cette couche, des vestiges féodaux persistent dans le régime foncier, les relations de travail et la domination patriarcale. Au sein de cette formation sociale, nous distinguons les classes suivantes :
a) La classe ouvrière (prolétariat)
Né à l’époque coloniale et développé sous le capitalisme néocolonial, le prolétariat kenyan constitue la classe la plus avancée et la plus révolutionnaire. Il comprend :
-
Les travailleurs industriels dans les secteurs de la fabrication, des transports et de la construction ;
-
Les travailleurs du secteur public dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’administration ;
-
Les travailleurs informels et occasionnels dans les centres urbains, qui représentent le semi-prolétariat, oscillant entre le travail salarié et la petite production.
Malgré son militantisme – des grèves des cheminots d’Afrique de l’Est dans les années 1960 aux luttes contemporaines des enseignants, des médecins et des ouvriers d’usine – la classe ouvrière reste politiquement désorganisée à l’échelle nationale révolutionnaire. Pourtant, sa position objective en fait la force motrice capable de fournir une orientation idéologique et politique à toutes les autres classes opprimées.
b) La paysannerie
La paysannerie constitue la majorité de la population kenyane. Elle se divise en :
-
Les paysans riches, qui possèdent suffisamment de terres et emploient la main-d’œuvre d’autrui ;
-
Les paysans moyens, qui produisent principalement pour leur subsistance mais vendent de petits excédents ;
-
Les paysans pauvres et sans terre, qui possèdent peu ou pas de terres, dépendent du travail salarié saisonnier et supportent le plus lourd fardeau de l’exploitation.
Les paysans pauvres et sans terre sont la section la plus révolutionnaire, car ils souffrent doublement : des propriétaires fonciers qui leur extorquent des loyers et de l’agro-industrie impérialiste qui leur vole leurs produits. Leur libération est indissociable de la redistribution des terres et de la destruction de la propriété féodale.
c) La petite bourgeoisie
Cette classe comprend les petits commerçants, les artisans, les enseignants, les fonctionnaires de bas rang et certaines sections de l’intelligentsia. C’est une classe vacillante, révolutionnaire en temps de crise, réactionnaire lorsqu’elle craint de perdre ses privilèges. Dans ses rangs se trouvent à la fois des intellectuels progressistes qui se rangent du côté du peuple et des opportunistes qui cherchent à s’assimiler à l’ordre bourgeois. Le parti révolutionnaire doit gagner l’aile gauche de cette classe par l’éducation idéologique et le travail de masse.
d) La bourgeoisie nationale
Une petite couche de capitalistes kenyans engagés dans la production, le transport et la petite industrie, dont les intérêts entrent parfois en conflit avec ceux des monopoles étrangers. Dans certaines conditions, des sections de la bourgeoisie nationale peuvent participer à la révolution démocratique nationale (NDR). Cependant, l’histoire montre que cette classe a tendance à transiger avec l’impérialisme plutôt qu’à le combattre. Comme l’a averti Lénine, elle « vacille entre la révolution et la réaction ».
e) La bourgeoisie compradore et bureaucratique
C’est le principal ennemi de la révolution kenyane. La bourgeoisie compradore accumule des richesses grâce à sa relation de subordination avec le capital impérialiste, par le biais de monopoles d’import-export, de franchises étrangères et de spéculations financières. Elle contrôle les banques, les entreprises parapubliques et les partis politiques.
La bourgeoisie bureaucratique, enracinée dans l’appareil d’État, utilise le pouvoir politique à des fins d’enrichissement personnel, par le biais de contrats, d’appels d’offres et de corruption. Ensemble, elles constituent la classe dirigeante du Kenya néocolonial, gardiennes des intérêts impérialistes et visage national du capital mondial.
Comme Mao décrivait la bourgeoisie chinoise de son époque, elles sont « dépendantes de l’impérialisme, alliées au féodalisme et opposées au peuple ».
La nature de l’État kenyan
L’État kenyan est la dictature de la bourgeoisie compradore-bureaucratique, soutenue par les propriétaires fonciers et l’impérialisme. Il prétend être démocratique, mais sa démocratie est limitée à la bourgeoisie. Les élections ne servent qu’à légitimer le même bloc dirigeant sous des noms différents. La police, l’armée et le pouvoir judiciaire existent pour défendre la propriété privée et réprimer la lutte des classes.
Cet État, construit sur des fondations coloniales, ne peut être conquis par des élections ni réformé par des amendements constitutionnels. Il doit être renversé et remplacé par un nouvel État du peuple travailleur — un État démocratique populaire — dirigé par le prolétariat et fondé sur l’alliance des travailleurs et des paysans.
L’alliance des travailleurs et des paysans
La révolution au Kenya ne peut réussir sans l’unité des travailleurs et des paysans. La classe ouvrière apporte l’idéologie, l’organisation et la conscience ; la paysannerie apporte le nombre, la résilience et la revendication de terres. Cette alliance constitue le cœur de la révolution démocratique nationale.
Comme l’enseignait Lénine, « l’alliance des ouvriers et des paysans est la pierre angulaire de la révolution socialiste ». Dans notre contexte, cette alliance doit prendre une forme concrète dans les communes, les assemblées populaires et les unités de production coopératives où les deux classes exercent collectivement le pouvoir.
Ces organes du pouvoir populaire constitueront l’embryon du nouvel État – la commune kenyane – reliant l’esprit « Comuna o Nada » du Venezuela aux luttes historiques de notre propre peuple.
Le Parti révolutionnaire et la question du leadership
Toute révolution a besoin d’une avant-garde. Sans un parti fondé sur le marxisme-léninisme, la classe ouvrière ne peut remplir sa mission historique. Le Parti communiste marxiste du Kenya (CPMK) se présente comme le détachement conscient du prolétariat, armé de la théorie, enraciné dans les masses et discipliné dans la pratique.
Notre tâche ne consiste pas seulement à interpréter les relations de classe, mais à les transformer — à unir les éléments avancés de la classe ouvrière, à organiser la paysannerie révolutionnaire et à forger des alliances avec toutes les couches progressistes contre l’impérialisme et ses agents locaux.
L’arme idéologique du Parti est le marxisme-léninisme, sa forme politique est le centralisme démocratique et son objectif stratégique est le socialisme. Le Parti éduque, organise et mobilise, en appliquant la ligne de masse : des masses, vers les masses. Ce faisant, il prépare les travailleurs à remplacer l’ancien État par un nouvel État construit à partir de la base.
L’essence révolutionnaire de la commune
La commune n’est pas un rêve utopique, c’est l’expression concrète du pouvoir de classe. Selon les termes de Marx, c’est « la forme politique enfin découverte sous laquelle réaliser l’émancipation économique du travail ».
Dans le contexte kenyan, la commune représente l’unité organisée des travailleurs, des paysans et des opprimés, contrôlant la production, la distribution, l’éducation et l’autodéfense. Elle est le noyau du pouvoir populaire, l’antithèse de l’État bourgeois et l’embryon du socialisme. La lutte pour construire de tels organes de pouvoir, même sous une forme embryonnaire, est la tâche de tous les révolutionnaires de notre époque.
La question du pouvoir
En fin de compte, la révolution est une question de pouvoir : qui le détient, dans l’intérêt de qui et par le biais de quelles institutions. Tant que l’État restera entre les mains de la classe compradore-bureaucratique, l’impérialisme continuera à sucer le sang du peuple kenyan. La libération du Kenya exige rien de moins que la destruction de l’État bourgeois et l’établissement du pouvoir populaire.
C’est grâce à cette prise de pouvoir que Comuna o Nada devient non seulement un slogan, mais une réalité vivante, le point de convergence entre la libération nationale et le socialisme.
La commune et le pouvoir populaire dans le contexte néocolonial
La question de la commune est, par essence, la question du pouvoir populaire : qui gouverne, comment et dans l’intérêt de qui. Sous le néocolonialisme, la bourgeoisie cherche à masquer sa dictature derrière des façades parlementaires, des réformes constitutionnelles et des programmes de décentralisation. Mais sous cette surface se cache le même État colonial, armé et intact, au service des intérêts impérialistes et compradores.
Dans ce contexte, la commune n’apparaît pas comme une expérience administrative, mais comme un acte de rébellion. C’est l’arme politique, économique et idéologique grâce à laquelle les travailleurs commencent à arracher le pouvoir à l’État bourgeois et à exercer leur autonomie.
La commune comme forme révolutionnaire de pouvoir
Lorsque Chávez a déclaré « Comuna o nada », il n’inventait pas une nouvelle doctrine, mais faisait revivre l’essence historique de la révolution prolétarienne. La commune exprime ce que Marx a découvert en 1871 : que la classe ouvrière ne peut pas simplement s’emparer de l’appareil d’État tout prêt et l’utiliser à ses propres fins — elle doit le détruire et le remplacer par de nouveaux organes de pouvoir enracinés dans les masses.
Au Venezuela, la commune est apparue comme la cellule vivante de la révolution bolivarienne — unissant la production, la gouvernance et le bien-être social sous la propriété et le contrôle collectifs. Elle démontre, dans la pratique, que le socialisme n’est pas décrété d’en haut, mais construit d’en bas grâce à une participation consciente.
Pour le Parti communiste marxiste du Kenya (CPMK), cette leçon est essentielle. La commune n’est pas étrangère à notre sol ; elle fait écho à la mémoire historique du communalisme africain, ces formes précoloniales de travail collectif et de production partagée que l’impérialisme a cherché à détruire. Mais contrairement à la commune précoloniale, qui était fondée sur l’économie naturelle et une conscience limitée, la commune socialiste est construite sur la production moderne et la direction prolétarienne. Elle représente la restauration révolutionnaire et la transformation des relations communautaires sur la base de la lutte des classes.
Formes embryonnaires du pouvoir populaire au Kenya
Les travailleurs kenyans, même sans le nommer, avancent déjà sur la voie de la commune. Dans tout le pays, sous la pression de l’oppression et de la négligence, les masses ont commencé à créer des structures auto-organisées qui accomplissent les tâches que l’État bourgeois refuse d’entreprendre. Il s’agit notamment :
-
Des assemblées populaires dans les bidonvilles urbains, où les gens enquêtent sur les meurtres commis par la police, organisent la défense de la communauté et documentent la violence étatique.
-
Les comités de souveraineté alimentaire et les coopératives paysannes, qui récupèrent des terres pour l’agriculture collective, l’échange de semences et la production agroécologique.
-
Les groupes d’entraide et les initiatives harambee qui mobilisent la main-d’œuvre et les ressources pour l’éducation, la santé et l’eau — bien que souvent dépolitisés, ils montrent le potentiel latent d’une organisation socialiste.
-
Les collectifs de jeunes et les organisations étudiantes révolutionnaires qui contestent la répression étatique, le chômage et l’idéologie impérialiste.
Chacune de ces formations représente une commune germinale, une forme de double pouvoir émergeant dans des conditions néocoloniales. Leur évolution dépend de l’orientation politique, de l’éducation idéologique et du leadership de la classe ouvrière organisée dans son parti d’avant-garde. La tâche du CPMK est de guider ces efforts spontanés vers un pouvoir politique conscient, en transformant l’entraide en autonomie, la protestation en gouvernance populaire et la coopération en organisation de classe.
La dialectique de la ligne de masse et de la construction des communes
Mao Zedong enseignait que « pour diriger correctement, il faut aller vers les masses, apprendre d’elles et leur restituer leurs propres idées concentrées ». C’est la méthode de la ligne de masse, qui doit guider la construction des communes au Kenya.
Les communes ne peuvent être proclamées ; elles doivent être construites par le biais d’enquêtes sociales, d’analyses de classe et de participation. Chaque comité populaire, coopérative et organisation de jeunesse doit devenir une école du socialisme, reliant la théorie à la pratique et unissant le peuple autour de ses besoins les plus immédiats : la terre, la nourriture, le logement et la justice.
Ainsi, la commune se développe organiquement à partir des contradictions de la vie quotidienne. Elle naît dans la lutte, se nourrit de solidarité et se défend par la conscience collective. À mesure que le peuple s’organise pour résoudre ses problèmes indépendamment de l’État bourgeois, il commence à prendre conscience de sa capacité à gouverner — et avec cette prise de conscience, l’ancien ordre vacille.
La commune comme embryon de l’État démocratique populaire
En termes marxistes, tout processus révolutionnaire doit résoudre la question de l’État. L’État bourgeois, fondé sur la coercition et la propriété privée, sert les classes exploiteuses. La commune, en revanche, est la forme politique de la démocratie prolétarienne, un État d’un type nouveau.
Elle fusionne les fonctions législatives et exécutives entre les mains du peuple. Les délégués sont élus, responsables et révocables. La production, la défense et le bien-être sont organisés collectivement. L’éducation et la culture deviennent des instruments de la conscience socialiste plutôt que de l’endoctrinement bourgeois.
Dans le contexte kenyan, un tel État démocratique populaire ne naîtra pas des chambres parlementaires de Nairobi, mais des assemblées communales des travailleurs, des paysans et des jeunes, des organes de lutte auto-organisés dans les usines, les fermes, les écoles et les quartiers. La commune n’est donc pas une réforme, mais une rupture révolutionnaire : la destruction de l’État comprador-bureaucratique et la création d’un nouveau pouvoir par le bas.
Obstacles et tâches révolutionnaires
L’impérialisme et ses agents kenyans ne céderont pas le pouvoir de leur plein gré. La classe dirigeante comprend que la croissance du pouvoir populaire sonne le glas de l’ancien ordre. Elle cherchera donc à coopter, réprimer ou discréditer toute tentative d’organisation autonome.
Le mouvement révolutionnaire doit donc :
-
Unir toutes les forces démocratiques et anti-impérialistes sous la direction de la classe ouvrière.
-
Construire des structures clandestines et ouvertes qui relient les luttes communautaires à la ligne politique du Parti.
-
Développer une autodéfense armée et idéologique contre la répression étatique, conformément aux principes de la guerre populaire dans les conditions néocoloniales.
-
Intégrer la production et l’éducation politique au sein de la commune, en veillant à ce que l’autonomie économique renforce la conscience de classe.
-
Forger l’internationalisme prolétarien, en tirant les leçons des expériences des communes vénézuéliennes, des conseils populaires cubains et des gouvernements populaires révolutionnaires des Philippines et de Palestine.
Ce n’est que grâce à une lutte organisée et consciente que la commune kenyane passera du stade d’embryon à celui d’embryon du pouvoir d’État.
La culture révolutionnaire de la commune
Une révolution qui ne transforme pas la culture est vouée à périr. La commune doit nourrir une nouvelle culture de production collective, d’égalité et de service. Elle doit enterrer le tribalisme, le patriarcat et l’individualisme, armes idéologiques de l’impérialisme.
La commune révolutionnaire est à la fois un projet politique et culturel. Elle éduque par l’exemple : à travers le travail coopératif, la prise de décision démocratique et la solidarité sociale. Elle restaure la dignité du travail, ravive l’esprit communautaire de l’ujamaa sans ses distorsions bureaucratiques et arme les masses de la conscience que la liberté n’est pas accordée, mais construite. Selon les mots de Cabral, « la culture est à la fois le fruit de l’histoire d’un peuple et la graine de sa libération ». La commune est cette graine.
La commune comme pont vers le socialisme
La commune n’est pas la fin, mais le début du socialisme. C’est la structure transitoire à travers laquelle le peuple apprend à se gouverner lui-même, à réorganiser la production et à transformer les relations sociales. De la commune naîtra la République démocratique populaire du Kenya, un État fondé sur l’alliance des travailleurs et des paysans, guidé par le marxisme-léninisme et solidaire des nations anti-impérialistes du monde entier.
C’est à travers la commune que la NDR trouve son contenu socialiste ; c’est à travers la commune que le slogan « Comuna o Nada » (la commune ou rien) prend corps en Afrique. Le chemin vers le socialisme passe par la commune. Le chemin vers le pouvoir populaire passe par l’organisation. Et le chemin vers la victoire passe par l’unité.
Anti-impérialisme et antifascisme : la lutte mondiale
« L’impérialisme est un système mondial d’oppression coloniale et d’étranglement financier de la grande majorité de la population mondiale par une poignée de pays « avancés ». »
— V. I. Lénine
« La lutte contre l’impérialisme est la lutte pour la vie elle-même. »
— Fidel Castro
L’époque dans laquelle nous vivons est celle de l’impérialisme — le stade suprême et final du capitalisme — et de la révolution prolétarienne mondiale qui l’enterrera. Les lignes de bataille sont tracées : d’un côté se trouvent les puissances impérialistes menées par les États-Unis, l’OTAN et leurs alliés compradores ; de l’autre, les nations opprimées, les peuples travailleurs et les forces socialistes qui luttent pour leur libération. La crise du capitalisme est entrée dans une phase de guerre généralisée, de fascisation et d’effondrement environnemental. Pourtant, c’est précisément dans ce chaos que les forces de la révolution remontent à la surface.
La crise de l’impérialisme et la course à la guerre
Les contradictions du capitalisme monopolistique — entre le travail et le capital, entre les puissances impérialistes, et entre l’impérialisme et les nations opprimées — ont atteint un niveau explosif. L’économie mondiale est paralysée par la surproduction et la sous-consommation ; les oligarques financiers exportent des capitaux non pas pour le développement, mais pour la spéculation. Pour échapper à leur propre crise, les impérialistes recourent à la guerre, aux sanctions et à la militarisation.
Les États-Unis, confrontés au déclin économique, cherchent à rediviser le monde par l’agression militaire. Les guerres de l’OTAN en Yougoslavie, en Irak, en Libye, en Syrie et maintenant sa guerre par procuration en Ukraine, exposent la violence nue de la « démocratie » impérialiste. Sa stratégie s’étend à l’Afrique par le biais de l’AFRICOM, à l’Asie par le biais de l’AUKUS et à l’Amérique latine par le biais de coups d’État et de sanctions sans fin.
L’impérialisme mène aujourd’hui une guerre mondiale hybride : à coups de bombes et de drones, de dettes et de sanctions, de propagande et de surveillance numérique. Son essence reste inchangée : le pillage des ressources et la suppression de la souveraineté des peuples.
La montée du fascisme comme visage politique de la décadence
Le fascisme n’est pas un accident ; c’est l’expression politique du capital monopolistique en crise. À mesure que les contradictions du capitalisme s’accentuent, la bourgeoisie abandonne son masque libéral et recourt à une dictature ouverte. La montée du populisme de droite, de l’extrémisme religieux et du nationalisme chauvin à travers les continents marque le virage fasciste de la bourgeoisie.
En Afrique, l’impérialisme nourrit le fascisme par le biais de régimes militarisés, de sociétés mercenaires et de milices religieuses. En Europe et en Amérique du Nord, le fascisme se manifeste par la xénophobie raciste et la criminalisation de la dissidence. Partout, il sert le même objectif : diviser la classe ouvrière, écraser l’organisation révolutionnaire et défendre les profits impérialistes. L’avertissement de Lénine résonne comme une vérité : « L’impérialisme est l’époque des guerres et des révolutions. » Le fascisme est la politique de guerre désespérée d’un ordre moribond ; l’antifascisme est la bannière du nouveau monde qui naît.
Afrique : la nouvelle frontière de la recolonisation impérialiste
L’Afrique se trouve une fois de plus à la croisée des chemins de l’histoire. Les impérialistes cherchent à recoloniser le continent par la dépendance économique, les pièges de la dette et les bases militaires. Le Sahel brûle sous les bottes de l’OTAN et de ses mandataires ; le Congo saigne pour le coltan ; le Soudan meurt de faim sous le poids des sanctions ; et le Kenya, dans le cadre du partenariat AFRICOM, est devenu une base opérationnelle avancée pour le militarisme américain dans la Corne de l’Afrique.
Chaque base militaire est une chaîne autour du cou de l’Afrique ; chaque prêt étranger est un nœud coulant autour de sa souveraineté. La lutte contre l’impérialisme en Afrique est donc indissociable de la lutte contre les régimes compradores qui le servent.
Mais la résistance s’intensifie. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les peuples réclament leur libération de la domination française. Au Congo et au Soudan, des mouvements populaires contestent le pillage néocolonial. À travers le continent, une nouvelle conscience panafricaine s’éveille, une conscience qui rejette le nationalisme bourgeois et affirme l’internationalisme prolétarien.
La tâche des révolutionnaires est de transformer cet éveil en une lutte anti-impérialiste organisée, sous la direction de la classe ouvrière.
Le Front anti-impérialiste mondial
Dans tous les coins du monde, les opprimés s’unissent contre l’ennemi commun. La résistance héroïque de la Palestine, qui affronte le sionisme et l’impérialisme américain, est un exemple pour tous. La révolution bolivarienne au Venezuela et la révolution cubaine restent les bastions du socialisme dans les Amériques. Les guerres populaires aux Philippines et en Inde, les luttes armées en Palestine et au Congo, et les mouvements de masse à travers l’Asie et l’Afrique démontrent que l’esprit d’octobre 1917 est toujours vivant.
Il ne s’agit pas d’une série de soulèvements isolés, mais de la base matérielle d’un nouvel alignement international : le front anti-impérialiste mondial. Son unité doit être idéologique, politique et organisationnelle :
-
Idéologique, par la réaffirmation du marxisme-léninisme et de l’internationalisme prolétarien ;
-
Politique, par une lutte coordonnée contre la guerre impérialiste, les sanctions et le pillage ;
-
organisationnelle, à travers des réseaux de solidarité, des campagnes communes et des conférences telles que celle-ci.
En organisant cette conférence, la Plateforme anti-impérialiste mondiale (WAP) offre un espace essentiel pour forger cette unité. Elle est le centre embryonnaire d’une nouvelle Internationale de la résistance, un Komintern des opprimés, où les partis et mouvements révolutionnaires partagent leur stratégie, leur théorie et leur solidarité.
Le Kenya dans la division internationale du travail impérialiste
La classe dirigeante kenyane, en alliance avec l’impérialisme, a positionné le pays comme un avant-poste régional pour les intérêts américains, britanniques et européens. Son armée mène des guerres impérialistes sous la bannière du « maintien de la paix » ; ses ports, son espace aérien et ses services de renseignement sont au service de maîtres étrangers. Son économie est un atelier du capital étranger : des fermes florales pour l’Europe, du café pour l’Amérique et une main-d’œuvre bon marché pour le Golfe.
Cette soumission n’est pas de la diplomatie, c’est de la collaboration de classe à l’échelle mondiale. La bourgeoisie compradore kenyane vend la souveraineté nationale en échange d’aide, de prêts et de formation militaire. Elle transforme le sang de notre peuple en huile qui graisse la machine impérialiste.
Par conséquent, la lutte anti-impérialiste au Kenya doit être menée simultanément à deux niveaux :
-
Contre l’ennemi extérieur — l’impérialisme lui-même ;
-
Contre l’ennemi intérieur — les classes compradore et bureaucratique qui servent l’impérialisme
Cette double lutte définit la révolution démocratique nationale et lie le destin du Kenya à celui du prolétariat mondial.
L’unité dialectique de l’anti-impérialisme et de l’antifascisme
L’impérialisme engendre le fascisme ; le fascisme défend l’impérialisme. Combattre l’un, c’est combattre l’autre. Le mouvement anti-impérialiste doit donc être consciemment antifasciste, mobilisant les masses non seulement contre la domination étrangère, mais aussi contre la réaction nationale.
Dans le contexte kenyan, l’antifascisme signifie résister à la répression étatique, aux meurtres policiers et au chauvinisme ethnique — tous les outils utilisés par la bourgeoisie pour maintenir son pouvoir. Chaque assemblée populaire qui documente les violences policières, chaque grève ouvrière réprimée par la force armée, chaque paysan qui défend ses terres contre l’expulsion, sont autant d’actes de résistance antifasciste.
Le Parti doit rassembler ces luttes en un seul courant politique, guidé par la théorie révolutionnaire et uni sous la direction prolétarienne. Seul un programme socialiste peut éradiquer à la fois l’impérialisme et le fascisme.
L’internationalisme révolutionnaire : la seule voie vers la victoire
L’internationalisme prolétarien n’est pas de la charité, c’est une stratégie. La classe ouvrière du Kenya ne peut se libérer seule ; sa victoire est liée au triomphe de tous les peuples opprimés. Le même ennemi qui bloque le Venezuela, bombarde la Palestine et militarise l’Afrique exploite les travailleurs et les paysans kenyans. Notre solidarité n’est donc pas sentimentale, mais pratique, et s’exprime à travers la coordination, l’échange et la lutte commune.
Comme l’a proclamé Marx, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » – et aujourd’hui, nous devons ajouter : « Nations opprimées et travailleurs de tous les continents, unissez-vous ! » Le nouveau monde est déjà en gestation dans le ventre de l’ancien. Les communes bolivariennes, les conseils populaires cubains, les gouvernements populaires philippins et les mouvements révolutionnaires africains en plein essor sont les embryons du futur monde socialiste. Notre tâche consiste à les nourrir, à les défendre et à les relier entre eux pour former une chaîne indestructible.
Le devoir anti-impérialiste du CPMK
Le Parti communiste marxiste du Kenya, en tant que détachement du prolétariat international, reconnaît son devoir envers la révolution mondiale. Il s’engage à :
-
Dénoncer l’impérialisme sous toutes ses formes — économique, politique, culturelle et militaire ;
-
Construire la solidarité avec les mouvements anti-impérialistes en Afrique, en Amérique latine et en Asie ;
-
Éduquer les masses sur la nature de l’impérialisme et la nécessité du socialisme ;
-
Développer des organes du pouvoir populaire qui relient les luttes locales à la stratégie mondiale ;
-
Défendre les nations socialistes telles que Cuba, le Venezuela, la RPDC et la Chine contre l’agression impérialiste.
Dans cette unité de pensée et d’action, nous déclarons que la libération du Kenya est un front dans la libération de l’humanité. Camarades, nous ne sommes ni l’Est ni l’Ouest — nous sommes le Sud en lutte, le Sud rouge en plein essor, dont le destin est d’enterrer l’impérialisme sous le poids de ses propres crimes.
Vers la Constitution de la Commune : leçons pour l’Afrique
Dans toute révolution authentique, il arrive un moment où le peuple doit donner une forme politique et constitutionnelle au pouvoir qu’il a conquis. Ce moment est maintenant venu pour le Venezuela — et, à travers lui, pour le mouvement révolutionnaire mondial. La proposition d’une « Constitution communale » ne représente pas seulement une réforme de la légalité bourgeoise, mais la naissance d’un nouveau type d’État : un État qui exprime, institutionnalise et défend le pouvoir du peuple travailleur. Elle marque une étape décisive dans la lutte pour la prise du pouvoir, vers la lutte pour la consolidation et la reproduction du pouvoir sous une forme socialiste.
La signification historique de la Constitution communale
La révolution vénézuélienne, née dans les flammes de la lutte anti-impérialiste, a traversé une dialectique profonde : de la République bolivarienne à la Commune bolivarienne, des réformes étatiques au pouvoir populaire. Lorsque Chávez a déclaré « Comuna o nada ! » (La commune ou rien !) en 2012, il résumait des décennies d’expérience : la vérité que le socialisme ne peut perdurer que lorsque le pouvoir appartient aux masses organisées.
Aujourd’hui, sous la direction du président Nicolás Maduro et des institutions révolutionnaires de la République bolivarienne, le Venezuela avance vers une Constitution communale, un nouveau contrat social qui élève les communes du statut d’initiatives locales à celui d’unités fondamentales de l’État. Elle vise à consacrer légalement ce que l’histoire a déjà créé dans la pratique : le double pouvoir du peuple. Ce processus constitutionnel a une importance historique mondiale. Il remet en question la conception libérale de la souveraineté fondée sur la propriété individuelle et la remplace par une souveraineté collective fondée sur la propriété sociale. Il transforme la commune d’un organe « participatif » en cellule primaire de la gouvernance socialiste.
La Constitution communale, fer de lance de la démocratie socialiste
Les constitutions bourgeoises codifient le pouvoir des exploiteurs ; la Constitution communale codifie le pouvoir des exploités. Elle incarne trois principes révolutionnaires :
-
La souveraineté économique — la socialisation de la production et de la distribution sous le contrôle communal.
-
La souveraineté politique — la fusion des pouvoirs législatif et exécutif dans des assemblées populaires, élues et révocables.
-
Souveraineté culturelle : l’élévation des valeurs socialistes, de la solidarité humaine et de l’éthique collective comme base morale de la société.
Alors que la constitution bourgeoise proclame des « droits » sans moyens matériels pour les réaliser, la Constitution communale cherche à garantir ces droits par le contrôle direct du peuple sur la base matérielle de la société. Elle transforme la démocratie d’un rituel de vote en un système de participation directe et d’administration collective.
Il s’agit de la forme la plus élevée de démocratie populaire — non pas parlementaire mais populaire, non pas représentative mais participative, non pas individualiste mais sociale. Elle concrétise la vision de Marx dans la Commune de Paris et de Lénine dans L’État et la révolution : la disparition de l’ancien État bureaucratique et son remplacement par un État du peuple travailleur.
Leçons pour l’Afrique : de l’indépendance factice au pouvoir populaire
Six décennies après la chute du colonialisme, l’Afrique vit toujours sous le joug de la domination néocoloniale. Les constitutions imposées par l’impérialisme ont préservé l’État colonial – ses forces armées, sa bureaucratie et ses tribunaux – tout en l’enveloppant de couleurs nationalistes. Ces constitutions protègent la propriété privée, les investissements étrangers et les privilèges des compradores, et non la libération des masses.
Pour faire avancer la révolution africaine, les travailleurs doivent rédiger leur propre ordre constitutionnel, ancré dans les réalités de la lutte des classes et dans les traditions de démocratie communale qui précédaient la conquête coloniale. La Constitution communale du Venezuela offre des leçons inestimables pour cette tâche.
Elle nous apprend qu’une véritable constitution populaire doit :
-
Émaner des masses, et non des experts juridiques ou des assemblées d’élite ;
-
Être testée dans la pratique avant d’être codifiée, comme l’ont déjà démontré les communes vénézuéliennes ;
-
Subordonner la propriété privée aux besoins sociaux, en remplaçant le droit bourgeois par la justice socialiste ;
-
Institutionnaliser l’alliance entre les travailleurs et les paysans, en veillant à ce que la production et la gouvernance servent les intérêts collectifs ;
-
Reconnaître la solidarité internationale comme un principe constitutionnel, en liant la libération nationale à la révolution mondiale.
Ces leçons doivent guider la lutte en Afrique pour passer d’une indépendance factice à une souveraineté réelle, des constitutions bourgeoises aux constitutions populaires, des parlements néocoloniaux aux communes révolutionnaires.
La Constitution communale et la révolution démocratique nationale (RDN)
Pour le CPMK, la révolution démocratique nationale (RDN) est le pont nécessaire entre la lutte anti-impérialiste et la transformation socialiste. Elle n’est pas la fin de la révolution, mais son commencement. La RDN vise à détruire le pouvoir de la bourgeoisie compradore-bureaucratique, à liquider le semi-féodalisme et à établir le pouvoir démocratique populaire sous la direction du prolétariat.
Dans ce cadre, la Constitution communale correspond à la forme politique de la RDN. Elle fournit le mécanisme par lequel l’alliance des travailleurs et des paysans gouverne la société et dirige la production. Elle donne à la révolution une base légale stable tout en préparant les conditions de la transition socialiste.
Ainsi, l’expérience bolivarienne ne contredit pas la voie africaine, elle l’éclaire. La commune vénézuélienne, les conseils populaires cubains, les comités populaires mozambicains et angolais de la guerre de libération révèlent tous la même vérité universelle : la révolution doit organiser le pouvoir populaire, sinon elle périra.
Les tâches des révolutionnaires en Afrique
Le chemin qui mène de l’ancienne constitution à la Constitution communale ne sera pas paisible. L’impérialisme et ses agents africains résisteront par tous les moyens, des coups d’État et des blocus à la guerre idéologique. Les révolutionnaires africains doivent donc se préparer sur tous les fronts :
-
Sur le plan idéologique, en dénonçant la fausseté de la démocratie bourgeoise et en affirmant la conception prolétarienne du pouvoir.
-
Politiquement, en construisant des organes du pouvoir populaire au niveau local : assemblées populaires, coopératives et défense communautaire.
-
Économiquement, en développant une production autonome et une planification socialiste pour rompre la dépendance vis-à-vis des marchés impérialistes.
-
Culturellement, en décolonisant l’éducation et les médias, en restaurant une conscience révolutionnaire enracinée dans la réalité africaine.
-
Sur le plan organisationnel, en renforçant le parti d’avant-garde en tant que noyau du nouvel État.
La transformation de la société doit se refléter dans la transformation de l’individu. La commune éduque de nouveaux hommes et femmes qui travaillent non pas pour le profit, mais pour le bien collectif ; qui ne pensent pas en tant que tribus, sectes ou consommateurs, mais en tant que bâtisseurs d’une nouvelle civilisation.
Du Venezuela bolivarien à l’Afrique révolutionnaire
La révolution bolivarienne démontre que le socialisme est possible même sous le siège, lorsqu’il est guidé par le pouvoir populaire et l’internationalisme prolétarien. Son avancée constitutionnelle n’est donc pas seulement une victoire vénézuélienne, mais un coup universel porté à l’impérialisme.
L’Afrique doit reprendre ce flambeau. La voie vers la libération du continent ne passe pas par de nouveaux blocs commerciaux ou des pactes néolibéraux, mais par une fédération de communes — un panafricanisme révolutionnaire fondé sur le socialisme, et non sur la diplomatie bourgeoise.
La Constitution communale du Venezuela est donc à la fois un modèle et un miroir : un modèle de construction socialiste et un miroir reflétant ce que l’Afrique doit encore accomplir. Son essence peut se résumer en une seule vérité : le pouvoir révolutionnaire appartient au peuple, sinon il cesse d’être révolutionnaire.
La synthèse révolutionnaire
Au Kenya, la commune naîtra des usines, des plantations, des quartiers informels et des villages ruraux. Chacune sera une école de gouvernance socialiste et de production collective. À mesure que ces communes s’uniront pour former un réseau national du pouvoir populaire, les bases d’une Constitution communale kenyane émergeront, exprimant, dans la loi et dans la pratique, la dictature du prolétariat et le règne démocratique du peuple.
Ainsi, l’expérience vénézuélienne et la révolution kenyane convergent vers une seule vérité : le chemin vers le socialisme passe par la commune ; le chemin vers le pouvoir populaire passe par la constitution des communes.
La commune ou rien – L’avenir appartient au prolétariat
L’histoire est une fois de plus à un tournant. Le vieux monde tremble sous le poids de ses propres contradictions ; l’impérialisme, pourri mais enragé, s’accroche à la vie par la guerre, le mensonge et le fascisme. Mais partout où il y a oppression, la résistance naît – et partout où la résistance s’organise, la révolution devient inévitable.
Aujourd’hui, cette résistance revêt de nombreux visages : les communes du Venezuela, la lutte armée en Palestine, les guerres populaires en Asie, les soulèvements de la jeunesse en Afrique. Sous leur diversité se cache un seul et même courant historique : la marche du prolétariat et des opprimés vers la maîtrise de leur propre destin.
La commune comme forme du nouveau monde
La commune n’est pas un rêve, mais une nécessité. Elle est la réponse à la question qui hante toutes les classes exploitées : comment nous gouverner après la destruction de l’ancien ordre ?
Dans la commune, la production sert l’usage, pas le profit. Le pouvoir sert le peuple, pas une minorité. La division entre dirigeants et dirigés commence à disparaître ; le travail retrouve sa dignité ; la solidarité remplace la concurrence. La commune est à la fois une arme de guerre et une graine de paix — guerre contre l’exploitation, paix entre les producteurs.
Pour les travailleurs kenyans, la commune est le pont entre la lutte pour la libération nationale et la construction du socialisme. Elle fusionne la sagesse révolutionnaire de Marx et Lénine avec les traditions vécues du communalisme africain et de l’auto-organisation. Elle transforme l’uhuru d’un drapeau en une réalité matérielle.
La crise du néocolonialisme et l’inévitabilité de la révolution
Le Kenya néocolonial est un microcosme de l’ordre impérialiste mondial : dépendant, inégalitaire et violent. Une poignée de personnes s’enrichissent au service de maîtres étrangers, tandis que des millions d’autres travaillent dur dans la faim. Le paysan continue de labourer le champ d’un autre, l’ouvrier continue de transpirer pour le profit d’un autre, les jeunes continuent d’errer sans avenir.
Mais comme Lénine nous l’a rappelé, « il y a des décennies où rien ne se passe, et des semaines où des décennies se passent ». Les contradictions de la société kenyane mûrissent vers un tel moment. Lorsque les masses réaliseront que leur souffrance n’est pas le fruit du destin mais d’une politique, non pas un malheur mais le résultat d’une conception de classe, la terre tremblera à nouveau comme elle l’a fait dans les forêts de Dedan Kimathi. La tâche du Parti communiste marxiste du Kenya est de transformer cette colère spontanée en pouvoir organisé, de transformer le cri de protestation en discipline révolutionnaire.
La révolution démocratique nationale comme voie africaine vers le socialisme
Notre révolution n’est pas une imitation d’un modèle étranger ; c’est l’application concrète du marxisme-léninisme aux conditions de l’Afrique semi-féodale et néocoloniale. La révolution démocratique nationale (RDN) reste notre étape stratégique : le renversement de la domination impérialiste et la destruction de l’ordre comprador-bureaucratique, menant inexorablement au socialisme.
La forme politique de la RND est l’État démocratique populaire ; sa forme économique est la propriété collective et la planification ; sa forme idéologique est la conscience socialiste ancrée dans la réalité africaine. Et son institution vivante, son cœur battant, est la commune. Ainsi, faire avancer la RND, c’est construire la commune ; défendre la commune, c’est défendre la révolution ; relier toutes les communes, c’est créer l’État socialiste de demain.
Internationalisme prolétarien : du Kenya au monde entier
Aucune révolution n’est isolée. La victoire d’un front renforce tous les autres. Le Parti communiste marxiste du Kenya salue le peuple vénézuélien qui porte haut le drapeau de la Comuna o Nada sous le siège ; les camarades cubains pour leur défi inébranlable ; le peuple palestinien pour sa résistance héroïque ; et les peuples en lutte du Congo, du Soudan et d’Haïti pour leur courage face à l’agression impérialiste.
Nous déclarons que la libération de l’Afrique est indissociable de la libération de l’humanité. Les balles qui tuent nos paysans à Laikipia sont forgées dans le même acier que les bombes qui tombent sur Gaza et les sanctions qui frappent Caracas. Notre réponse doit donc être unique : une solidarité internationale fondée sur la lutte des classes. Que les mouvements révolutionnaires du Sud forment une alliance continentale et mondiale anti-impérialiste, un front rouge des opprimés, reliant les communes, les armées populaires et les partis d’avant-garde dans une chaîne de résistance.
L’avant-garde idéologique : le parti comme esprit de la révolution
Sans parti révolutionnaire, l’énergie du peuple se disperse ; avec un parti révolutionnaire, elle devient un torrent qu’aucun barrage ne peut retenir. Le Parti communiste marxiste du Kenya incarne la volonté organisée du prolétariat — discipliné, uni et enraciné dans les masses. Il doit étudier les lois de la lutte des classes, guider la construction des communes et former des cadres qui vivent pour le peuple et meurent pour la révolution.
Notre théorie est le marxisme-léninisme, notre pratique est la ligne de masse, notre foi est le pouvoir créateur des travailleurs. Le Parti est le fil rouge qui relie chaque commune, chaque grève, chaque occupation de terres en une seule mission historique : la prise du pouvoir et la construction du socialisme.
L’avenir appartient au prolétariat
La bourgeoisie se vante de sa civilisation, mais cette civilisation repose sur l’exploitation, la faim et la guerre. Elle détruit la terre et appelle cela le développement ; elle asservit les nations et appelle cela l’ordre. Son temps est révolu.
L’avenir appartient à ceux qui construisent, pas à ceux qui pillent ; à ceux qui produisent, pas à ceux qui spéculent ; à ceux qui unissent, pas à ceux qui divisent. L’avenir appartient à la classe ouvrière, à la paysannerie, à la jeunesse et aux femmes révolutionnaires, au front international des opprimés.
Il appartient aux communes qui s’élèveront des ruines de l’impérialisme, aux bannières rouges qui flotteront à nouveau sur l’Afrique libérée, et à la solidarité des peuples qui savent que le socialisme n’est pas un rêve mais une nécessité pour survivre.
Appel final
Camarades, le choix qui s’offre à l’humanité est clair et simple :
Comuna o nada. Le socialisme ou la barbarie. La vie ou l’extinction.
Restons donc solidaires du peuple vénézuélien et de toutes les nations opprimées de la terre. Transportons l’esprit de la Constitution de la Commune dans nos propres révolutions. Transformons chaque usine en une école du socialisme, chaque ferme en une forteresse de résistance, chaque village en une commune du peuple.
Lorsque le peuple se gouverne lui-même, aucun empire ne peut l’asservir. Lorsque le prolétariat détient le pouvoir, aucune force ne peut renverser le cours de l’histoire.
Vive la révolution bolivarienne !
Vive l’internationalisme prolétarien !
Vive l’alliance des travailleurs et des paysans !
La Commune ou rien — La liberté véritable ou la mort !
Par Booker Omole
Secrétaire général, Parti communiste marxiste du Kenya (CPMK)
17 octobre 2025
Caracas, Venezuela