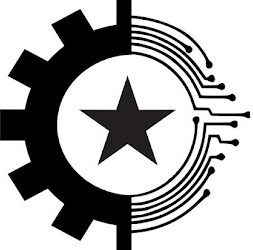Entretien avec le sociologue brésilien Ricardo Antunes. Réduire le temps de travail dans un contexte de précarité et d’intensification de l’exploitation est également une revendication clairement anticapitaliste.
Né à São Paulo il y a 72 ans, Ricardo Antunes est professeur de sociologie à l’Institut de philosophie et des sciences humaines de l’université brésilienne de Campinas. Il analyse depuis des décennies l’évolution du monde du travail. « Je n’ai jamais été seulement un universitaire. Depuis 50 ans, je suis un militant social et de gauche, tout en étant un intellectuel », dit-il avant d’aborder un sujet sur lequel il revient sans cesse : l’inexistence d’une crise du travail, mais bien d’une crise du système qui le structure.
Pour Antunes, il existe clairement une crise du monde du travail, dans le cadre d’une nouvelle crise structurelle particulière du capitalisme, mais pas du travail en tant que tel, dit-il. Le sociologue insiste sur la nécessité, pour les « forces de transformation », de comprendre ces questions clés si l’on veut formuler une alternative.
–Ce sont là des thèmes sur lesquels je pense qu’il faut insister et insister encore en ce moment. Il existe plusieurs thèses liées au travail et à son évolution que je ne partage pas. L’une d’elles est celle de la soi-disant crise du travail, une autre est celle qui consiste à parler de post-capitalisme ou à affirmer que nous sommes actuellement dans une ère post-industrielle. Je m’explique : tant qu’il y aura du capitalisme, il y aura du travail. Le capitalisme sans travail n’existe pas, il ne peut survivre sans travail vivant, même si les caractéristiques de ce travail changent et que nous sommes aujourd’hui confrontés à un double phénomène : des gens qui travaillent beaucoup plus et un chômage en hausse.
Ce que nous vivons actuellement, c’est une phase ultra-capitaliste du capitalisme, pour ainsi dire. Une phase particulièrement destructrice, particulièrement violente, à un degré inconnu. Nous le voyons à tous les niveaux : au niveau strictement professionnel, bien sûr, mais aussi au niveau environnemental – avec une destruction sans précédent de la nature – et dans les relations humaines, interpersonnelles et de genre.
La différence fondamentale entre cette crise structurelle du système et les précédentes réside dans le fait qu’aujourd’hui, le capital ne peut se développer sans détruire, mais nous sommes loin de tout post-capitalisme. C’est un concept qui nous vient du Nord, comme tant d’autres, mais qui, dès que l’on examine ce qui se passe dans le Sud – et dans le Sud du Nord lui-même –, s’effondre de lui-même. Il en va de même lorsque l’on dit que nous serions dans une phase post-industrielle.
Le monde du travail a toujours été complexe et fragmenté, et il l’est encore plus aujourd’hui. Je pense que nous avons atteint un stade où l’on ne peut plus parler à proprement parler de classe ouvrière. Dans certains de mes livres [Los sentidos del trabajo, 1999, ¿Adiós al trabajo?, 2015], je parle de classe-qui-vit-du-travail, ainsi, avec des tirets, pour englober toutes les catégories, y compris le nouveau prolétariat des services et les précaires.
À mesure que le capital est passé de la robotique à la numérisation, aux algorithmes et à l’intelligence artificielle, l’industrie a changé, sans pour autant disparaître. S’il est vrai que le prolétariat industriel a fortement diminué en Europe et aux États-Unis, il s’est développé dans d’autres régions, comme la Chine et l’Inde, les deux pays les plus peuplés de la planète. Parallèlement, partout dans le monde, sans distinction, une industrie privée des services s’est développée depuis les années 70, un processus qui s’est fortement accéléré ces dernières années avec l’émergence d’un prolétariat des services à l’ère numérique. Les entrepôts d’Amazon sont des usines d’un nouveau genre, mais des usines quand même. Amazon a commencé par vendre des livres et est aujourd’hui une gigantesque industrie logistique qui distribue des marchandises de toutes sortes et de toutes origines à l’échelle planétaire et dispose également de ses propres systèmes de transport. Il en va de même pour Mercado Libre en Argentine et en Uruguay.
–Serait-ce là la tendance dominante aujourd’hui, celle du capitalisme des plateformes ?
–Oui. Le capitalisme des plateformes a repris des modes d’exploitation que l’on pourrait qualifier de protoformes du capitalisme. En d’autres termes, on assiste aujourd’hui, avec les moyens propres au XXIe siècle, à partir des nouvelles technologies, à des phénomènes d’exploitation, d’expropriation et de spoliation très similaires, par leur puissance, à ceux qui ont été vécus sous la révolution industrielle, aux XVIIIe et XIXe siècles. À la différence qu’à l’époque, le capitalisme n’avait pas encore fini de briser ses frontières géographiques. Aujourd’hui, il ne peut presque plus s’étendre sur la surface de la Terre. Ce n’est pas pour rien que des magnats comme Elon Musk, Jeff Bezos et d’autres cherchent à repousser les frontières de l’exploitation des ressources vers l’espace sidéral. Ce qui semblait relever de la science-fiction est en train de devenir réalité, et dans cette course et cette prédation, nous atteignons des limites qui mettent en danger la survie même de l’espèce et de la planète.
Le capitalisme dans son ensemble fonctionne de plus en plus selon le modèle Uber, avec une main-d’œuvre pratiquement privée de droits sociaux qui loue sa force de travail à un patron souvent invisible. Ils ne sont pas officiellement esclaves, comme ils l’étaient il y a des siècles, mais ils le sont dans les faits. Ils sont salariés, mais cette condition leur est masquée : ils doivent se procurer eux-mêmes leurs outils de travail (moto, vélo, casques, voire téléphone portable) ; ils doivent être connectés presque toute la journée s’ils veulent travailler ; ils sont présentés comme des « indépendants », voire comme des « associés » de leurs patrons (tout un lexique de management hypocrite a été créé dans les grands cabinets d’avocats internationaux), alors qu’en réalité, ils incarnent l’une des formes les plus sauvages de précarisation, et il leur est très difficile de créer des structures organisationnelles pour défendre leurs droits, car ils sont extrêmement atomisés et individualisés.
La pandémie de 2019 à 2021 a permis aux capitaux de promouvoir des laboratoires d’exploitation du travail sur un modèle d’extrême précarisation, d’informalisation, qui avait commencé bien avant, mais qui s’est depuis étendu. Qui ne veut pas être « indépendant » ? Qui ne veut pas gérer son temps de vie de manière flexible ? Quel jeune n’a jamais rêvé de conquérir le monde à moto ? Le capitalisme ubérisé vend aux jeunes cette illusion de liberté, de maîtrise de leur propre temps, qui s’évanouit rapidement lorsqu’ils se rendent compte, par exemple, qu’à la fin d’une journée de travail, ils n’en peuvent plus, qu’ils n’ont plus de vie et qu’ils sont dans un état de vulnérabilité absolue. Dans ma ville, São Paulo, il y a un accident mortel par jour impliquant des livreurs, et beaucoup d’autres subissent des blessures graves dont ils doivent assumer eux-mêmes les conséquences, car ils sont censés être indépendants. Ce paradoxe est terrible, c’est l’autre visage, le visage réel, de l’illusion de liberté qu’on leur vend.
L’uberisation dont je parle est, en résumé, le résultat de la combinaison de l’expansion sans fin des plateformes numériques, de la restructuration productive permanente sur laquelle repose le capitalisme et de la financiarisation. Ces trois facteurs génèrent une sorte de triade destructrice qui conduit à ce que le travail stable, réglementé, avec des droits incorporés, devienne de plus en plus rare. Outre les livraisons, Uber et compagnie, diverses formes d’« entrepreneurship » personnel sont encouragées partout, ainsi que des pseudo-coopératives d’entreprises qui n’ont rien à voir avec celles qui ont vu le jour à l’époque comme des initiatives solidaires. Parallèlement, les capitaux, qui sont des capitaux mondialisés, exigent de plus en plus le démantèlement de la législation qui protège le travail.
–Les grèves menées par les livreurs brésiliens ou la démission massive des travailleurs du secteur des services aux États-Unis ont fait beaucoup de bruit à l’époque. Que signifient ces protestations ?
–Le facteur commun était le mécontentement au travail. Aux États-Unis, un mouvement connu sous le nom de « grande désertion » ou « grande démission » a vu des millions de personnes démissionner de leur emploi parce qu’elles le considéraient plus néfaste que bénéfique. Mieux vaut rester chez soi que de se fatiguer et de tomber malade pour un salaire précaire et un travail à forte rotation, se sont-elles dit. Cette protestation n’avait pas de dimension politique directe, et quelque chose de similaire semble difficile dans le sud, mais le malaise social ambiant était très évident.
Le mouvement des livreurs brésiliens (Uber Eats, Rappi, iFood) était différent. Il a été appelé Breque dos apps (quelque chose comme « freiner les applications »). Le premier a eu lieu en pleine pandémie, le 1er juillet 2020. Puis il y en a eu un autre, les 31 mars et 1er avril derniers. Dans les deux cas, il s’agissait de protester contre les conditions de travail, le manque de protection, les bas salaires, les horaires et les exigences démesurées des entreprises. Ils se sont coordonnés via les réseaux sociaux et ont cherché des moyens de communiquer avec le reste de la société. Les grandes plateformes numériques n’ont pas compris qu’elles pouvaient générer des mouvements de rébellion adaptés à ce monde « ubérisé ». Et qu’ils peuvent être très efficaces. À vrai dire, les syndicats ne l’ont pas beaucoup compris non plus.
–Vous êtes très critique à l’égard de la manière dont les syndicats et les partis de gauche ou progressistes réagissent à ces nouveaux phénomènes.
–Il y a plusieurs problèmes. D’une part, cette nouvelle morphologie du travail qui encourage la précarisation crée de nouveaux lieux physiques d’exploitation très éloignés des usines qui caractérisaient le fordisme et le taylorisme au XXe siècle. Là où il y avait auparavant une entreprise concentrée, il peut désormais y avoir de nombreuses petites unités connectées en réseau ; là où il y avait auparavant un ouvrier spécialisé, il y a désormais un travailleur « polyvalent », « multifonctionnel ». Ces mutations exigeraient, d’autre part, de nouvelles réponses organisationnelles, de nouvelles façons de se positionner au moment d’apporter des réponses. Un syndicalisme vertical ne peut plus représenter de manière adéquate le nouveau prolétariat, les précaires. Comment le ferait-il ?
Au début du XXe siècle, il n’y avait pas de syndicat communiste ou anarchiste où l’on ne discutait pas du type de société que l’on voulait. Aujourd’hui, ils visent à préserver certains droits fondamentaux, ce qui est très bien, compte tenu de l’attaque dont ces droits font l’objet. Mais il est clair que cela ne suffit pas, compte tenu de ce même facteur : l’offensive dévastatrice est si grande qu’il doit y avoir une alternative à la hauteur, radicale, et pas seulement un palliatif.
Parallèlement, on ne voit pas, à gauche, de réflexion sur ces nouvelles tendances du monde du travail dans le cadre d’une proposition globale, simplement parce qu’elle a cessé de penser à la transformation du monde.
Ce qu’il y a un siècle on pouvait appeler le principe d’espérance était du côté de la gauche. Aujourd’hui, cette gauche aspire à peine à gagner les élections pour réduire les dégâts. Elle gère, elle ne change pas. Et elle le fait au nom d’un « réalisme » qui, dans les faits, cache son incapacité à imaginer quoi que ce soit qui sorte de l’univers du capitalisme.
Le réalisme est un piège. Lors de la révolution russe, ce sont des slogans à la fois réalistes et transformateurs qui ont mobilisé les gens : pas tant « tout le pouvoir aux soviets », mais la paix, le pain et la terre. La paix, parce que les travailleurs venaient de périr par millions dans les tranchées de la Première Guerre mondiale ; le pain, parce qu’ils mouraient littéralement de faim ; et la terre, pour avoir accès à la nourriture. Il s’agissait de revendications simples, pratiques dans leur conception et qui encourageaient un changement fondamental.
–Quels seraient leurs équivalents actuels ?
–L’un d’eux est la réduction drastique du temps de travail, associée à la revendication qu’il n’y ait pas de travail sans droits.
Un autre est la revendication écosocialiste, la préservation de la nature associée à la remise en question globale du modèle de production. Tout comme István Mészáros [sociologue marxiste hongrois décédé en 2017], avec qui j’ai travaillé pendant des années, je pense que le capitalisme est capable de gérer ses crises à l’infini et que nous allons droit vers le désastre.
Jusqu’où ira-t-il si on ne l’arrête pas ? C’est l’une des grandes questions civilisationnelles actuelles qui nous obligent à mettre au premier plan une alternative écosocialiste.
Le changement climatique est loin d’être une fantaisie. Que respirerons-nous dans 20 ou 30 ans ? Quelle eau boirons-nous ? Quels aliments consommerons-nous ? Ce sont là des questions directement liées au modèle de production hautement destructeur dans lequel nous sommes engagés et qui, malgré toutes les alertes et toutes les promesses, continue de s’aggraver.
Les guerres l’aggravent, tout comme, bien sûr, le mode d’organisation du travail et la manière dont les nouvelles technologies sont mises en œuvre, en particulier l’intelligence artificielle générative (que j’appelle dégénérative) et la course à la colonisation de l’espace. Tout est lié : du génocide à Gaza au réchauffement climatique et à l’ubérisation du travail, les liens sont beaucoup plus forts qu’il n’y paraît à première vue.
Quant à la demande de réduction du temps de travail, elle est loin d’être une simple réforme. D’autant plus aujourd’hui, où de moins en moins de personnes travaillent huit heures : la moyenne mondiale est d’au moins 12 heures, en grande partie pour un salaire modeste et une protection insuffisante. Il s’agit de travailler moins pour le même salaire et sans augmentation du rythme et de l’intensité. C’est tout à fait possible. L’intelligence artificielle elle-même pourrait permettre d’aller dans ce sens, car la question n’est évidemment pas celle des technologies en elles-mêmes, mais celle de l’objectif social pour lequel elles sont utilisées. Le problème survient lorsqu’elles remplacent le travail humain pour augmenter le travail mort en ajoutant des machines au profit des grands groupes qui les possèdent. C’est là que réside le nœud du problème.
La réduction du temps de travail permettrait de répartir le travail, de faciliter l’accès à l’emploi pour des masses de personnes qui n’en ont pas aujourd’hui, de donner plus de dignité à chacun en faisant perdre au travail une partie de sa place centrale dans la vie quotidienne. Dans un contexte de précarité et d’intensification de l’exploitation, il s’agit également d’une revendication clairement anticapitaliste, qui s’oppose au système de métabolisation du capital et relance la question de la finalité de la production. Ce n’est pas pour rien que les grands patrons des entreprises technologiques s’y opposent avec tant de force.
Nous sommes aujourd’hui dans une période de contre-révolution préventive où aucune menace de changement révolutionnaire ne se profile à l’horizon. Une période de dévastation où se combinent néofascisme, néonazisme et néolibéralisme extrême.
Qui radicalise aujourd’hui les luttes, apparaissant comme la force antisystème ?. L’extrême droite, très clairement. Il n’y a rien de plus systémique, de plus fonctionnel pour les secteurs dominants, que l’extrême droite, mais cette fiction se maintient dans la mesure où la gauche a renoncé à la combattre sérieusement.
Se préparer à le faire serait aujourd’hui, me semble-t-il, sa tâche fondamentale. Et pour cela, elle doit étudier la nouvelle morphologie du travail et la complexité actuelle du capital, et identifier qui peuvent être les acteurs d’un changement.
La vieille maxime selon laquelle venaient d’abord les partis, puis les syndicats et enfin les mouvements sociaux n’a plus de corrélat dans la réalité. Aujourd’hui, je pense qu’il faut se tourner vers les périphéries, les nouveaux prolétaires, les précaires, les indigènes, les mouvements féministes, les luttes pour l’égalité des droits et le syndicalisme qui intègre la complexité du monde du travail, et essayer de leur donner un sens d’ensemble. Les plus importants seront ceux qui parviendront à atteindre les racines des rouages sociaux. Notre vie dépend littéralement de ce processus. Bien plus que d’accéder au gouvernement, d’intégrer un conseil des ministres ou de conquérir une mairie.
lahaine.org