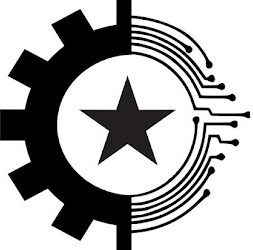La bourgeoisie nous conduit vers un nouveau piège politique : la question de l’« antifascisme » et de l’« anti-wokisme ».
Ce qui semble être un débat idéologique n’est rien d’autre qu’un nouveau piège politique électoral.
Dans cet article, nous vous expliquons pourquoi.
Tout d’abord, nous devons nous poser la question suivante : qu’est-ce que le fascisme ? S’agit-il d’une politique économique ? D’un courant idéologique ? Est-ce le produit de la volonté d’un gouvernement en place ?
Le fascisme est le résultat d’une tension particulière dans la lutte des classes, où le prolétariat, en déclin, épuisé par ses actions révolutionnaires sans pouvoir prendre le pouvoir, dépourvu d’une direction politique claire[1], ou d’une combinaison de ces facteurs, se trouve dans un rapport de forces défavorable qui ne lui permet pas d’éviter la victoire de la bourgeoisie.
L’émergence du fascisme trouve son origine dans une grande crise politique et économique qui rend la société capitaliste ingouvernable par le régime de la démocratie bourgeoise et dans la nécessité d’infliger une défaite cuisante à la classe ouvrière.
C’est pourquoi le fascisme n’est pas seulement un autoritarisme imposé par le haut, mais il parvient à gagner le soutien de secteurs des masses. D’abord, celui de la petite bourgeoisie. Ensuite, celui des secteurs arriérés du prolétariat, en brandissant le drapeau d’un fanatisme nationaliste contre le danger étranger (communistes aux idées étrangères, xénophobie contre les immigrants, en Allemagne contre les Juifs, etc.
Il a également un contenu expansionniste qui, tout comme en Allemagne et en Italie, s’est exprimé par la conquête de territoires, et sous le franquisme, par l’ambition impériale phalangiste de créer avec l’Amérique une confédération panhispanique dirigée par l’Espagne.
Ainsi, quel que soit le moment où l’on s’arrête pour analyser l’histoire du fascisme, on verra toujours ces tendances se répéter.
L’ascension d’Hitler est la réponse de la bourgeoisie allemande à la période de grèves, d’insurrections et de soulèvements armés qui ont eu lieu pendant la République de Weimar (1919-1923), motivés par une crise profonde qui s’est développée parallèlement à l’assujettissement des vainqueurs de la Première Guerre mondiale qui ont fait payer à l’Allemagne le coût de la défaite, humiliant ainsi la société. En effet, le dernier soulèvement a lieu en octobre 1923, tandis que la tentative de coup d’État d’Hitler se produit en novembre de la même année.
L’ascension de Franco est une réaction à la République en Espagne, caractérisée par son manque d’unité politique. En d’autres termes, une classe ouvrière et des secteurs populaires profondément fragmentés quant à l’orientation de ce processus.
L’ascension de Mussolini est la réponse de la bourgeoisie italienne au mouvement de grève qui a eu lieu pendant la période dite « biennio rojo » (1919-1921), un mouvement qui va culminer en 1920 avec la prise générale des usines par la classe ouvrière, qui les met en production de manière indépendante face au lock-out patronal. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les organisations d’autodéfense armées connues sous le nom de « Gardes rouges ».
Cette extraordinaire prouesse prolétarienne n’a pas suffi à prendre le pouvoir, et son élan s’est essoufflé en raison de l’absence d’une direction révolutionnaire ferme, ce qui a entraîné des hésitations et un recul. Cela s’est produit dans un contexte de chômage croissant, de réductions salariales et d’appauvrissement des masses provoqué par une crise capitaliste marquée.
Dans ce contexte, en brandissant un nationalisme extrême, soutenu par la partie la plus réactionnaire et concentrée de la bourgeoisie, les classes moyennes et une partie du prolétariat le plus arriéré, le fascisme s’est frayé un chemin et a fini par prendre le pouvoir.
Dans notre pays, le coup d’État de 1976, aux accents fascistes, survient face à un recul partiel du prolétariat et après une absence de direction politique claire après le Rodrigazo.
La courte durée du processus militaire en Argentine s’explique précisément par son manque de soutien populaire. Ainsi, malgré la répression déchaînée, facilitée par ce recul momentané, et malgré le décimage des organisations révolutionnaires, la classe ouvrière a vaincu la dictature à force de grèves et de sabotages, avec le large soutien de secteurs de la petite bourgeoisie.
Comme on le voit, la mise en œuvre du fascisme n’est pas une question idéologique, ni le fruit de la volonté délibérée d’un gouvernement particulier, mais une politique spéciale de la bourgeoisie lorsqu’elle ne peut plus recourir à la tromperie pour se maintenir au pouvoir et qu’elle doit mettre en œuvre la répression soutenue par des secteurs de la petite bourgeoisie et une partie du prolétariat, seule garantie de la continuité de ce processus.
Il convient de souligner le fait qu’aujourd’hui, à l’ère de la mondialisation impérialiste, le capitalisme a modifié sa base matérielle qui, dans les expériences citées, l’a conduit à exercer le nationalisme le plus ultramontain, malgré les Trump, les Poutine, les Meloni et compagnie, qui agitent la fermeture des frontières et l’augmentation des droits d’importation, la xénophobie et l’homophobie, les plaçant dans une situation inopportune et frôlant le ridicule, face aux aspirations des peuples qui luttent pour plus de libertés démocratiques.
Cela montre que, malgré la tendance à la réaction du capitalisme dans sa phase impérialiste, cela ne conduit pas nécessairement au fascisme.
C’est pourquoi l’autoritarisme prôné par des personnages tels que Trump, Milei, Poutine, etc. ne s’appelle pas fascisme.
De quoi s’agit-il alors ?
Au cours des 45 dernières années, la forme de domination par excellence adoptée par le capitalisme a été la démocratie bourgeoise. Grâce à elle, il a réussi, par la tromperie plutôt que par la répression, à démembrer la conscience de la classe ouvrière et à faire avancer ses politiques d’exploitation.
Mais ses institutions se sont progressivement effritées. Et à partir de la crise des dot-com d’abord, puis de la crise de 2008 (cette dernière aggravant la crise politique, notamment en Europe et aux États-Unis), la politique parlementaire traditionnelle a commencé à être sérieusement mise à mal.
La réponse de la bourgeoisie a été le populisme « de gauche ». Mais dès que la crise suivante de surproduction a éclaté en 2020 (non résolue à ce jour), les populismes qui garantissaient hier la tromperie ont perdu leur efficacité et, dans leur sillage, la bourgeoisie a encouragé d’autres populismes : ceux de « droite ».
S’appuyant sur certaines aspirations populaires (telles que la haine des bureaucraties syndicales, des monopoles, de l’insécurité et du trafic de drogue), ils imposent des discours violents pour incarner la colère qui couve dans les masses et la guider vers le bercail de la xénophobie, du racisme et de l’anticommunisme.
Ainsi, s’appuyant sur les aspirations populaires, ils génèrent une nouvelle fracture parlementaire : l’« anti-wokisme », c’est-à-dire l’« anti-progressisme ». Ce discours a fait mouche dans certains des secteurs les plus arriérés de la petite bourgeoisie, qui voit dans les gouvernements progressistes la cause de sa crise.
Cependant, la progression de cet « anti-wokisme » est extrêmement limitée, dans la mesure où il vise à priver le prolétariat et le peuple de leurs droits politiques.
La liberté tant vantée, défendue par les Milei, s’effondre rapidement face à la restriction croissante des libertés politiques (ou plutôt à la volonté d’appliquer ces restrictions). La crise prématurée de cette alternative populiste « de droite » entraîne une reconfiguration du progressisme qui ne lutte plus contre le « néolibéralisme », mais contre le « fascisme ». Ainsi, une nouvelle fracture se construit sur les ruines de la précédente : « fascisme contre antifascisme » ou « wokisme contre anti-wokisme ».
Voici l’élément central : la démocratie bourgeoise, le jeu parlementaire avec ses institutions, reste, pour les uns comme pour les autres, la forme fondamentale de domination pendant la période actuelle. Non seulement ces populismes ne sont pas fascistes car ils ne répondent pas à sa définition, mais ils renforcent aussi, directement ou indirectement, l’idée de la fameuse « défense de la démocratie », qui n’est autre que la défense de la démocratie bourgeoise avec sa répression correspondante de la démocratie ouvrière.
Alors, s’il n’y a pas de danger de fascisme parce qu’il n’existe pas de mouvement révolutionnaire capable de remettre en cause le pouvoir de la bourgeoisie qu’il faut conjurer, pouvons-nous en conclure que Milei n’est pas un fasciste ?
Une chose est l’aspiration individuelle, politique et idéologique. Une autre chose très différente, ce sont les conditions concrètes de la lutte des classes. Milei, tout comme Trump ou Meloni, peut aspirer à ce qu’il veut et incarner une pensée extrêmement anticommuniste et répressive. Une autre chose, ce sont les conditions concrètes dans lesquelles se déroule la lutte des classes. Tant que la démocratie bourgeoise restera le régime fondamental de domination, les aspirations individuelles resteront ce qu’elles sont, des aspirations. En fin de compte, la bourgeoisie recourt à l’une ou l’autre forme dans la mesure où celles-ci s’adaptent le mieux au développement de ses affaires, l’exploitation des travailleurs étant le facteur principal.
Peu importe la forme de gouvernement tant qu’elle garantit l’extraction maximale de plus-value. Nous le répétons : aujourd’hui, cette forme reste la tromperie par le biais de la démocratie bourgeoise. En conclusion, pour répondre à la question précédente : Milei peut être un fasciste dans le sens aspirationnel (c’est-à-dire qu’il aimerait incarner une répression impitoyable du prolétariat si cela ne tenait qu’à lui), mais son régime n’est pas et ne peut être fasciste dans ces conditions. En fait, il éprouve même de sérieuses difficultés à renforcer ses traits autoritaires, comme l’a démontré la marche du samedi 1er février de cette année.
C’est pourquoi, objectivement, la campagne antifasciste n’a qu’un seul objectif : proposer comme alternative un front anti-Milei en vue des élections, blanchissant une fois de plus le capitalisme. En outre, ces forces politiques cherchent à instiller la terreur face à la lutte : comme le fascisme, qui est le pire de la répression, approche, il faut se protéger et attendre le moment opportun, ce moment étant les élections.
Tout cela avec un ajout : comme le fascisme, en tant que tel, doit pouvoir compter sur des secteurs arriérés des masses qui soutiennent ce projet, et que ces secteurs ne s’identifient pas en termes de classes dans le discours progressiste, alors même mon propre collègue de travail est « l’ennemi qui a voté pour le fascisme ». Il s’agit d’un énorme piège politique visant à diviser les travailleurs et à sauver la démocratie bourgeoise comme seule voie possible pour les peuples.
Le marxisme de bureau
Si, d’un côté, les populismes « de droite » se sont levés, de l’autre, les « gauches de droite » font timidement leur apparition : des personnes qui critiquent le progressisme et le réformisme traditionnel, mais sur la base d’un marxisme supposé qui ne résiste pas à la moindre analyse et, surtout, qui ne bouge pas le petit doigt. Cette tendance, qui ne se matérialise dans aucune organisation spécifique (bien qu’il s’agisse en général d’anciens militants de gauche), s’est largement manifestée face à ce « fascisme ». Par rejet du réformisme, ils estiment que la définition du fascisme ne s’applique pas à la période actuelle et qu’il s’agit en réalité d’un mouvement électoral opportuniste. Cependant, ils commettent deux erreurs que nous ne pouvons manquer de mentionner.
Tout d’abord, comme une déformation universitaire classique, ils comprennent le fascisme du point de vue de la « corporation étatique ». Alors, comment Milei peut-il être fasciste s’il est libéral et opposé à l’État ? Ceux qui voient les choses ainsi commettent exactement la même erreur que ceux qui pensent que le projet de la bourgeoisie est le fascisme pour la simple raison que Milei est un réactionnaire et un homophobe invétéré. Ceux qui comprennent ainsi le problème n’ont pas pris une seconde pour réfléchir au fait que la « corporation étatique » de Mussolini correspondait à l’« État interventionniste » de Keynes, qui était la forme économique nécessaire à l’accumulation capitaliste de cette période, et que ce n’est pas l’expression politique ou la volonté individuelle qui détermine le contenu de cette « corporation ».
L’autre point, encore plus important, est la négation des droits politiques conquis par les minorités (femmes, dissidences sexuelles, droits des peuples autochtones). Au cours des dix dernières années, la bourgeoisie a très habilement utilisé les revendications des femmes et de la communauté LGBT pour diviser les travailleurs. Nous ne pouvons nier qu’elle a remporté un succès partiel notable dans ce domaine. Cependant, leurs revendications n’en restent pas moins justes, dans la mesure où elles constituent des revendications pour plus de libertés politiques. La lutte pour plus de libertés politiques est essentielle pour que la classe ouvrière et les secteurs populaires sortent définitivement de leur léthargie, car elle réveille à la vie politique de larges secteurs de la classe et du peuple qui sont confrontés à ces problèmes. Elle unifie la classe ouvrière en éliminant les divisions imposées par la domination de classe (racisme, xénophobie, machisme, etc.). Elle aide la classe ouvrière à comprendre l’importance d’obtenir des libertés politiques dans le domaine du travail, élément essentiel pour qu’elle puisse développer sa conscience. Elle frappe et aggrave la crise politique de la bourgeoisie, faisant vaciller le gouvernement et jetant des milliers de personnes dans les rues, démontrant une fois de plus que, face à la mobilisation massive, le « fascisme » n’existe pas et que le pouvoir du gouvernement n’est pas aussi invincible qu’il aime à le présenter.
C’est pourquoi nous, révolutionnaires, ne pouvons pas tomber dans le piège électoraliste du front antifasciste qui prétend sauver la démocratie bourgeoise pour effrayer les masses, tout comme nous ne pouvons pas boycotter la lutte pour plus de libertés politiques menée par d’importants secteurs du peuple travailleur, même s’ils le font sous des slogans théoriquement erronés et imposés dans la pratique, comme le slogan de l’antifascisme.
Il nous appartient, à nous révolutionnaires, d’alerter et de mener la lutte politique et idéologique contre ces pièges de la bourgeoisie, mais toujours, toujours en nous appuyant sur la lutte des classes, c’est-à-dire sur les intérêts concrets de la classe ouvrière. Et pour notre classe, il n’y a aujourd’hui aucun intérêt plus grand que la lutte pour la liberté politique, la lutte pour pouvoir exprimer librement ses opinions politiques et s’organiser librement.
[1] Ce rapport de forces défavorable ou l’absence d’une direction politique claire ne signifie pas l’absence d’un parti révolutionnaire.