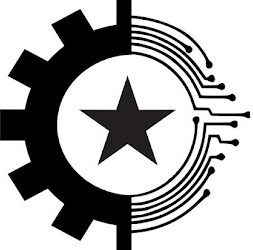micael parenti
En janvier 2026, le marxiste américain Michael Parenti est décédé à l’âge de 92 ans. En souvenir de son engagement tout au long de sa vie, nous présentons ici l’un de ses ouvrages les plus représentatifs et les plus influents.
Note de l’éditeur : En partie opportunisme, en partie arrivisme, en partie déni délibéré (ou ignorance) de la véritable dynamique capitaliste et impérialiste, et en partie attachement au confort d’appartenir au cercle respectable de la critique « permise », l’anticommunisme de gauche continue d’avoir un impact énorme sur la gauche américaine. Dans cet essai exhaustif et incisif, Michael Parenti explore les raisons pour lesquelles la position anticommuniste de gauche doit être considérée pour ce qu’elle est : une collaboration de facto avec les forces qui défendent le statu quo corporatif. [Cette sélection est tirée du livre de Parenti, Blackshirts and Reds: Rational Fascism and the Overthrow of Communism (Luces de la Ciudad, 1997). Reproduit ici avec l’aimable autorisation de l’auteur.] —Patrice Greanville
Cet essai a été publié pour la première fois dans les années 1990 et republié pour la première fois le 23 mai 2015 dans The Greanville Post.
Aux États-Unis, pendant plus de cent ans, les intérêts dominants ont inlassablement propagé l’anticommunisme parmi la population, jusqu’à ce qu’il devienne davantage une orthodoxie religieuse qu’une analyse politique. Pendant la guerre froide, le cadre idéologique anticommuniste pouvait transformer n’importe quelle donnée sur les sociétés communistes existantes en preuve hostile. Si les Soviétiques refusaient de négocier un point, ils étaient intransigeants et belliqueux ; s’ils semblaient prêts à faire des concessions, ce n’était qu’une ruse habile pour prendre les imprudents au dépourvu. En s’opposant aux limitations d’armement, ils auraient démontré leur intention agressive ; mais lorsqu’ils ont en fait soutenu la plupart des traités d’armement, c’était parce qu’ils étaient menteurs et manipulateurs. Si les églises en URSS étaient vides, cela prouvait que la religion était réprimée ; mais si les églises étaient pleines, cela signifiait que le peuple rejetait l’idéologie athée du régime. Si les travailleurs se mettaient en grève (ce qui arrivait rarement), cela prouvait leur aliénation du système collectiviste. S’ils ne se mettaient pas en grève, c’était à cause de l’intimidation et du manque de liberté. La pénurie de biens de consommation démontrait l’échec du système économique ; une amélioration de l’approvisionnement en biens de consommation signifiait simplement que les dirigeants tentaient d’apaiser une population agitée afin de mieux la contrôler. Si les communistes américains ont joué un rôle important dans la lutte pour les droits des travailleurs, des pauvres, des Afro-Américains, des femmes et d’autres groupes, ce n’était qu’une manière astucieuse d’obtenir le soutien des groupes marginalisés et d’accéder au pouvoir. Ils n’ont jamais expliqué comment ils comptaient accéder au pouvoir en luttant pour les droits des groupes défavorisés. Il s’agit d’une orthodoxie infalsifiable, si assidûment promue par les intérêts dominants qu’elle a touché des personnes de tout le spectre politique.
Génuflexion devant l’orthodoxie
Beaucoup, à gauche aux États-Unis, ont mené une attaque contre l’Union soviétique et une persécution des communistes comparable à n’importe quel acte de la droite dans son hostilité et sa cruauté. Écoutez Noam Chomsky parler sans cesse des « intellectuels de gauche » qui tentent « d’accéder au pouvoir aux dépens des mouvements populaires de masse » et « soumettent ensuite le peuple par la force… Vous commencez par être essentiellement un léniniste qui va faire partie de la bureaucratie communiste. Plus tard, vous vous rendez compte que le pouvoir ne réside pas là, et vous devenez rapidement un idéologue de droite… Nous le voyons actuellement dans l'[ancienne] Union soviétique. Ceux-là mêmes qui étaient des voyous communistes il y a deux ans dirigent aujourd’hui des banques, sont des défenseurs enthousiastes du libre marché et font l’éloge des Américains » (Z Magazine, 10/95).
L’imagerie de Chomsky est profondément enracinée dans la même culture politique corporatiste américaine qu’il critique si souvent dans d’autres domaines. Selon lui, la révolution a été trahie par une clique de « voyous communistes » qui convoitaient simplement le pouvoir plutôt que de vouloir le pouvoir pour mettre fin à la faim. En réalité, les communistes ne se sont pas « très rapidement » déplacés vers la droite, mais ont lutté face à une offensive décisive pour maintenir le socialisme soviétique en vie pendant plus de soixante-dix ans. Il est vrai que, dans les derniers jours de l’Union soviétique, certains, comme Boris Eltsine, ont rejoint les rangs des capitalistes, mais d’autres ont continué à résister aux incursions du libre marché, au prix de lourdes pertes pour eux-mêmes, et beaucoup sont morts lors de la violente répression du parlement russe par Eltsine en 1993.
Certains gauchistes et autres recourent au vieux stéréotype des rouges avides de pouvoir qui recherchent le pouvoir pour le pouvoir lui-même, sans se soucier des objectifs sociaux réels. Si cela était vrai, on se demanderait pourquoi, dans un pays après l’autre, ces rouges s’allient aux pauvres et aux démunis, souvent au péril de leur vie et au prix de grands sacrifices, au lieu de récolter les fruits de leur engagement auprès des nantis.
Pendant des décennies, de nombreux écrivains et orateurs de gauche aux États-Unis se sont sentis obligés d’établir leur crédibilité en recourant à la génuflexion anticommuniste et antisoviétique, apparemment incapables de donner une conférence, d’écrire un article ou de critiquer un livre sur un sujet politique quelconque sans y ajouter un commentaire anti-rouge. L’intention était, et reste, de se distancier de la gauche marxiste-léniniste.
Adam Hochschild : Garder ses distances avec la « gauche stalinienne » et recommander la même attitude à ses camarades progressistes.
Adam Hochschild, écrivain et éditeur libéral, a averti ceux qui, à gauche, se montraient indifférents à condamner les sociétés communistes existantes qu’ils « affaiblissaient leur crédibilité » (Guardian, 23/5/84). En d’autres termes, pour être des opposants crédibles à la guerre froide, nous devions d’abord nous joindre aux condamnations de la guerre froide à l’encontre des sociétés communistes. Ronald Radosh a exhorté le mouvement pour la paix à se purger des communistes afin de ne pas être accusé de l’être (Guardian, 16/3/83). Si je comprends bien Radosh : pour nous sauver de la chasse aux sorcières anticommuniste, nous devrions devenir des chasseurs de sorcières. La purge de la gauche des communistes est devenue une pratique bien établie, avec des effets néfastes pour diverses causes progressistes. Par exemple, en 1949, douze syndicats ont été expulsés du CIO pour avoir des communistes à leur tête. Cette purge a réduit le nombre d’adhérents au CIO d’environ 1,7 million et a gravement affaibli ses campagnes de recrutement et son influence politique. À la fin des années 1940, pour éviter d’être « diffamés » comme rouges, les Americans for Democratic Action (ADA), un groupe prétendument progressiste, sont devenus l’une des organisations les plus ouvertement anticommunistes.
Cette stratégie n’a pas fonctionné. L’ADA et d’autres organisations de gauche ont continué à être attaquées par la droite pour être communistes ou intolérantes envers le communisme. À l’époque comme aujourd’hui, beaucoup de gens à gauche n’ont pas compris que ceux qui luttent pour le changement social au nom des secteurs les moins privilégiés de la société seront victimes de harcèlement communiste de la part des élites conservatrices, qu’ils soient communistes ou non. Pour les intérêts dominants, peu importe que leur richesse et leur pouvoir soient remis en cause par des « communistes subversifs » ou des « libéraux américains loyaux ». Tous sont regroupés comme étant plus ou moins également odieux.
Même lorsqu’ils attaquent la droite, les critiques de gauche ne peuvent s’empêcher de montrer leurs références anticommunistes. Ainsi, Mark Green écrit dans une critique du président Ronald Reagan que « lorsqu’il est confronté à une situation qui remet en cause son catéchisme conservateur, en tant que marxiste-léniniste invétéré, [Reagan] ne change pas d’avis, mais les faits ». Tout en professant leur engagement dans la lutte contre le dogmatisme « tant de droite que de gauche », ceux qui se livrent à ces génuflexions de rigueur renforcent le dogme anticommuniste. Les anticommunistes de gauche ont contribué au climat d’hostilité qui a donné aux dirigeants américains une telle liberté pour mener des guerres chaudes et froides contre les pays communistes, et qui, même aujourd’hui, rend difficile la promotion d’un programme progressiste ou même libéral.
George Orwell était un prototype d’anticommuniste qui se faisait passer pour un homme de gauche. En pleine Seconde Guerre mondiale, alors que l’Union soviétique luttait pour sa survie contre les envahisseurs nazis à Stalingrad, Orwell déclarait que « la volonté de critiquer la Russie et Staline est la preuve de l’honnêteté intellectuelle. C’est la seule chose qui, du point de vue d’un intellectuel littéraire, soit vraiment dangereuse » (Monthly Review, 5/83). Retranché dans une société virulemment anticommuniste, Orwell (avec sa double pensée orwellienne) a présenté la condamnation du communisme comme un acte de défi solitaire et courageux. Aujourd’hui, sa progéniture idéologique est toujours là, se présentant comme des critiques intrépides de la gauche, menant un combat courageux contre les hordes imaginaires marxistes-léninistes-staliniennes.
Au sein de la gauche américaine, toute évaluation rationnelle de l’Union soviétique, une nation qui a subi une longue guerre civile et une invasion étrangère multinationale au cours de ses premières années d’existence, et qui, deux décennies plus tard, a repoussé et détruit la bête nazie au prix d’énormes sacrifices, fait cruellement défaut. Au cours des trois décennies qui ont suivi la révolution bolchevique, les Soviétiques ont réalisé des progrès industriels équivalents à ceux que le capitalisme a mis un siècle à accomplir, tout en nourrissant et en éduquant leurs enfants au lieu de les faire travailler quatorze heures par jour, comme le faisaient et continuent de le faire les industriels capitalistes dans de nombreuses régions du monde. Et l’Union soviétique, avec la Bulgarie, la République démocratique allemande et Cuba, a apporté une aide vitale aux mouvements de libération nationale dans des pays du monde entier, y compris l’African National Congress de Nelson Mandela en Afrique du Sud.
Les anticommunistes de gauche sont restés délibérément indifférents aux progrès spectaculaires réalisés par les masses auparavant appauvries sous le communisme. Certains les ont même méprisés. Je me souviens comment, à Burlington, dans le Vermont, en 1971, le célèbre anarchiste anticommuniste Murray Bookchin a fait référence avec dédain à ma préoccupation pour « les pauvres enfants qui ont été nourris sous le communisme » (selon ses propres termes).
Étiquettes à accrocher
Ceux d’entre nous qui refusaient de se joindre aux attaques contre l’Union soviétique étaient qualifiés de « défenseurs soviétiques » et de « staliniens » par les anticommunistes de gauche, même si nous détestions Staline et son système de gouvernement autocratique et pensions que la société soviétique existante avait de graves problèmes. Notre véritable péché était que, contrairement à beaucoup de gens de gauche, nous refusions d’accepter sans critique la propagande des médias américains sur les sociétés communistes. Au contraire, nous soutenions que, outre les lacunes et les injustices largement médiatisées, il existait des aspects positifs des systèmes communistes existants qui méritaient d’être préservés, qui amélioraient la vie de centaines de millions de personnes de manière significative et humanisante. Cette affirmation a eu un effet décidément dérangeant sur les anticommunistes de gauche, qui ne pouvaient prononcer un seul mot positif sur aucune société communiste (à l’exception peut-être de Cuba) ni prêter attention, même poliment, à ceux qui le faisaient.
Saturés par l’orthodoxie anticommuniste, la plupart des gauchistes américains ont pratiqué un maccarthysme de gauche à l’encontre de ceux qui avaient quelque chose de positif à dire sur le communisme existant, les excluant des conférences, des conseils consultatifs, des soutiens politiques et des publications de gauche. Tout comme les conservateurs, les anticommunistes de gauche n’ont toléré rien de moins qu’une condamnation généralisée de l’Union soviétique comme une monstruosité stalinienne et une aberration morale léniniste.
La connaissance limitée que beaucoup de gauchistes américains ont des écrits et de l’œuvre politique de Lénine ne les empêche pas de les qualifier de « léninistes ». Noam Chomsky, source inépuisable de caricatures anticommunistes, commente ainsi le léninisme : « Les intellectuels occidentaux, mais aussi ceux du tiers monde, ont été attirés par la contre-révolution bolchevique parce que, après tout, le léninisme est une doctrine qui affirme que l’intelligentsia radicale a le droit de prendre le pouvoir et de gouverner ses pays par la force, une idée assez séduisante pour les intellectuels ». Chomsky crée ici une image d’intellectuels avides de pouvoir qui complète sa caricature des léninistes avides de pouvoir, des méchants qui ne recherchent pas les moyens révolutionnaires de combattre l’injustice, mais le pouvoir pour le pouvoir. En matière de critique anticommuniste, certains des meilleurs et des plus brillants de la gauche ne sont guère meilleurs que les pires de la droite.
Lors de l’attentat terroriste de 1996 à Oklahoma City, j’ai entendu un commentateur radio déclarer : « Lénine a dit que le but de la terreur est de terroriser ». Les commentateurs des médias américains ont maintes fois cité Lénine de manière trompeuse. En réalité, sa déclaration désapprouvait le terrorisme. Il s’opposait aux actes terroristes isolés qui ne font que semer la terreur parmi la population, inciter à la répression et isoler le mouvement révolutionnaire des masses. Loin d’être un conspirateur totalitaire et fermé, Lénine appelait à la construction de larges coalitions et d’organisations de masse, englobant des personnes ayant différents niveaux de développement politique. Il préconisait tous les moyens nécessaires pour faire avancer la lutte des classes, y compris la participation aux élections parlementaires et aux syndicats existants. Il ne fait aucun doute que la classe ouvrière, comme tout groupe de masse, avait besoin d’organisation et de direction pour mener une lutte révolutionnaire couronnée de succès, ce qui était le rôle d’un parti d’avant-garde, mais cela ne signifiait pas que la révolution prolétarienne pouvait être menée et gagnée par des putschistes ou des terroristes.
Lénine a constamment abordé le problème d’éviter les deux extrêmes : l’opportunisme bourgeois libéral et l’aventurisme d’extrême gauche. Cependant, la presse générale et certains secteurs de la gauche l’identifient à plusieurs reprises comme un putschiste d’extrême gauche. [Chris Hedges, en particulier, l’a souvent accusé d’avoir « détourné la révolution », quoi que cela puisse signifier]. La question de savoir si l’approche de Lénine sur la révolution est souhaitable ou même pertinente aujourd’hui mérite une analyse critique. Mais il est peu probable que ceux qui déforment sa théorie et sa pratique parviennent à une évaluation utile.
Les anticommunistes de gauche considèrent comme moralement inacceptable toute association avec des organisations communistes en raison des « crimes du communisme ». Pourtant, beaucoup d’entre eux sont associés au Parti démocrate dans ce pays, que ce soit en tant qu’électeurs ou membres, apparemment indifférents aux crimes politiques moralement inacceptables commis par les dirigeants de cette organisation. Sous l’une ou l’autre administration démocrate, 120 000 Américains d’origine japonaise ont été arrachés à leurs foyers et à leurs moyens de subsistance et jetés dans des camps de détention ; des bombes atomiques ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, causant d’énormes pertes en vies innocentes ; le FBI a reçu le pouvoir d’infiltrer des groupes politiques ; la loi Smith a été utilisée pour emprisonner les dirigeants du Parti socialiste des travailleurs trotskiste, puis les dirigeants du Parti communiste pour leurs convictions politiques ; des camps de détention ont été créés pour enfermer les dissidents politiques en cas d’« urgence nationale ». À la fin des années 1940 et 1950, huit mille employés fédéraux ont été expulsés du gouvernement en raison de leurs affiliations et opinions politiques, et des milliers d’autres, dans tous les domaines de la vie, ont été persécutés et expulsés de leur carrière. La loi sur la neutralité a été utilisée pour imposer un embargo à la République espagnole, ce qui a favorisé les légions fascistes de Franco ; des programmes meurtriers de contre-insurrection ont été lancés dans plusieurs pays du tiers monde ; et la guerre du Vietnam s’est poursuivie et intensifiée. Pendant près d’un siècle, la direction du Parti démocrate au Congrès a protégé la ségrégation raciale et bloqué tous les projets de loi contre les lynchages et en faveur de l’emploi équitable. Cependant, tous ces crimes, qui ont causé la ruine et la mort de nombreuses personnes, n’ont pas incité les libéraux, les sociaux-démocrates et les anticommunistes « sociaux-démocrates » à insister à plusieurs reprises pour que nous condamnions catégoriquement le Parti démocrate ou le système politique qui l’a engendré, et encore moins avec la ferveur intolérante qui a été dirigée contre le communisme existant.
Socialisme pur contre socialisme de siège
Les bouleversements en Europe de l’Est n’ont pas constitué une défaite pour le socialisme, car celui-ci n’a jamais existé dans ces pays, selon certains gauchistes américains. Ils affirment que les États communistes n’offraient rien d’autre qu’un « capitalisme d’État » bureaucratique et à parti unique ou quelque chose de similaire. Le fait que nous qualifiions les anciens pays communistes de « socialistes » est une question de définition. Il suffit de dire qu’ils constituaient quelque chose de différent de ce qui existait dans le monde capitaliste axé sur le profit, comme les capitalistes eux-mêmes ne tardèrent pas à le reconnaître.
Tout d’abord, les inégalités économiques étaient moins importantes dans les pays communistes que dans le capitalisme. Les avantages dont bénéficiaient les élites du parti et du gouvernement étaient modestes par rapport aux normes des dirigeants d’entreprise occidentaux [et encore plus si on les compare aux rémunérations grotesques dont bénéficient aujourd’hui les élites dirigeantes et financières — NDLR], tout comme leurs revenus et leurs modes de vie personnels. Les dirigeants soviétiques tels que Youri Andropov et Leonid Brejnev ne vivaient pas dans des demeures luxueusement décorées comme la Maison Blanche, mais dans des appartements relativement spacieux situés dans un complexe résidentiel près du Kremlin, réservé aux dirigeants gouvernementaux. Ils disposaient de limousines (comme la plupart des chefs d’État) et avaient accès à de grandes datchas où ils recevaient les dignitaires en visite. Mais ils ne possédaient pas l’immense fortune personnelle dont disposent la plupart des dirigeants américains. {Ils ne pouvaient pas non plus transférer cette « richesse » par héritage ou donation à leurs amis et à leur famille, comme c’est souvent le cas pour les magnats occidentaux et les dirigeants politiques fortunés. Il suffit de voir Tony Blair. —Eds]
La « vie luxueuse » dont jouissaient les dirigeants du parti en Allemagne de l’Est, largement médiatisée dans la presse américaine, comprenait une allocation annuelle de 725 dollars en devises étrangères et un logement dans un quartier chic à la périphérie de Berlin, équipé d’un sauna, d’une piscine couverte et d’une salle de sport commune. Ils pouvaient également faire leurs achats dans des magasins vendant des produits occidentaux tels que des bananes, des jeans et des appareils électroniques japonais. La presse américaine n’a jamais mentionné que les Allemands de l’Est ordinaires avaient accès à des piscines et des salles de sport publiques et pouvaient acheter des jeans et des appareils électroniques (bien que ceux-ci ne soient généralement pas importés). La consommation « luxueuse » des dirigeants est-allemands ne contrastait pas non plus avec le mode de vie véritablement opulent de la ploutocratie occidentale.
Deuxièmement, dans les pays communistes, les forces productives n’étaient pas organisées pour le profit du capital et l’enrichissement privé ; la propriété publique des moyens de production remplaçait la propriété privée. Les gens ne pouvaient pas embaucher d’autres personnes ni accumuler une grande richesse personnelle grâce à leur travail. Là encore, par rapport aux normes occidentales, les écarts de revenus et d’épargne entre la population étaient généralement modestes. L’écart de revenus entre les plus riches et les plus pauvres en Union soviétique était d’environ cinq pour un. Aux États-Unis, l’écart de revenus annuels entre les multimillionnaires les plus riches et les travailleurs pauvres est d’environ 10 000 pour un.
Troisièmement, la priorité était donnée à l’aide sociale. Si la vie sous le communisme laissait beaucoup à désirer et que les services eux-mêmes étaient rarement les meilleurs, les pays communistes garantissaient à leurs citoyens un niveau minimum de survie économique et de sécurité, qui comprenait l’éducation, l’emploi, le logement et les soins médicaux.
Quatrièmement, les pays communistes ne cherchaient pas à pénétrer le capital d’autres pays. N’étant pas motivés par le profit et n’ayant donc pas besoin de rechercher constamment de nouvelles opportunités d’investissement, ils n’ont pas exproprié les terres, la main-d’œuvre, les marchés ou les ressources naturelles des nations les plus faibles ; en d’autres termes, ils n’ont pas pratiqué l’impérialisme économique. L’Union soviétique a entretenu des relations commerciales et d’aide généralement favorables aux nations d’Europe de l’Est, à la Mongolie, à Cuba et à l’Inde.
Tous ces éléments étaient, dans une plus ou moins grande mesure, les principes directeurs de tout système communiste. Aucun d’entre eux ne s’applique à des pays à économie de marché tels que le Honduras, le Guatemala, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Chili, l’Indonésie, le Zaïre, l’Allemagne ou les États-Unis.
Mais on fait valoir qu’un socialisme réel serait contrôlé par les travailleurs eux-mêmes grâce à leur participation directe, plutôt que dirigé par des léninistes, des staliniens, des castristes ou d’autres cliques malveillantes, avides de pouvoir et bureaucratiques qui trahissent les révolutions. Malheureusement, cette vision du « socialisme pur » est ahistorique et infalsifiable ; elle ne peut être confrontée aux réalités de l’histoire. Elle compare un idéal à une réalité imparfaite, et la réalité passe au second plan. Elle imagine ce que serait le socialisme dans un monde bien meilleur que celui-ci, où aucune structure étatique solide ni aucune force de sécurité ne serait nécessaire, où il ne serait pas nécessaire d’exproprier la valeur produite par les travailleurs pour reconstruire la société et la défendre contre l’invasion et le sabotage interne.
Les anticipations idéologiques des socialistes purs ne sont pas affectées par la pratique actuelle. Ils n’expliquent pas comment les multiples fonctions d’une société révolutionnaire seraient organisées, comment les attaques extérieures et le sabotage interne seraient contrés, comment la bureaucratie serait évitée, comment les ressources limitées seraient allouées, comment les différends politiques seraient résolus, comment les priorités seraient établies et comment la production et la distribution seraient gérées. Au lieu de cela, ils se contentent de déclarations vagues sur la manière dont les travailleurs eux-mêmes posséderont et contrôleront directement les moyens de production et parviendront à leurs propres solutions grâce à une lutte créative. Il n’est donc pas surprenant que les socialistes purs soutiennent toutes les révolutions, sauf celles qui aboutissent.
Les socialistes purs avaient la vision d’une nouvelle société qui créerait et serait créée par de nouvelles personnes, une société si transformée dans ses fondements qu’elle laisserait peu de place aux actes illicites, à la corruption et aux abus criminels du pouvoir étatique. Il n’y aurait ni bureaucratie ni cliques égoïstes, ni conflits impitoyables ni décisions préjudiciables. Lorsque la réalité s’avère différente et plus difficile, certains à gauche condamnent la réalité et annoncent qu’ils se sentent trahis par telle ou telle révolution.
Les socialistes purs considèrent le socialisme comme un idéal terni par la vénalité, la duplicité et la soif de pouvoir des communistes. Ils s’opposent au modèle soviétique, mais apportent peu de preuves démontrant que d’autres voies auraient pu être empruntées, que d’autres modèles de socialisme – non créés par l’imagination, mais développés à travers l’expérience historique – auraient pu s’enraciner et mieux fonctionner. Un socialisme ouvert, pluraliste et démocratique était-il vraiment possible à ce moment de l’histoire ? Les preuves historiques suggèrent que non. Comme l’a fait valoir le philosophe politique Carl Shames :
Comment [les critiques de gauche] savent-ils que le problème fondamental était la « nature » des partis [révolutionnaires] au pouvoir et non, par exemple, la concentration mondiale du capital qui détruit toutes les économies indépendantes et met fin à la souveraineté nationale partout dans le monde ? Et, dans ce cas, d’où venait cette « nature » ? Était-elle désincarnée, déconnectée du tissu social, des relations sociales qui l’influençaient ? … On pourrait trouver des milliers d’exemples où la centralisation du pouvoir était une option nécessaire pour garantir et protéger les relations socialistes. D’après mon observation [des sociétés communistes existantes], les aspects positifs du « socialisme » et les aspects négatifs de la « bureaucratie, de l’autoritarisme et de la tyrannie » s’entremêlaient dans pratiquement tous les domaines de la vie. (Carl Shames, correspondance adressée à moi-même, 15/1/92).
Les socialistes purs et durs reprochent régulièrement à la gauche elle-même chaque défaite qu’elle subit. Leurs doutes sont sans fin. Ainsi, nous entendons dire que les luttes révolutionnaires échouent parce que leurs dirigeants attendent trop ou agissent trop tôt, sont trop timides ou trop impulsifs, trop têtus ou trop influençables. Nous entendons dire que les dirigeants révolutionnaires sont conciliants ou aventuriers, bureaucratiques ou opportunistes, rigoureusement organisés ou insuffisamment organisés, antidémocratiques ou incapables d’assurer un leadership fort. Mais les dirigeants échouent toujours parce qu’ils ne font pas confiance aux « actions directes » des travailleurs, qui, apparemment, résisteraient et surmonteraient toutes les adversités si seulement on leur donnait le type de leadership disponible dans le petit groupe du critique de gauche. Malheureusement, les critiques semblent incapables d’utiliser leur propre talent de leadership pour produire un mouvement révolutionnaire réussi dans leur propre pays.
Tony Febbo a remis en question ce syndrome qui consiste à blâmer les dirigeants des socialistes purs :
Il me semble que lorsque des personnes aussi intelligentes, différentes, dévouées et héroïques que Lénine, Mao, Fidel Castro, Daniel Ortega, Ho Chi Minh et Robert Mugabe — et les millions de héros qui les ont suivis et ont lutté à leurs côtés — finissent plus ou moins au même endroit, alors il y a quelque chose de plus important en jeu que la question de savoir qui a pris telle décision lors de telle réunion. Ou même la taille des maisons dans lesquelles ils sont retournés après la réunion…
Ces dirigeants ne vivaient pas dans le vide. Ils vivaient dans un tourbillon. Et la force d’attraction, la puissance qui les faisait tourner a déchiré ce monde pendant plus de 900 ans. Et blâmer telle ou telle théorie, tel ou tel dirigeant, est un substitut simpliste au type d’analyse que les marxistes [devraient faire]. » (The Guardian, 13/11/91)
Il ne fait aucun doute que les socialistes purs ne manquent pas complètement de programmes spécifiques pour construire la révolution. Après le renversement de la dictature de Somoza par les sandinistes au Nicaragua, un groupe d’extrême gauche de ce pays a exigé la propriété directe des usines par les travailleurs. Les travailleurs armés prendraient le contrôle de la production sans l’aide de gestionnaires, de planificateurs étatiques, de bureaucrates ou d’une armée formelle. Bien que cela soit indéniablement séduisant, ce syndicalisme ouvrier nie les besoins du pouvoir étatique. Dans le cadre d’un tel accord, la révolution nicaraguayenne n’aurait pas duré plus de deux mois face à la contre-révolution soutenue par les États-Unis qui a ravagé le pays. Elle n’aurait pas pu mobiliser suffisamment de ressources pour déployer une armée, prendre des mesures de sécurité et développer et coordonner des programmes économiques et sociaux à l’échelle nationale.
Décentralisation ou survie
Pour qu’une révolution populaire survive, elle doit prendre le pouvoir étatique et l’utiliser pour (a) briser le contrôle que la classe dominante exerce sur les institutions et les ressources de la société, et (b) résister à la contre-attaque réactionnaire qui ne manquera pas de se produire. Les dangers internes et externes auxquels est confrontée une révolution exigent un pouvoir étatique centralisé qui ne plaît à personne, ni dans la Russie soviétique de 1917 ni dans le Nicaragua sandiniste de 1980.
Engels offre un récit pertinent d’un soulèvement en Espagne entre 1872 et 1873, au cours duquel les anarchistes ont pris le pouvoir dans des municipalités à travers tout le pays. Au début, la situation semblait prometteuse. Le roi avait abdiqué et le gouvernement bourgeois ne disposait que de quelques milliers de soldats mal entraînés. Cependant, cette force désorganisée a prévalu parce qu’elle était confrontée à une rébellion entièrement provinciale. « Chaque ville s’est autoproclamée canton souverain et a établi une junte révolutionnaire », écrit Engels. « Chaque ville a agi de son côté, déclarant que l’important n’était pas la coopération avec les autres villes, mais la séparation d’avec elles, écartant ainsi toute possibilité d’attaque conjointe [contre les forces bourgeoises]. » C’est « la fragmentation et l’isolement des forces révolutionnaires qui ont permis aux troupes gouvernementales d’écraser une révolte après l’autre ».
L’autonomie paroissiale décentralisée est le cimetière de l’insurrection, ce qui pourrait être l’une des raisons pour lesquelles il n’y a jamais eu de révolution anarcho-syndicaliste réussie. Idéalement, il serait souhaitable de ne compter que sur la participation locale et autogérée des travailleurs, avec un minimum de bureaucratie, de police et d’armée. Ce serait probablement ainsi que se développerait le socialisme, s’il pouvait se développer sans les obstacles de la subversion et des attaques contre-révolutionnaires. Il convient de rappeler qu’entre 1918 et 1920, quatorze nations capitalistes, dont les États-Unis, ont envahi la Russie soviétique dans une tentative sanglante mais infructueuse de renverser le gouvernement révolutionnaire bolchevique. Les années d’invasion étrangère et de guerre civile ont considérablement intensifié la mentalité de siège des bolcheviks, avec leur attachement à l’unité du parti et à un appareil de sécurité répressif. Ainsi, en mai 1921, le même Lénine qui avait promu la démocratie interne du parti et lutté contre Trotsky pour accorder une plus grande autonomie aux syndicats, exigeait désormais la fin de l’Opposition ouvrière et d’autres groupes factionnels au sein du parti. « Le moment est venu », déclara-t-il devant un Xe Congrès du Parti qui l’acclama avec enthousiasme, « de mettre fin à l’opposition, de la freiner : nous avons eu assez d’opposition ». Les communistes conclurent que les disputes ouvertes et les tendances contradictoires au sein et à l’extérieur du parti créaient une apparence de division et de faiblesse qui invitait à l’attaque de redoutables adversaires.
À peine un mois auparavant, en avril 1921, Lénine avait réclamé une plus grande représentation ouvrière au sein du Comité central du parti. En résumé, il était devenu non pas anti-ouvrier, mais anti-opposition. Il s’agissait d’une révolution sociale — comme toute autre — qui n’était pas autorisée à se développer librement sur le plan politique et matériel.
À la fin des années 1920, les Soviétiques ont été confrontés au choix suivant : (a) s’engager dans une voie encore plus centralisée, avec une économie dirigée, une collectivisation agricole forcée et une industrialisation à toute vitesse sous la direction autocratique et autoritaire du parti, voie choisie par Staline, ou (b) s’engager dans une voie libérale, permettant une plus grande diversité politique, une plus grande autonomie pour les syndicats et autres organisations, un débat et une critique plus ouverts, une plus grande autonomie entre les différentes républiques soviétiques, un secteur de petites entreprises privées, un développement agricole indépendant par la paysannerie, un accent plus important sur les biens de consommation et moins d’efforts consacrés au type d’accumulation de capital nécessaire pour construire une base militaro-industrielle forte.
Cette dernière option, je pense, aurait donné naissance à une société plus confortable, plus humaine et plus serviable. Le socialisme de siège aurait cédé la place au socialisme ouvrier-consommateur. Le seul problème est que le pays aurait risqué de ne pas pouvoir résister à l’assaut nazi. Au lieu de cela, l’Union soviétique s’est lancée dans une industrialisation rigoureuse et forcée. Cette politique a souvent été mentionnée comme l’un des torts causés par Staline à son peuple. Elle consistait principalement à construire, en une décennie, une énorme base industrielle entièrement nouvelle à l’est de l’Oural, au milieu des steppes arides, le plus grand complexe sidérurgique d’Europe, en prévision d’une invasion occidentale. « L’argent a été dépensé comme de l’eau, les hommes ont gelé, ont souffert de la faim et ont enduré des souffrances, mais la construction s’est poursuivie avec un mépris pour les personnes et un héroïsme collectif rarement vus dans l’histoire ».
La prophétie de Staline selon laquelle l’Union soviétique n’avait que dix ans pour répéter ce que les Britanniques avaient accompli en un siècle s’est avérée vraie. Lorsque les nazis ont envahi l’URSS en 1941, cette même base industrielle, retranchée à des milliers de kilomètres du front, a produit les armes de guerre qui ont finalement changé le cours de la guerre. Le prix de cette survie a été la mort de 22 millions de Soviétiques pendant la guerre et une dévastation et des souffrances incommensurables, dont les effets ont perturbé la société soviétique pendant des décennies.
Tout cela ne signifie pas que tout ce que Staline a fait était une nécessité historique. Les exigences de la survie révolutionnaire ne rendaient pas inévitables l’exécution impitoyable de centaines d’anciens dirigeants bolcheviques, le culte de la personnalité d’un leader suprême qui s’attribuait chaque réussite révolutionnaire, la suppression de la vie politique partisane par la terreur, le silence éventuel du débat sur le rythme de l’industrialisation et de la collectivisation, la régulation idéologique de toute la vie intellectuelle et culturelle, et les déportations massives de nationalités suspectes.
Les effets transformateurs de l’attaque contre-révolutionnaire se sont fait sentir dans d’autres pays. Une officière militaire sandiniste que j’ai rencontrée à Vienne en 1986 a souligné que les Nicaraguayens n’étaient pas un peuple guerrier, mais qu’ils avaient dû apprendre à se battre parce qu’ils étaient confrontés à une guerre mercenaire destructrice soutenue par les États-Unis. Elle a regretté que la guerre et l’embargo aient contraint son pays à reporter une grande partie de son programme socio-économique. Comme au Nicaragua, au Mozambique, en Angola et dans de nombreux autres pays où des forces mercenaires financées par les États-Unis ont détruit des terres agricoles, des villages, des centres de santé et des centrales électriques, tout en tuant ou en laissant mourir de faim des centaines de milliers de personnes : le bébé révolutionnaire a été étranglé dans son berceau ou saigné sans pitié jusqu’à devenir méconnaissable. Cette réalité devrait mériter au moins autant de reconnaissance que la répression des dissidents dans telle ou telle société révolutionnaire.
Le renversement des gouvernements communistes d’Europe de l’Est et de l’Union soviétique a été applaudi par de nombreux intellectuels de gauche. La démocratie allait enfin avoir son heure de gloire. Le peuple serait libéré du joug du communisme et la gauche américaine serait libérée du fardeau du communisme existant, ou comme l’a exprimé le théoricien de gauche Richard Lichtman, « libérée de l’incube de l’Union soviétique et du succube de la Chine communiste ».
En fait, la restauration capitaliste en Europe de l’Est a sérieusement affaibli les nombreuses luttes de libération du tiers monde qui avaient reçu l’aide de l’Union soviétique et a donné naissance à toute une nouvelle génération de gouvernements de droite qui travaillaient désormais en étroite collaboration avec les contre-révolutionnaires mondiaux des États-Unis à travers le monde.
De plus, le renversement du communisme a donné le feu vert aux pulsions exploiteuses effrénées des intérêts corporatifs occidentaux. N’ayant plus à convaincre les travailleurs qu’ils vivent mieux que leurs homologues russes, n’étant plus limitée par un système concurrentiel, la classe corporative est en train de renverser les nombreuses conquêtes que les travailleurs ont obtenues au fil des ans. Maintenant que le libre marché, dans sa forme la plus vile, émerge triomphant en Orient, il prévaudra également en Occident. Le « capitalisme à visage humain » est en train d’être remplacé par le « capitalisme en pleine face ». Comme l’a dit Richard Levins : « Ainsi, dans la nouvelle agressivité exubérante du capitalisme mondial, nous voyons ce que les communistes et leurs alliés avaient maintenu à distance » (Monthly Review, 9/96).
N’ayant jamais compris le rôle joué par les puissances communistes existantes dans la modération des pires pulsions du capitalisme occidental, et percevant le communisme comme un simple mal absolu, les anticommunistes de gauche n’ont pas anticipé les pertes à venir. Certains d’entre eux ne le comprennent toujours pas.