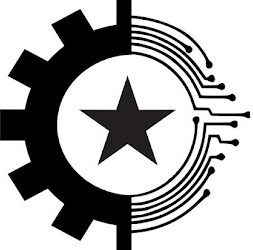supernova n.3 2023
Les formes de luttes des quartiers populaires en France depuis les années 1970 sont diverses et possèdent une profondeur historique qui ne peut pas être niée. L’appellation elle-même de « quartiers populaires » est certes sujette à caution (comme d’ailleurs tout ce qui touche aux secteurs opprimés d’une société), et si on veut clarifier, il est sûrement préférable de reprendre les termes employés par certains dans la génération de militants des années 1980 qui voulaient porter la voix et les aspirations des « cités ouvrières de l’immigration », la dimension de classe et la spécificité immigrée étant imbriquées sans se confondre totalement. Quoi qu’il en soit, le bilan politique des luttes qui ont comme base sociale les cités est nécessaire, au-delà du témoignage et des indispensables chronologies. Il n’a été produit que partiellement par les acteurs de ces luttes1. C’est une grande tâche qui reste encore à réaliser. Bien sûr, on lit toujours le passé par le prisme des perspectives présentes. Or, les lectures actuelles de ces luttes passées apparaissent comme dominées par des approches libérales qui concluent que le sens historique des luttes des dominés dans les quartiers est au final une lutte des places sociales à négocier (qu’elle soit celle de l’idée limitée d’une « lutte pour la reconnaissance » et d’intégration dans cette société, dans le pire des cas un simple marchepied individuel2, ou la même idée, sous d’autres atours, c’est-à-dire sa version racialiste d’une affirmation d’une identité noire et/ou arabe sous la forme d’un lobby ou qui serait porteuse en elle-même d’une « radicalité »3). En fait, on ne peut pas nier la pertinence même partielle de cette optique, du moins en ce qui concerne les stratégies de survie de vies broyées d’une part et d’autre part les ambitions d’ascension sociale de franges intellectuelles marginales qui n’ont pas de place au soleil de la République.
Les enjeux essentiels ne sont pourtant pas là à nos yeux. Notre perspective, que nous ne pouvons qu’ébaucher ici, est qu’un bilan des luttes des cités doit comprendre qu’il s’agit avant tout d’une histoire des combats d’une partie du prolétariat multiracial de France, et qui comme d’autres formes de la lutte de classe sont confrontées à leurs perspectives réformistes ou révolutionnaires. La question principale à laquelle on doit s’atteler est donc de savoir en quoi l’histoire des luttes des « banlieues » a contribué et peut contribuer ou non à la formation d’une force autonome du prolétariat, seule réalité politique capable de remettre en cause les rapports sociaux dominants. Tout ce qui a servi et peut servir à construire cette autonomie politique est un patrimoine commun pour le prolétariat d’ici et d’ailleurs. Il se trouve que l’ancien mouvement ouvrier et ses représentants politiques qui participent à la démocratie représentative bourgeoise ont pour l’essentiel instrumentalisé, ignoré et parfois combattu les formes de luttes issus des cités. C’est une des raisons pour lesquelles les luttes de « banlieue » sont et ont toujours été dans une relation complexe de liaison et de distinction avec les autres luttes revendicatives du prolétariat. C’est à la fois leur force et souvent leurs limites. Pour l’essentiel, ces luttes, malgré toutes leurs limites et contradictions, ont ouvert la voie à ce que pourrait être une véritable force révolutionnaire au sein des métropoles. C’est leur aspect principal et sous cet angle, nous ne regardons pas cette histoire comme une longue litanie d’échecs, d’impuissance et de déceptions. Tout l’enjeu de ces luttes et de leur avenir se joue précisément selon nous dans cette relation avec l’ensemble du prolétariat et dans son potentiel révolutionnaire. Dans le cas de l’histoire des luttes dont nous parlons ici, la question à laquelle une grande partie du « peuple des cités » a du faire face depuis les années 1970, c’est le procès d’illégitimité de la présence des immigrés et de leurs enfants sur le territoire national. De cette situation première découle ceux orientations possibles : 1) celle qui limite les luttes à cette dimension (« nous sommes légitimes dans ce pays ») et donc qui se limite à une place reconnue dans le système de domination du capital. 2) celle qui ne se limite pas à une demande d’être exploité et dominé comme les autres « citoyens » mais qui vise le changement des rapports sociaux et des hiérarchies que ces rapports créent chaque jour. Marx affirmait ainsi que la classe ouvrière était révolutionnaire ou qu’elle n’était rien. Autrement dit, l’existence politique n’a de sens qu’à travers une position stratégique prise sur ce qu’est le système social dans lequel nous vivons, c’est-à-dire le système capitaliste-impérialiste. Mais tout l’art « subtil » de la lutte politique autonome par rapport aux forces bourgeoises est de relier les milles et unes luttes et formes de résistance concrètes à un affrontement global.
Essayons de parcourir de façon brève et nécessairement très allusive, des jalons des luttes des cités ouvrières de l’immigration. On peut afin de mieux se repérer, et malgré un découpage en partie arbitraire, distinguer trois périodes de luttes distinctes mais reliées entre elles : 1) Les années 1960 et 1970, qui sont celles des bidonvilles, des premiers grands ensembles, des OS et des luttes des travailleurs immigrés en particulier des prolétaires venus d’Afrique. 2) Une deuxième période est celle des enfants de ces travailleurs qui autour des différentes « marches pour l’égalité » au début des années 1980 ont tenté de s’organiser comme force sociale et politique à l’échelle nationale, en particulier dans les années 1990. 3) Enfin, la période qui suit les révoltes des cités de novembre 2005 jusqu’aujourd’hui dans laquelle la psychose française contre les cités est devenue une norme de la scène politique bourgeoise, alors qu’une réponse par « en bas », autoorganisée et venant directement des quartiers, peine à exister et cherche encore sa voie.
Parmi toutes les luttes de la première période, deux expériences d’auto-organisation sont particulièrement marquantes : celles du MTA (Mouvement des Travailleurs Arabes) et la lutte des foyers SONACOTRA4. Le MTA n’est pas un mouvement issu des quartiers populaires mais son histoire va marquer les générations militantes suivantes et ses membres vont à travers le journal Sans Fontière transmettre une vision et un savoir-faire de luttes aux « jeunes immigrés » des années 1980.
Impulsé suite aux Comités Palestine et proche de la Gauche prolétarienne (maoïste), Le MTA est créé en 1972 par des militants arabes et français. Le MTA va principalement organiser au quotidien les OS (ouvriers spécialisés immigrés) et lancer une grève contre le racisme en septembre 1973. Son existence suffit à tordre le cou à l’image de pères ouvriers qui courbaient l’échine et se rendaient volontairement invisibles dans l’espace public. Dès ces années les questions qui vont être celles des générations suivantes sont déjà présentes : crimes policiers et racistes, logements insalubres question des titres de séjour et du statut juridique, solidarité avec le mouvement de résistance en Palestine5. Outre les revendications, le second leg du MTA sera une expérience de l’autonomie, une autonomie qui est une réponse au fait que leur statut juridique les empêche de participer pleinement à la vie syndicale et politique (selon une frontière national/étranger) mais aussi aux faiblesses d’un monde syndical ne prend pas en compte les revendications spécifiques des travailleurs immigrés et qui arrête sa lutte aux portes des usines. La notion d’autonomie est celle que les décisions doivent être prises par les premiers concernés, ce qui ne signifie pas la fin de la lutte commune dans les comités d’atelier. On peut voir qu’existe déjà et toujours la question de l’articulation entre la condition de l’immigré issu des colonies et celle de l’exploitation commune, c’est une détermination concrète de la situation de classe et non une lubie « identitaire ». Cette lutte du MTA fait aussi reculer le « mythe du retour » et pose donc la question de l’installation durable en France. La grève contre le racisme de 1973 est une action inédite en France puisqu’il s’agit de mobiliser les usines sur des questions qui se jouent en dehors de l’usine, à la suite d’assassinats de travailleurs arabes et de jeunes, la région de Marseille étant particulièrement touchée par le phénomène. Cette grève sera suivie par l’emprisonnement et l’expulsion de plusieurs dirigeants du MTA.
La seconde période des luttes que nous évoquons est celle qui part directement des cités ouvrières de l’immigration et qui sont menées par ceux qu’on appelle alors les « jeunes immigrés ». La mort de Lahouari Ben Mohamed à Marseille le 18 octobre 1980, les « rodéos » des Minguettes en 1981, inaugurent des mobilisations qui partent de la dénonciation des crimes policiers et de leur impunité. A Paris, les « mères contre les crimes racistes et sécuritaires », les mères de la « Place Vendôme »6 ne seront pas reçues par la Grande Conscience de gauche qu’est le Garde des Sceaux, Robert Badinter. Ce qui unifie la marche c’est le refus d’être maintenue comme la « part maudite » de la France avec le procès permanent de la légitimité de sa présence : « On s’en fout, on est chez nous ! ». C’est le moteur principal de la « Marche contre le racisme et pour l’égalité » qui arrive à Paris le 3 décembre 1983 et réunit des dizaines de milliers de personnes. Les crimes et la hagra (l’humiliation, l’abus de pouvoir) sont le vécu commun qui permet une prise de conscience collective et d’une expression politique spécifique. Pendant plusieurs années c’est l’effervescence militante, de nombreuses luttes locales sont menées, en région lyonnaise, l’épicentre des marches, mais aussi en région parisienne ou lilloise, comme ailleurs en France. Mais les tentatives d’unification des groupes militants locaux vont échouer. S’organiser de façon autonome à l’échelle nationale, définir un programme clair et rester implanté au cœur des quartiers sans devenir une succursale ou un relais de la politique bourgeoisie officielle : tous ces défis ne sont pas relevés. Le passage des militants de la Marche par la politique électorale ou le travail social dans le cadre institutionnel signifient un abandon progressif des engagements sur le thème police/justice. L’élu « expert des banlieues » devient un contre-feu qui passe avec armes et bagages au service de la gestion de l’Etat bourgeois. Ce qui marque cette génération ce sont les tentatives de détournement et d’usurpation de ses combats, surtout par le « fameux » SOS Racisme, créé et financé de toutes pièces par le PS au pouvoir pour noyer les revendications contre la police et la justice, et donc l’Etat, dans un antiracisme inoffensif et moral. Le noyau de militants qui va à nouveau essayer de fédérer des luttes autonomes des quartiers durant les années 1990, c’est le MIB (Mouvement de l’Immigration et de la Banlieue), qui va être un fer de lance jusqu’au début des années 2000.
Un nouveau groupe de banlieue parisienne, Résistance des Banlieues, surtout implanté dans les Yvelines (Mantes, Sartrouville, Chanteloup, Les Mureaux) et les Hauts de Seine (Nanterre et Colombes) essaie de relancer la mobilisation sur les crimes policiers et sur la question de la double peine. Cette démarche aboutira à la naissance du MIB. Au début des années 1990, dans un climat de suspicion lié à la première guerre du Golfe, a lieu un nouveau cycle d’émeutes qui débute dans la région lyonnaise avec la mort de Thomas Claudio, percuté par une voiture de police à Vaulx en Velin en octobre 1990 dans la ZUP, le Mas du Taureau7. Puis c’est la mort de Djamel Chattouh tué à Sartrouville d’un coup de fusil à pompe par un vigile arabe à l’hypermarché Euromarché de Sartrouville le 26 mars 1991. Fin du mois de mai mort d’Aïssa Ihich au commissariat de Mantes, tabassé par les policiers, puis mort de Youssef Khaïf, le 9 juin, 23 ans, tué par le policier Hiblot d’une balle dans la nuque au volant d’une voiture volée8. Ce sont ces crimes, avec des dizaines d’autres, qui alimentent la chroniques des cités reléguées et alimentent le feu militant. Le cycle émeutes/mobilisations contre l’impunité policière va agréger des militants et rapprocher à nouveau ceux de Paris et de Lyon. Des comités de soutien aux familles et de solidarité avec les inculpés sont créés. Mais les associations comme Agora à Vaulx-en-Velin ou l’Association des Jeunes de Sartrouville élargissent leurs revendications à la défense des intérêts de l’ensemble des habitants des quartiers, jusqu’à ce que des tentatives d’organisation à l’échelle nationale voient le jour. Le conflit entre l’Etat et les classes populaires prend souvent pour les quartiers la forme du conflit des classes populaires face à la justice et la police. Assumer pleinement cette contradiction est le propre du MIB, qui s’éloigne ainsi de toutes les expressions immédiatement réformistes de l’antiracisme quand il a pour finalité de négocier un partenariat avec les Autorités politiques. C’est une loi imparable : la « gauche » peut appeler à se mobiliser quand un crime est commis est commis par un sbire d’extrême-droite, mais elle s’y refuse quand le crime n’a pas cette signature. Ce qui le distingue sûrement aussi c’est la prise en compte de la légitimité, de la force mais aussi d’un discours sur les limites des « émeutes ». L’ « émeute » permet de faire connaître la violence d’Etat, elle permet aussi de prendre la parole et faire parler sur ce qui resterait sans elle dans l’anonymat des contrôles permanents et des humiliations. L’ « émeute » rend visible, regroupe et soude des acteurs. Elle a valeur d’alerte et de démarcation. Quoi de plus déplorable et de plus pathétique que ceux qui entretiennent les mythes du « peuple de gauche », qui magnifient pieusement les soulèvements ouvriers du passé et qui vomissent tout leur ressentiment et leur peur sur les révoltes des laissés pour compte, le gibier désigné par la haine chauvine en tant que « français de papier ». En assumant, l’antagonisme avec l’Etat, en cherchant avant tout l’implantation et la légitimité au cœur des quartiers populaires, en multipliant des actions d’éclat où l’on défend les « indéfendables » et les parias, le MIB9 a été sans conteste, et malgré d’indéniables limites, l’expression la plus intéressante et la plus avancée des luttes des cités ouvrières et immigrées. Le MIB s’est défini avant tout comme un regroupement social et non ethnique et si il est affirmé très tôt dans ses textes que les banlieues sont les héritières du colonialisme dans leur gestion, cette dimension ne sert pas d’étendard ou de mode de définition unique, car ce qui est principal c’est la réalité sociale commune vécue dans les cités et non telle ou telle identité héritée. D’où la participation du MIB au mouvement des chômeurs et précaires avec la création de « La Chorba » qui approvisionne les Assedics occupés (ancêtres de Pôle Emploi) en 1997-1998. Une marche des chômeurs et des jeunes de cités, qui n’ont pas alors accès aux minimas sociaux, part de Vaulx-en-Velin et rejoint alors l’université de Nanterre pour fêter à sa manière les 30 ans de mai 6810 en occupant l’université le 22 mars.
A l’automne 2001, suite à l’acquittement définitif du policier qui avait tué Youssef Khaïf, le MIB appelle à une riposte politique. La presse de Libération au Figaro dénonce sa mobilisation devant le tribunal comme une « pression inadmissible » sur la justice et une ambiance d’« intifada ». Le climat politique des élections présidentielles de 2002 axé sur l’insécurité et déjà sur les « ennemis intérieurs » de l’Islam radicalisé est loin d’être favorable. La difficulté principale qui se présente alors au MIB est celle de passer du statut de « syndicat des cités » à celui d’un mouvement politique autonome à vocation nationale. Le problème vient bien sûr des aspects organisationnels comme celui d’unifier les expériences militantes diverses, ou encore celui des moyens financiers et du découragement devant l’idée d’avoir à toujours recommencer, mais l’essentiel vient d’une impasse bien plus grande et plus basique. Le passage à la dimension d’un mouvement politique est pensé au cours des années 2000 sous la forme d’une demande de reconnaissance « citoyenne » et d’un accès au champ politique électoral local et national. Or, quel sera le projet politique ? Si on ne considère les positions anticapitalistes que comme « déconnectées » que doit-on dire sur les causes et l’origine de l’oppression en banlieue ? Doit-on en rester à l’idée qu’elle vient d’une mauvaise gestion des élites ? Si l’on privilégie le seul « vécu commun des luttes » cela se fait nécessairement au détriment de l’élargissement et de l’élaboration d’un programme et d’une analyse approfondie des contradictions de la société. De toute façon, un véritable mouvement politique national ne verra pas le jour. Malgré des luttes locales marquantes comme celle contre l’apartheid urbain au Petit-bard de Montpellier, ou des actions à Grasse, ou à Nîmes, à Clermont-Ferrand, et malgré la multiplication des FSQP (Forum social des Quartiers Populaires) depuis 2007 qui se fixaient cet objectif. L’expérience du MIB en tant que structure autonome prendra fin.
Dans la dernière période des luttes des cités ouvrières et immigrées, aucun nouveau MIB n’a émergé suite à la plus grande révolte qu’aient connue les cités de France en novembre-décembre 2005. Ce qui a suivi la mort par électrocution de Bouna et Zyed à Clichy-sous-Bois était tout autre chose. Il y a eu un immense décalage entre l’explosion de haine de classe et ce qu’on appelle sa traduction politique. Localement, le mouvement très bien subventionné AC le FEU ! (tout un programme…) a collecté des « doléances » un peu partout pour les présenter aux autorités politiques « légitimes », le tout accompagné d’une grande campagne pour s’inscrire sur les listes électorales. Les pompiers de service, dans la désillusion générale, n’ont eu malgré tous leurs efforts qu’une audience finalement très limitée sur le « terrain » mais en revanche énorme et totalement disproportionnée dans les médias. Et cette donnée va énormément influencer les formes d’expression qui vont apparaître après 2005. Il existe certes toujours des luttes et des rassemblements des familles de victimes de crimes policiers, et des luttes sont menées contre les LBD, les armes léthales et les clés d’étranglement, bien avant que ces pratiques deviennent visibles et scandaleuses pour tous avec le mouvement des Gilets Jaunes. Mais ce qui domine le champ médiatique et politique c’est l’image d’« ennemi intérieur » de la jeunesse des cités, un mélange de voyoucratie et de pépinière à islamistes.
On peut estimer que jusqu’à l’émergence du Comité Adama, qui renoue avec un militantisme ancré dans les cités, à partir d’un « cas » précis de crime policier, ce n’était plus l’auto-organisation dans les quartiers qui dominait dans l’espace militant. Bien au contraire, des propositions politico-médiatiques arrivent à s’imposer via toute une série de polémiques autour de l’ « identité nationale » et ceux qui en sont exclus. Ces propositions, en premier celle des Indigènes de la République (MIR puis PIR), mais aussi le CRAN ou la BAN (Brigade Anti-Négrophobie) reprennent au moins en partie des revendications historiques et qui se présentent souvent comme héritières de l’histoire des luttes des cités et des « enfants de la colonisation ». Les cités restent un enjeu politique mais souvent de façon purement symbolique et non plus en tant que base populaire à organiser avec patience. Cet abandon de l’organisation « à la base » pose la question des finalités réelles de mouvements « hors-sol » avant même de considérer leurs théories « baroques » centrées sur des fétiches au final inoffensifs. Nos avons besoin de construire les conditions pour un réel rapport de forces
Pour conclure, la question de la construction d’un mouvement autonome des quartiers est une question d’ampleur, partie prenante en réalité de toute perspective réelle d’une politique d’autonomie de classe. Elle a désespéré des générations de militants de quartiers et elle n’est pas morte. Porter une fierté des quartiers populaires pour celui qui veut dépasser une misère générée par le système capitaliste, c’est un très bon point de départ. C’est chercher à détruire ce qui nous détruit. Il est bien sûr préférable selon nous de partir de l’expérience vécue et des oppressions sans cesse créées par les rapports sociaux actuels et non par un simple héritage colonial qui pervertirait le présent. Mais on ne saurait faire de sa propre situation un fétiche, malgré les souffrances et les persécutions qu’on peut endurer dans cette société. Au-delà de toutes les situations particulières, il y a la question de l’ensemble, celle de l’avenir d’une classe qui en libérant libère toute la société. Cette lutte pour une autonomie révolutionnaire est loin d’être achevée, elle n’en est peut-être qu’à ses balbutiements. Mais cela n’empêche pas d’être optimiste car la capacité à échanger, à apprendre des luttes, à enseigner, à organiser, à lutter à nouveau et à vaincre, c’est une capacité infinie de l’espèce humaine.
J.S.
1 La plupart des écrits disponibles étant le fait de sociologues et d’historiens, quelques textes seulement étant le fait des acteurs des luttes et de leurs organisations.
2 C’est la figure du «khobziste» (du «pain» en arabe), qui désigne celui qui ne soucie que de sa « croûte », l’arriviste, l’opportuniste. Un specimen très répandu par exemple dans les quartiers Nord de Marseille où le clientélisme est roi et où les justifications misérabilistes sont imparables (« c’est la seule chose qui nous reste, alors on a raison de la prendre»).
3 Une lecture étroitement racialiste des quartiers aboutit, à des propositions involontairement comiques, comme dans un article récent qui se demande très sérieusement si Jul et Ribéry sont encore des blancs. Un rappeur blanc des cités de Marseille et un joueur de football blanc, issu d’un quartier défavorisé et converti à l’Islam, ont effectivement du mal à rentrer dans les cases de concepts-slogans qui ne rendent pas compte de la vie réelle. La plupart des quartiers sont majoritairement mais pas exclusivement habités par des enfants de l’immigration dite postcoloniale. Ce simple fait devrait contraindre à articuler les dimensions sociale et raciale, ce qui était très fréquent dans les années 1980-1990 et qui est assez souvent effacé aujourd’hui.
4 Pour le mouvement de la grève des loyers des foyers SONACOTRA (aujourd’hui ADOMA), qui préfigurent nombre de mouvements comme celui qui ira du foyer Nouvelle France de Montreuil aux mouvement des sans-papiers de Saint-Bernard, nous renvoyons à un texte qui en fait le bilan sous l’angle d’une organisation particulière, l’UCFML editionsproletariennes.fr/Dochml/presse/brochures/ucfml/Histoiresonac.htm
5 C’est ce qui distingue l’antisionisme affiché de la GP jusqu’en 1972 des positions de « soutien critique » à la Palestine de la plupart des groupes trotskystes
6 Des mères de victimes qui reprennent la symbolique des mères« folles » d’Argentine qui se réunissaient chaque semaine pour demander à la junte où étaient passés leurs enfants disparus. On trouve des chronologies de ces crimes sur une longue période dans Bastamag et dans la revue Vacarme sur les morts de Dammarie-Les-Lys, Abdelkader Bouziane et Mohamed Berrichi.
7 Voir le texte de Farid, son ami, « voilà pourquoi la haine », un texte sur Thomas qui avait la polio mais refusait d’être un assisté. Les Temps modernes, n°545-546, décembre 1991.
8 Chercher les verdicts prononcés dans ces affaires vaut le coup pour comprendre très concrètement ce que signifie l’expression justice de classe et la justice raciste.
9 Le MIB est créé en 1995 bien que son appellation soit alors « Pour un MIB ». On peut considérer que le lancement de la campagne « Justice en banlieue » en mars 1997 signe aux yeux du « milieu » militant son acte de naissance. Un an plus tard, la MIB sera le centre d’une campagne sur « le droit au retour « en Palestine. Dans cette période très dense, il y aura la question du soutien mais aussi de positions critiques sur la question des soutiens avec le grand mouvement des sans-papiers. Sur la chronologie du MIB, outre leur site, nous recommandons les livres de Mogniss. H. Abdallah auxquels nous reprenons des éléments factuels.
10 Cf. L’écho des cités n°10, avril 1998