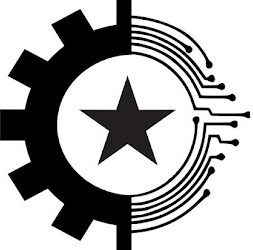Soumaya Ghannoushi, 2026
« Nous ne serons pas contraints, ni par des gouvernements étrangers ni par des autorités internationales », a averti l’ancien Premier ministre iranien Mohammad Mosaddegh au Conseil de sécurité de l’ONU en 1951.
Plus de sept décennies plus tard, alors qu’un groupe aéronaval américain pénètre dans l’océan Indien et que des destroyers équipés de missiles guidés se dispersent au Moyen-Orient, l’avertissement de Mosaddegh semble moins relever de l’histoire que d’un commentaire en direct.
Les navires de guerre ne se positionnent pas au hasard. Leur mouvement indique une intention. De même, les dossiers de renseignement ne sont généralement pas compilés pour découvrir la vérité, mais inventés pour créer un consensus en faveur d’une action militaire : le cadre d’une intervention déjà en cours.
Dans ce contexte, le régime israélien a fourni à Trump ce qu’il considère comme des preuves décisives que les autorités iraniennes ont exécuté des centaines de manifestants arrêtés lors de la récente répression à l’échelle nationale. Que Tel-Aviv se présente désormais comme le principal fournisseur de preuves contre l’Iran serait comique si les enjeux n’étaient pas aussi graves.
L’État qui a inlassablement mené la guerre contre Téhéran, qui déclare ouvertement que le changement de régime en Iran est un objectif stratégique et qui a plus à gagner que tout autre acteur de l’effondrement de l’Iran, se présente soudainement comme un témoin humanitaire neutre. Tel-Aviv a donc été promu procureur général ; ses déclarations ont été considérées non pas comme une défense, mais comme des faits.
Cela ne signifie pas que l’Iran n’est pas en crise. Un grand nombre d’Iraniens ont été contraints de descendre dans la rue, épuisés par des décennies d’étranglement économique de la part de l’Occident. Leurs griefs sont réels, leur colère indéniable.
Mais ce sont aussi des moments où les mouvements populaires sont les plus vulnérables, non seulement à la répression, mais aussi au contrôle. Les puissances extérieures n’ont pas nécessairement besoin d’inventer le mécontentement interne : elles n’ont qu’à le guider.
Un modèle connu
Le schéma est bien établi. Cela s’est produit lors du coup d’État de 1964 au Brésil contre João Goulart, du coup d’État de 1973 au Chili contre Salvador Allende, et avant cela, du coup d’État de 1961 au Congo, lorsque Patrice Lumumba a été renversé et assassiné. Il y a ensuite la longue et sombre histoire des revers contre-révolutionnaires qui ont suivi le Printemps arabe.
Ces cas ne sont pas identiques, mais la structure est suffisamment familière pour servir d’avertissement.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque des mouvements sociaux menacent des intérêts occidentaux bien établis, des sanctions sont imposées. Des crises économiques sont planifiées. Les divisions internes sont attisées. Les campagnes médiatiques se multiplient. Les contre-révolutions sont financées.
Si ces mesures échouent, des coups d’État sont organisés, des occupations sont lancées ou des guerres sont justifiées par un discours salvateur.
L’Iran connaît ce schéma non pas comme une théorie, mais comme un traumatisme vécu. En 1953, Mohammad Mosaddegh, Premier ministre démocratiquement élu, a été renversé par un coup d’État anglo-américain, non pas pour sa brutalité au gouvernement, mais pour avoir nationalisé le pétrole iranien. À l’époque, la Compagnie pétrolière anglo-iranienne, plus tard connue sous le nom de BP, n’offrait à l’Iran que 16 % des bénéfices nets de ses ressources.
La Grande-Bretagne a réagi par un blocus, fermant la raffinerie d’Abadan, faisant pression sur les acheteurs étrangers pour qu’ils refusent le pétrole iranien et plongeant délibérément l’économie dans une crise.
Lorsque la guerre économique s’est avérée insuffisante, Londres a persuadé Washington d’intervenir en invoquant les craintes de la guerre froide. L’opération Ajax de la CIA a inondé l’Iran de désinformation, corrompu des politiciens, harcelé des personnalités religieuses et orchestré des émeutes. Mosaddegh a été destitué. Le Shah a été rétabli dans ses fonctions. Même la CIA reconnaît désormais officiellement que ce coup d’État était antidémocratique.
Cet épisode n’a pas seulement bouleversé la trajectoire politique de l’Iran, il a défini le plan d’action. Les mêmes outils sont toujours utilisés aujourd’hui. Les informations faisant état d’attaques contre des dizaines de mosquées dans tout l’Iran soulèvent inévitablement des questions sur les efforts déployés à l’extérieur pour alimenter les divisions et les conflits internes, en utilisant les mêmes lignes de fracture exploitées il y a sept décennies.
Et il ne s’agit pas seulement d’une déstabilisation covert. Des personnalités des médias israéliens ont parlé ouvertement de ce qui se passera après l’effondrement du régime, déclarant qu’une fois l’Iran tombé, il sera bombardé sur son propre territoire, tout comme la Syrie a été systématiquement dépouillée de sa capacité militaire après le renversement du président progressiste Bachar al-Assad.
Le message est sans équivoque : le changement de régime n’est pas l’objectif final, mais la condition préalable à son démantèlement complet.
Un siège lent
Depuis 1979, l’Iran subit l’un des programmes de sanctions les plus longs et les plus exhaustifs de l’histoire moderne. Ce qui a commencé par le gel des avoirs et l’interdiction d’exporter du pétrole s’est transformé en un système qui englobe les finances, l’énergie, le commerce, la technologie et la vie quotidienne.
Les sanctions se sont intensifiées dans les années 1990, ont été étendues multilatéralement après 2006, ont été partiellement levées avec l’accord nucléaire de 2015, puis réintroduites dans leur intégralité lors de la campagne de « pression maximale » menée par Trump en 2018.
L’année dernière, les puissances européennes ont activé le mécanisme de retour rapide, rétablissant automatiquement les sanctions de l’ONU sous le prétexte maintes fois utilisé du non-respect des droits de l’homme.
Les sanctions sont souvent présentées comme une alternative pacifique à la guerre. En réalité, elles fonctionnent comme un siège lent. Elles font s’effondrer les monnaies, vident les sociétés, radicalisent la politique et appauvrissent les gens ordinaires qui paient le prix de la confrontation géopolitique.
La Grande-Bretagne a utilisé cette méthode contre l’Iran en 1951. Les États-Unis l’ont perfectionnée depuis lors. Ce n’est pas un hasard si les appels à un changement de régime s’accompagnent souvent d’appels à des sanctions plus sévères. Ceux qui les soutiennent savent parfaitement qui en subira les conséquences.
L’intérêt de Washington pour l’Iran repose sur l’hégémonie. Le pétrole iranien n’est pas seulement un atout économique, c’est aussi un levier stratégique dans la concurrence mondiale avec la Chine.
Aujourd’hui, la Chine est le plus grand acheteur de pétrole brut iranien. L’affaiblissement de l’Iran affaiblit donc une artère énergétique essentielle pour Pékin : l’Iran représentait environ 13 % des importations maritimes de pétrole de la Chine en 2025, avec environ 1,38 million de barils par jour destinés aux acheteurs chinois.
L’agenda d’Israël va plus loin. Au cours des deux dernières années, le Premier ministre du régime, Benjamin Netanyahu, s’est adressé à plusieurs reprises au peuple iranien, l’exhortant à descendre dans la rue, présentant l’action militaire israélienne comme une voie vers la liberté et promettant son aide une fois le régime renversé.
L’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant a été encore plus explicite en parlant de guider les événements « d’une main invisible », soulignant le rôle central de l’action de masse tout en restant formellement en retrait.
Le démantèlement du gouvernement progressiste iranien permettrait à Israël d’éliminer enfin le seul obstacle qui l’empêche de dominer complètement le Moyen-Orient.
Nous sommes avec vous
Cette rhétorique s’accompagne de plus en plus souvent de reportages dans les médias. Les médias israéliens ont ouvertement insinué que des acteurs étrangers arment les manifestants, une affirmation exprimée très franchement par un correspondant diplomatique de Channel 14 – la chaîne de télévision la plus proche de Netanyahu – qui s’est vanté que les manifestants recevaient de vraies armes à feu, « ce qui explique la mort de centaines de membres du gouvernement.
Chacun peut deviner qui se cache derrière tout cela », a-t-il ajouté.
Ces observations ne sont pas des négligences marginales, mais font partie d’un écosystème médiatique israélien plus large qui a commencé à dire haut et fort ce qui était auparavant caché ou implicite.
Ces signaux médiatiques contrastent de manière gênante avec les messages officiels des services de renseignement. Après la guerre perdue par Israël en juin dernier, le directeur du Mossad, David Barnea, a publié une déclaration inhabituelle et surprenante, assurant à la fois à son agence et au public qu’Israël resterait « présent, comme il l’a toujours été », un langage largement interprété comme un présage d’une activité secrète soutenue en Iran.
Et le mois dernier, un compte X en persan lié au Mossad a exhorté les Iraniens à se joindre aux manifestations, déclarant : « Descendez ensemble dans la rue. Le moment est venu. Nous sommes avec vous. Pas seulement à distance et verbalement. Nous sommes avec vous sur le terrain ».
Bien que les responsables israéliens aient officiellement nié tout lien avec cette affaire, les agences de renseignement ont longtemps eu recours à des façades facilement démentissables précisément à ces fins.
Et cela ne se limite pas aux signaux cachés. Les drapeaux israéliens sont devenus un élément marquant des manifestations contre le gouvernement iranien en dehors de l’Iran, accompagnés d’une campagne coordonnée sur les réseaux sociaux qui amplifie des récits spécifiques et des résultats politiques préférés.
Une analyse des données d’Al Jazeera a montré comment des comptes liés à Israël ont systématiquement influencé la perception mondiale des manifestations, en promouvant l’inconnu Reza Pahlavi, fils du dernier shah d’Iran, comme seule alternative politique. Pahlavi lui-même a participé à la campagne, une action qui a rapidement été amplifiée par les rapports israéliens le présentant comme le « visage d’un Iran alternatif ».
Ces interventions ne sont pas isolées. Elles s’inscrivent dans une vision stratégique plus large, de plus en plus articulée dans les cercles politiques et intellectuels israéliens : l’affaiblissement et la fragmentation éventuelle de l’Iran.
Des éditoriaux et des documents politiques israéliens ont ouvertement soutenu la partition de l’Iran et la promotion de la sécession ethnique, tandis que d’autres ont préconisé d’armer les minorités afin de déstabiliser l’État de l’intérieur. Il ne s’agit pas là d’une spéculation marginale ; cela apparaît dans les principaux médias et dans le débat politique.
Chorégraphie coloniale
La promotion de Reza Pahlavi comme « alternative » à l’Iran doit être comprise dans ce contexte. Tout en prétendant défendre l’intégrité territoriale de l’Iran, il a exhorté les États-Unis à lancer des attaques militaires contre son propre pays et a soutenu des sanctions de plus en plus sévères qui ont dévasté la société iranienne.
Son parcours reflète celui de son père avec une précision presque rituelle : Mohammad Reza Shah a été installé au pouvoir en 1941 par les Britanniques après avoir contraint son père à abdiquer, pour être réinstallé en 1953 après le coup d’État de la CIA et du MI6 contre Mosaddegh.
Aujourd’hui, le fils cherche à nouveau à être installé au pouvoir, cette fois par les États-Unis et Israël, répétant la même chorégraphie coloniale sous un drapeau différent. Il gouvernerait, comme son père, grâce à un soutien extérieur plutôt qu’à une légitimité interne.
Son père a gouverné par le biais de la SAVAK, un appareil de sécurité brutal créé avec l’aide de la CIA et du Mossad, connu pour ses pratiques de torture et de répression. L’une des figures principales de la SAVAK, qui a passé des décennies caché aux États-Unis, aujourd’hui à l’article de la mort, fait l’objet de graves poursuites civiles dans ce pays pour des atrocités policières commises dans le passé.
Le passé n’est pas seulement rappelé : il est revécu
Tout cela met en évidence le vide de la position morale étrangère.
Ceux qui ont harcelé économiquement l’Iran pendant près d’un demi-siècle, ont soutenu une guerre dévastatrice par procuration dans les années 1980 et discutent maintenant ouvertement de la partition (alors que leurs mains sont souillées par les crimes régionaux contemporains) sont les gardiens les moins crédibles de la liberté iranienne.
Il n’y a rien de fortuit dans le moment choisi pour l’escalade actuelle. Le 1er février marque l’anniversaire du retour de l’ayatollah Ruhollah Khomeini à Téhéran en 1979, jour où une monarchie installée depuis l’étranger s’est finalement effondrée et où l’Iran a retrouvé son indépendance politique.
Le fait que les préparatifs d’une nouvelle offensive américaine s’intensifient à cette date n’est pas une coïncidence, mais une continuité.
Cela met en évidence une vérité qui est restée inchangée pendant plus de sept décennies : ce que l’Iran a affirmé au début des années 1950 et à nouveau en 1979 – souveraineté, indépendance et droit à l’autodétermination – est précisément ce que les puissances étrangères n’ont jamais accepté, n’ont jamais pardonné et n’ont jamais cessé d’essayer de renverser.