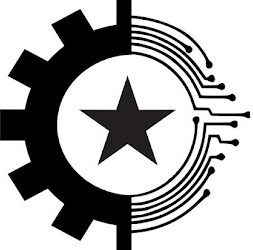Michael Yates a interviewé Rockhill au sujet de son nouveau livre Who Paid the Pipers of Western Marxism?
Michael Yates : Gabriel, ce que nous sommes en tant qu’adultes est conditionné par notre enfance. Parlez-nous un peu de l’endroit où vous avez grandi et de votre enfance. Comment pensez-vous que cela a influencé la personne que vous êtes aujourd’hui ?
Gabriel Rockhill : J’ai grandi dans une petite ferme dans la campagne du Kansas, et le travail manuel a fait partie intégrante de ma vie dès mon plus jeune âge. Cela comprenait bien sûr le travail à la ferme, mais je travaillais également dans le bâtiment. Mon père est constructeur et architecte, donc quand je ne travaillais pas à la ferme, je passais la plupart de mon temps, en dehors de l’école et du sport, sur des chantiers de construction.
Avant même de connaître le mot, j’avais déjà vécu l’expérience de l’exploitation (le travail à la ferme n’était jamais rémunéré, pas plus que le travail dans la construction au début). C’est clairement l’une des choses qui m’a conduit à la vie intellectuelle : j’appréciais l’école comme une pause bienvenue dans le travail manuel.
Mon père est passionné par le design et sa devise est « la main et l’esprit », ce qui signifie que pour être un véritable architecte, il faut avoir les compétences pratiques pour construire (la main) ce que l’on conçoit (l’esprit). Quand j’étais jeune, j’aspirais davantage à la seconde, mais je suis également resté profondément attaché à la première. Rétrospectivement, cette approche a manifestement eu un impact durable sur moi, car j’ai définitivement adopté ce que j’appellerais aujourd’hui la relation dialectique entre la pratique et la théorie.
Mes parents sont des libéraux qui se sont opposés à la guerre du Vietnam et sont extrêmement anti-capitalistes, sans être vraiment anticapitalistes ou anti-impérialistes. Étant donné que mon père enseigne également l’architecture à l’université, en plus de diriger sa petite entreprise de conception et de construction, sa position sociale est petite-bourgeoise. Ils ont beaucoup de critiques justifiées à l’égard de la société contemporaine, et j’ai beaucoup appris d’eux sur la façon dont la recherche du profit détruit la terre et l’environnement. Cependant, ils s’opposent principalement à ce qu’ils considèrent comme une prise de contrôle par les entreprises, en partie sur la base d’une attitude « fais-le toi-même », qui m’a certainement impressionné. Cependant, ils n’adhèrent pas à un projet politique plus large qui pourrait surmonter la commercialisation de tout. Outre leur position sociale, qui tend à être un obstacle à cet égard, ils ont également été conditionnés idéologiquement à rejeter le socialisme (même si l’on peut dire qu’ils y sont devenus plus ouverts avec le déclin continu des États-Unis).
MY : À un moment donné, vous vous êtes montré favorable à certaines des personnes que vous critiquez sévèrement dans votre nouveau livre. Parmi elles figuraient certains de vos professeurs et mentors. Quelles expériences vous ont amené à changer d’avis sur ces universitaires ?
GR : Lorsque je suis allé à l’université dans l’Iowa, mes camarades étaient plus avancés que moi. Beaucoup d’entre eux avaient simplement eu plus de temps à consacrer à des activités intellectuelles et avaient reçu une meilleure éducation que moi dans un lycée rural du Kansas (même si j’en savais beaucoup plus sur le travail manuel et les communautés ouvrières). J’avais souvent l’impression de devoir rattraper mon retard et d’avoir besoin d’apprendre par moi-même, surtout lorsque j’ai obtenu une bourse qui m’a permis de déménager à Paris pour commencer mes études supérieures au milieu des années 90. J’ai donc appliqué mon éthique de travail de garçon de ferme, qui m’imposait des exigences élevées, à l’apprentissage du français et d’autres langues, ainsi qu’à l’étude de l’histoire de la philosophie et des sciences humaines en général, avant de passer à l’histoire et aux sciences sociales.
J’étais attiré par les discours radicaux, mais j’étais aussi assez confus. D’une part, avec le recul, il est clair que je cherchais des outils théoriques pour comprendre et combattre l’exploitation et l’oppression (les questions de genre, de sexualité et de race étaient importantes pour moi dès mon plus jeune âge). Mais en même temps, j’étais attiré par les discours précieux et sophistiqués qui avaient tellement de capital symbolique qu’ils m’élevaient, avec distinction, au-dessus du bourbier du travail manuel dont je voulais m’échapper (le fait que je continuais à travailler comme ouvrier du bâtiment et plongeur à temps partiel me le rappelait constamment). À l’université, j’en suis venu à penser que Jacques Derrida était le penseur le plus radical vivant, sans doute en raison à la fois de sa renommée aux États-Unis et de la complexité obscure de son œuvre. Lorsque j’ai déménagé à Paris et commencé mon master sous sa supervision, j’ai été très impressionné par lui et ses disciples. Après tout, j’étais un plouc, sans capital symbolique ni formation élitiste, et je me sentais donc très inférieur et culturellement dépassé par le milieu intellectuel parisien.
Cependant, j’ai étudié avec la fureur de quelqu’un tourmenté par des insécurités culturelles et de classe, tout en étant imprégné d’une saine dose d’autodidactisme et d’anti-autoritarisme, et j’ai rapidement commencé à percevoir des divergences entre les affirmations de Derrida et les textes qu’il commentait. Au terme d’un processus rigoureux de vérification empirique – qui comprenait l’étude de textes originaux en allemand, en grec et en latin – je me suis rendu compte que mon directeur de thèse, à l’instar d’autres grands penseurs français de sa génération, forçait les textes à s’adapter à son cadre théorique préétabli, ce qui l’amenait à les interpréter de manière erronée. Je me suis également de plus en plus engagé dans une analyse plus matérialiste, étudiant l’histoire institutionnelle de la production et de la circulation des connaissances. Il m’est apparu clairement, comme je l’ai exposé dans ma thèse de doctorat et dans mon premier livre, Logique de l’histoire, que la pratique théorique de Derrida était en grande partie une conséquence de l’histoire du système matériel dans lequel il opérait.
Dans le même temps, je m’intéressais de plus en plus au monde politique en général. Comme je le raconte dans un bref intermède autobiographique dans Who Paid the Pipers of Western Marxism?, le 11 septembre 2001 a constitué un tournant important. Je me suis rendu compte que ma formation de première main en théorie française – j’assistais également à des séminaires avec d’autres éminences vivantes de cette tradition – m’avait laissé mal préparé à comprendre la politique mondiale et, plus précisément, l’impérialisme. Je n’avais aucune idée des choses qui importaient le plus à la majorité de la planète, alors que j’avais une connaissance approfondie des précieux raffinements discursifs qui n’importent qu’à l’aristocratie intellectuelle. Je lisais de plus en plus des auteurs tels que Samir Amin, qui m’ont éclairé sur beaucoup de choses, mais mon développement théorique et pratique continuait d’être freiné par ma compulsion à lire des marxistes occidentaux tels que Slavoj Žižek, parmi tant d’autres.
MY : Losurdo et vous-même utilisez le terme « marxisme occidental ». Qu’entendez-vous par là ? S’agit-il simplement d’une différence géographique ?
GR : Le marxisme occidental est la forme spécifique de marxisme qui a émergé au cœur de l’empire et s’est répandue dans le monde entier grâce à l’impérialisme culturel. L’histoire du capitalisme a développé les pays centraux d’Europe occidentale, les États-Unis, etc., tout en sous-développant le reste du monde. Les premiers ont confisqué ou obtenu à un prix dérisoire les ressources naturelles et la main-d’œuvre des seconds, tout en utilisant la périphérie comme marché pour leurs produits, créant ainsi un flux international de valeur du Sud global vers le Nord global. Cela a conduit à la constitution de ce qu’Engels et Lénine ont appelé une aristocratie ouvrière dans les pays centraux, c’est-à-dire une élite de la classe ouvrière mondiale dont les conditions dépassent celles des travailleurs de la périphérie. Cette couche supérieure de travailleurs bénéficie, directement ou indirectement, du flux de valeur que nous venons de mentionner. Cette stratification mondiale de la classe ouvrière a fait que les travailleurs les plus privilégiés du centre ont un intérêt matériel à maintenir l’ordre mondial impérial.
C’est dans ce contexte matériel qu’est apparu le marxisme occidental. Losurdo le fait remonter avec perspicacité à la division du mouvement socialiste à l’époque de la Première Guerre mondiale, qui fut un conflit concurrentiel entre les principaux pays impérialistes. De nombreux dirigeants du mouvement ouvrier en Europe ont encouragé les travailleurs à soutenir la guerre, et certains d’entre eux ont même défendu le colonialisme, s’alignant ainsi, volontairement ou non, sur les intérêts de leurs bourgeoisies nationales. Lénine a été l’un des critiques les plus virulents de ces tendances, qu’il a qualifiées de révisionnistes et d’antimarxistes. Il les a contrées par le puissant slogan : « Non à la guerre, mais à la guerre des classes ! ».
L’orientation du marxisme occidental a donc souvent été ce que l’on pourrait appeler « anti-anti-impérialiste », dans la mesure où il a tendance à refuser de soutenir la lutte des peuples du Sud — en particulier lorsqu’ils se proclament socialistes — pour assurer leur souveraineté et suivre une voie de développement autonome. Il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste des débats académiques sur la fameuse « négation de la négation » pour comprendre que la double négation dans « anti-anti-impérialisme » signifie que les marxistes occidentaux ont eu tendance à soutenir de facto l’impérialisme.
On peut dire que cette tendance n’a fait que s’intensifier au cours du siècle dernier. Alors que les révisionnistes critiqués par Lénine étaient profondément impliqués dans la politique organisée, de nombreux marxistes occidentaux ultérieurs se sont retirés dans le domaine universitaire, où leur version du marxisme est devenue prédominante. Si le marxisme occidental a été impulsé par la base socio-économique et l’ordre mondial impérial, il a également été cultivé et façonné par la superstructure impériale, c’est-à-dire l’appareil politico-juridique de l’État et l’appareil culturel qui produit et diffuse la culture (au sens large du terme). Une partie importante de mon dernier livre est consacrée à l’analyse des superstructures des principaux pays impérialistes et des différentes façons dont ils ont encouragé les discours marxistes occidentaux comme arme de guerre idéologique contre la version du marxisme défendue par Lénine. En me consacrant à l’économie politique de la production et de la distribution du savoir, ce qui a nécessité des recherches approfondies dans les archives, j’ai mis en lumière la mesure dans laquelle la classe capitaliste et les États bourgeois ont directement soutenu le marxisme occidental en tant qu’allié « anti-anti-impérialiste » dans leur lutte de classe contre le marxisme anti-impérialiste (c’est-à-dire le marxisme tout court).
Les intellectuels et les organisateurs sont soumis aux puissants diktats du marxisme occidental, mais ils ne sont nullement déterminés à les respecter rigoureusement. En fait, il existe de nombreux marxistes en Occident qui ne sont pas des marxistes occidentaux, et l’un des objectifs de mon travail, tout comme celui de Losurdo, est d’augmenter leur nombre. Ceux qui le liront devraient y trouver l’élan nécessaire pour mobiliser leur action et se libérer des contraintes idéologiques du marxisme occidental.
MY : Le titre du livre pose la question « Qui a payé les musiciens ? ». Cela implique que quelqu’un « donne le ton ». Votre livre montre clairement que ces phrases ne signifient pas simplement que les intellectuels de l’école de Francfort, tels que Theodor Adorno et Max Horkheimer, ont été simplement soudoyés pour adopter des positions hostiles à Marx et à ce qui se passait dans les endroits où le socialisme était mis en pratique. Au contraire, vous développez une théorie de la production de connaissances dans un système social hégémonique, à savoir le capitalisme. Pouvez-vous expliquer votre analyse théorique et comment et pourquoi exactement les principaux intellectuels de gauche en sont venus à permettre, en fait, l’hégémonie capitaliste ?
GR : L’école de Francfort de théorie critique, dirigée par des figures telles qu’Adorno et Horkheimer, a apporté une contribution fondamentale au marxisme occidental, c’est pourquoi je m’y suis intéressé dans une partie du livre. Vous avez tout à fait raison de dire que mon approche méthodologique rejette fermement l’idéologie libérale dominante qui oppose la liberté individuelle au déterminisme. L’idée que les intellectuels agissent de manière totalement autonome ou sont rigoureusement contrôlés par des forces extérieures est une simplification excessive qui ignore les complexités dialectiques de la réalité matérielle.
Comme mes recherches portent sur l’histoire de l’État sécuritaire américain, et plus particulièrement sur la CIA, certains lecteurs supposent que j’affirme en quelque sorte que les intellectuels sont des marionnettes manipulées par des fils, l’Agence jouant le rôle de grand marionnettiste dans les coulisses. Ce n’est absolument pas le cas. Ce que propose le livre, c’est une histoire matérielle du système dominant de production, de distribution et de consommation du savoir. C’est ce système qui fonctionne comme le monde vital général dans lequel opèrent les intellectuels. Ceux-ci ont la capacité d’agir et de prendre des décisions à l’intérieur de ce système, réagissant de diverses manières aux récompenses et aux sanctions qui structurent le système. Ce que le livre démontre, donc, c’est qu’il existe une relation dialectique entre le sujet et le système. Ce dernier n’étant en aucun cas neutre, mais plutôt une superstructure dérivée de l’ordre mondial impérial, il récompense les sujets qui contribuent à ses objectifs. En ce sens, plutôt que d’être des marionnettes, les intellectuels anti-anti-impérialistes exercent leur pouvoir au sein d’institutions matérielles où l’opportunisme du sujet est fortement corrélé à l’ascension au sein du système. En d’autres termes, ils choisissent d’avancer en donnant au système ce qu’il exige et en rejetant ce qu’il rejette.
Les intellectuels de gauche qui investissent dans leur carrière et leur ascension sociale au sein du noyau impérial doivent apprendre à naviguer dans le système pour survivre. Ils savent tous que le communisme est tout simplement hors de propos et qu’il n’y a rien à gagner à défendre — ou même à étudier rigoureusement — le socialisme réellement existant. S’ils veulent occuper une position de gauche au sein des institutions existantes, ils doivent alors respecter – et idéalement surveiller – la limite gauche de la critique. S’ils sont radicaux, ils progresseront généralement plus rapidement s’ils agissent comme des récupérateurs radicaux, c’est-à-dire des intellectuels qui cherchent à ramener les radicaux potentiels dans le domaine de la politique respectable et acceptable, en redéfinissant le « radical » dans les termes de la gauche non communiste. Tout cela tend à conduire à un accommodement avec le capitalisme, voire avec l’impérialisme, car il n’y a (réellement) pas d’autre alternative.
Pour devenir un intellectuel de gauche de premier plan dans l’industrie de la théorie impériale, les sujets doivent exercer leur pouvoir d’action pour se conformer aux protocoles de ce système. L’une des choses que démontre ma recherche est la constance de ce schéma, non seulement dans la tradition du marxisme occidental et de la théorie française, mais aussi dans la théorie radicale contemporaine avec tous ses discours tendance (des études postcoloniales et de la théorie queer libérale à la théorie décoloniale, au nouveau matérialisme, etc. Bien que le marché de la théorie présente ces penseurs et ces traditions comme différents, voire incompatibles, ils ont tendance à partager l’orientation idéologique la plus importante : l’anticommunisme.
MY : Le chapitre le plus long de votre livre est consacré à Herbert Marcuse, que vous qualifiez de « flûtiste radical du marxisme occidental ». Votre critique de Marcuse ne manquera pas de susciter la controverse, étant donné qu’il était l’un des principaux philosophes et défenseurs de la Nouvelle Gauche des années 1960 et qu’il a été le professeur, le mentor et le confident d’Angela Davis. Avant même la publication de votre livre, les critiques se sont montrés hostiles à vos opinions sur Marcuse. Pourquoi lui avez-vous accordé autant d’attention ?
GR : Marcuse a été largement identifié comme le membre le plus radical de la première génération de l’école de Francfort, c’est pourquoi son œuvre m’a d’abord attiré et que je l’ai lue avec beaucoup d’intérêt. Vers la fin de sa vie, il a adopté une série de positions très à gauche par rapport à des figures telles qu’Adorno et Horkheimer. En même temps, comme beaucoup de gens, j’avais entendu des rumeurs selon lesquelles il avait des liens avec la CIA et agissait comme une sorte d’opposition contrôlée. Insatisfait de ces rumeurs, j’ai décidé d’examiner les archives en faisant des demandes en vertu de la loi sur la liberté d’information et en effectuant des recherches dans les archives.
Je dois avouer que je me suis moi-même un peu surpris lorsque j’ai commencé à rassembler les éléments de cette étude qui, au fil des ans, est devenue le dernier chapitre du livre. En lisant d’excellents travaux universitaires en allemand, en examinant le dossier complet du FBI sur Marcuse, en consultant les archives du Département d’État et de la CIA, et en effectuant des recherches au Rockefeller Archive Center, il m’est apparu très clairement que Marcuse avait été peu sincère dans les interviews où on l’interrogeait sur son travail pour le gouvernement américain. En réalité, il collaborait régulièrement avec la CIA, et Tim Müller a révélé qu’il avait participé à la rédaction d’au moins deux estimations de sécurité nationale (le plus haut niveau de renseignement du gouvernement américain). Sa collaboration avec l’État américain en matière de sécurité nationale ne s’est pas du tout terminée lorsqu’il a obtenu un poste à l’université, et il a continué à entretenir des liens étroits avec des agents actuels ou anciens de l’État jusqu’à la fin de sa vie. Il était également le principal intellectuel du projet Marxisme-Léninisme de la Fondation Rockefeller, où il travaillait en étroite collaboration avec son ami intime, Philip Mosely, qui était un conseiller de haut niveau et de longue date de la CIA. Ce projet transatlantique, extrêmement bien financé, avait pour mission explicite de promouvoir internationalement le marxisme occidental face au marxisme-léninisme.
Bien que je connaisse très bien l’antisoviétisme de Marcuse et ses fortes tendances anarchistes, car je lisais ses œuvres depuis des décennies, je n’ai pas abordé cette recherche avec une idée préconçue sur sa place exacte dans la lutte des classes mondiale (en tout état de cause, mon opinion à son sujet correspondait davantage aux hypothèses consensuelles sur son radicalisme). Compte tenu de mes découvertes et de leur contribution à la consolidation d’une thèse en évolution sur l’anticommunisme profondément enraciné dans l’industrie de la théorie impériale, j’ai estimé que je devais traiter son cas de manière assez détaillée, ce qui impliquait de retracer sa propre évolution politique et la surveillance dont il faisait l’objet de la part du FBI. Cela montre, à bien des égards, à quel point un intellectuel peut être radical tout en continuant à servir, sur certains points décisifs, les intérêts impériaux.
À cet égard, je tiens à souligner que je suis tout à fait ouvert à la critique et que je crois fermement à la socialisation des connaissances. Si quelqu’un n’est pas d’accord avec mon interprétation — et je suis sûr que certains de ceux qui s’intéressent à Marcuse le seront —, alors il leur appartient de consulter l’ensemble des archives que j’ai examinées et de proposer une explication des faits plus convaincante et plus cohérente. Je serais le premier à lire cette analyse. Toutefois, si leur rejet de mon travail repose sur des hypothèses a priori plutôt que sur un examen rigoureux de toutes les preuves, alors, je suis désolé de le dire, il ne mérite pas d’être pris au sérieux, car il n’est rien d’autre qu’une expression de dogmatisme.
MY : Compte tenu des divisions profondes qui existent aujourd’hui entre les partisans du marxisme occidental, parmi lesquels se trouvent sans doute la majorité des sociaux-démocrates et des socialistes démocratiques, quelle est la voie à suivre pour changer radicalement le monde ? Le compromis ? Une gauche radicale indépendante et mondiale qui continue à soumettre le marxisme occidental à la critique ? Quoi ?
GR : Nous arrivons ici à la question la plus importante. La théorie devient une force réelle dans le monde lorsqu’elle parvient à séduire les masses. À bien des égards, mon livre retrace la reconstruction de la gauche à l’ère de la domination impériale américaine. Si la seconde moitié du livre se concentre sur le marxisme occidental, l’ouvrage dans son ensemble traite de la redéfinition générale de la gauche – pour reprendre la terminologie de la CIA – en tant que gauche « respectable », c’est-à-dire « non communiste », compatible avec les intérêts du capitalisme et même de l’impérialisme. L’histoire de la manière dont l’intelligentsia a été poussée dans cette direction est, en fin de compte, importante, non seulement en soi, mais aussi pour ce qu’elle révèle sur la gauche en général. Aujourd’hui, une grande partie de la gauche est totalement compatible.
La véritable tâche qui nous attend est donc de rajeunir la gauche réelle, qui est anti-impérialiste et anticapitaliste. Il s’agit d’une tâche gigantesque, surtout si l’on considère les forces qui s’opposent à nous. Cependant, si nous n’y parvenons pas, la vie humaine et de nombreuses autres formes de vie seront éradiquées, que ce soit par une apocalypse nucléaire, par l’intensification du meurtre social, par l’effondrement écologique ou par d’autres forces impulsées par le capitalisme.
Pour être à la hauteur des circonstances, nous devons être capables de résoudre au moins trois problèmes importants. Tout d’abord, il y a la question de la théorie, qui est le thème principal de cet ouvrage. La théorie contemporaine a été généralement purgée de tout engagement sérieux envers le matérialisme dialectique et historique, et ce dernier a été largement diffamé comme étant dépassé, dogmatique, réductionniste, peu sophistiqué, totalitaire, etc. Pire encore, le marxisme lui-même a été détourné par des forces réactionnaires, qui travaillent de concert avec des opportunistes, et transformé en un produit culturel à la mode – le marxisme « occidental » ou « culturel » – qui est anticommuniste, capitaliste accommodant et, parfois, ouvertement impérialiste, voire fasciste. Le culturalisme règne en maître, tandis que l’analyse de classe a été reléguée au second plan. De plus, ce problème ne se limite en aucun cas au domaine universitaire, car le monde de l’organisation a été profondément pénétré par ces idéologies anticommunistes. En ce sens, mon livre vise à corriger ces tendances rétrogrades, tout en renouant avec la tradition dialectique et matérialiste historique, en développant ses contributions méthodologiques et en approfondissant son analyse de la superstructure impériale dans le monde contemporain.
Les deux autres problèmes sont la question organisationnelle et ce que Brecht appelle la pédagogie de la forme. Dans une grande partie du monde capitaliste, la forme du parti, le centralisme démocratique et même les organisations politiques hiérarchiques en général ont été abandonnés ou marginalisés. Cependant, il est impossible pour la gauche de lutter et de gagner sans organisations disciplinées qui construisent un pouvoir collectif. Celles-ci doivent être capables d’attirer les gens, de les éduquer et de leur donner les moyens de prendre leur destin en main. Tout cela nécessite des formes de communication, d’expression culturelle et d’organisation qui touchent réellement les gens, par leur forme, et les motivent à participer à des actions collectives pour changer le monde. Bien que mon livre se concentre principalement sur le problème théorique, il insiste sur l’importance cruciale d’une politique de gauche organisée, tout en soulignant ses réalisations importantes sous la forme du socialisme réellement existant. J’espère également que ce livre offrira un récit convaincant et sera une lecture agréable qui incitera les gens à se joindre à la lutte collective pour construire un monde meilleur.
MY : Merci pour cette interview très instructive.
GR : Merci pour ces excellentes questions et pour tout le travail que vous accomplissez !