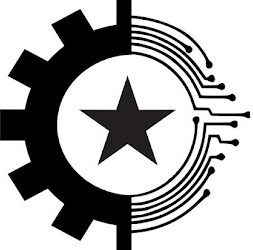Le paquet de mesures de sécurité que le gouvernement a approuvé en Conseil des ministres n’est pas simplement un ensemble de normes techniques. Il s’agit d’un message politique compact, et en partie brutal, qui véhicule une idée précise de la société : une société dans laquelle l’ordre public devient le prisme principal à travers lequel sont interprétés les conflits, les quartiers périphériques, les migrations et même l’adolescence. Un paquet divisé en deux actes, un décret-loi d’application immédiate et un projet de loi qui suivra le processus parlementaire, mais avec un objectif commun : aller encore plus loin dans le contrôle et normaliser ce qui était considéré jusqu’à hier comme exceptionnel.
La décision d’utiliser à la fois un décret et un projet de loi n’est pas neutre. Le décret sert à mettre en œuvre immédiatement les mesures les plus délicates et symboliques, celles qui affectent directement la liberté de manifestation, la gestion de l’ordre public et la construction de « l’ennemi intérieur ». Le projet de loi, quant à lui, reprend les règles qui nécessitent un travail d’ajustement politique et médiatique, les plus idéologiques ou les plus exposées au risque d’objections institutionnelles. Il s’agit d’une stratégie déjà reconnaissable : on change d’abord le climat, puis on consolide les fondations.
L’un des points centraux est le bouclier pénal, défini de manière techniquement plus prudente que dans les anticipations initiales, mais, précisément pour cette raison, potentiellement plus pénétrant. Il ne concerne pas seulement les forces de l’ordre, comme on pourrait s’y attendre dans un système classique de protection des agents, mais s’étend à tous les citoyens. Le principe est que toute personne qui commet un délit en présence d’une « cause évidente de justification » n’est pas automatiquement inscrite au registre ordinaire des personnes faisant l’objet d’une enquête, mais dans un registre séparé, avec des garanties formellement analogues, mais avec une voie préférentielle qui devrait conduire à un classement rapide, dans un délai de trente jours, sauf évaluation différente du procureur. La décision finale sur la justification continue d’incomber à un magistrat, et c’est cette clause qui est utilisée pour rassurer. Mais la question politique est autre : on construit une idée de légitimité préventive de l’usage de la force, une anticipation de confiance envers ceux qui réagissent, envers ceux qui « se défendent », envers ceux qui affirment avoir agi dans un contexte perçu comme menaçant. Dans un pays déjà traversé par une rhétorique de la peur et par un racisme social qui décide souvent qui est crédible et qui ne l’est pas, un bouclier pénal élargi risque d’avoir un effet sélectif. Il ne protège pas génériquement « les citoyens » : il protège surtout ceux qui sont déjà reconnus comme des citoyens à part entière et tend à rendre encore plus vulnérables ceux qui sont perçus comme des étrangers, des jeunes, des marginaux, des migrants.
L’autre pilier est la détention préventive, qui est incluse dans le décret dans sa version révisée à la suite des observations du président de la République. Il est important de souligner cette étape, car elle reflète la dynamique qui consiste à repousser toujours un peu plus loin les limites du possible. Le projet initial était plus agressif, plus ouvertement axé sur la suspicion. La nouvelle rédaction introduit des limites : la détention, à l’occasion de manifestations publiques, pourra durer au maximum douze heures et ne pourra concerner que des personnes ayant des antécédents spécifiques et/ou en possession d’armes ou d’objets susceptibles de causer des dommages. Il ne suffira plus, du moins formellement, de la vague idée que quelqu’un « peut » être dangereux, ni d’une tenue considérée comme un déguisement. La détention devra être communiquée sans délai au magistrat de garde, qui pourra vérifier si les conditions légales sont réunies et, dans le cas contraire, ordonner la libération immédiate. C’est la version qui tente de respecter l’article 13 de la Constitution. Mais cela reste un fait énorme : un mécanisme est introduit qui transforme la place publique en un lieu où la liberté individuelle peut être restreinte à titre préventif.
La protestation, au lieu d’être protégée comme un droit, est traitée comme un contexte exceptionnel, un territoire où la logique n’est plus « punir ceux qui commettent un délit », mais « retenir ceux qui pourraient le commettre ». C’est précisément là que la criminalisation de la dissidence devient réalité : non pas parce que manifester est formellement interdit, mais parce qu’un régime est créé dans lequel participer à une manifestation signifie accepter un risque supplémentaire, la possibilité d’être arrêté et détenu, surtout si l’on appartient à des catégories déjà considérées comme suspectes.
Le décret intervient également sur la question des contrôles policiers en introduisant un délit spécifique pour ceux qui ne s’arrêtent pas à l’ordre des forces de l’ordre et s’enfuient en mettant en danger la sécurité publique. Là encore, la mesure peut sembler raisonnable à première vue : personne ne souhaite des poursuites dangereuses ou des fuites qui mettent des vies humaines en danger. Mais dans l’architecture générale, cette règle assume une autre fonction : elle élargit le champ de la punissabilité, liée non pas tant à un préjudice effectif qu’au comportement, à la dynamique de l’interaction avec la police. Et lorsque les occasions de contrôle se multiplient, comme c’est le cas dans les zones rouges et dans la gestion sécuritaire de l’espace urbain, les situations dans lesquelles un geste, une réaction, une peur peuvent devenir un délit se multiplient également.
Les zones rouges redeviennent en effet un instrument central. Leur création est prévue dans les zones considérées comme les plus à risque, telles que les gares, dans le but déclaré de prévenir la dégradation et la délinquance. Mais la logique réelle est celle de la sélection : établir qu’il existe des endroits dans la ville où la simple présence devient un problème, où certaines personnes sont tolérées et d’autres non. Les zones rouges ne résolvent pas le malaise, ne guérissent pas les causes de la marginalisation, ne réduisent pas la violence sociale. Elles la déplacent, la cachent, la répriment. Et surtout, elles produisent un effet culturel : elles normalisent l’idée que la ville peut être parcourue différemment selon qui vous êtes, comment vous vous habillez, quel âge vous avez, quel visage vous avez, quel accent vous avez.
Ce système englobe également l’obsession contemporaine pour l’« urgence mineurs », que le gouvernement utilise comme argument clé pour légitimer une politique punitive. La norme introduit une interdiction plus claire de la vente aux mineurs de moins de dix-huit ans de couteaux et d’objets susceptibles de causer des dommages, et prévoit des sanctions administratives pouvant aller jusqu’à douze mille euros pour les vendeurs, y compris en ligne, avec la possibilité de suspension ou de révocation de la licence. Mais cela ne s’arrête pas là. Elle introduit la possibilité d’une arrestation en flagrant délit et de l’adoption de mesures préventives également pour les mineurs trouvés en possession de couteaux. Et surtout, elle prévoit des sanctions administratives « collatérales » très sévères : un mineur surpris avec un couteau dans sa poche pourra se voir suspendre son permis de conduire ou son passeport et, dans le cas des étrangers, même son permis de séjour. Il s’agit là d’une mesure très grave, car elle crée un droit différentiel : un même comportement produit des conséquences différentes en fonction de la situation juridique. Et lorsque le permis de séjour devient une arme de sanction, la sécurité n’est plus une question pénale : elle devient un mécanisme de discipline sociale et d’exclusion.
C’est là que le label « maranza » (1), évoqué comme s’il s’agissait d’un phénomène naturel, révèle sa fonction politique. Il ne décrit pas : il désigne. Il n’analyse pas : il marque. Et marquer signifie produire une classe dangereuse. Le jeune, surtout s’il est périphérique et souvent s’il est migrant ou fils de migrants, est traité comme un sujet à neutraliser plutôt qu’à comprendre. Au lieu de s’attaquer à la crise de l’éducation, à la pauvreté, au décrochage scolaire, à la ségrégation urbaine, la politique choisit le raccourci du code pénal. C’est plus simple, plus communicable, plus vendable à la télévision. Et c’est aussi plus dévastateur.
Le projet de loi maintient également des mesures visant à « responsabiliser les parents » des mineurs impliqués dans des actes délictueux. La formule semble raisonnable, presque morale. En réalité, il s’agit d’une construction classiste et punitive : cela signifie transférer la culpabilité, transformer la déviance en un fait familial, punir financièrement ceux qui sont souvent déjà fragiles. C’est la même logique qui traverse l’ensemble du paquet : ne pas traiter les causes, mais punir les symptômes, et le faire de la manière la plus visible possible.
Parallèlement, le paquet intervient dans le domaine de l’immigration avec une double stratégie. Le décret comprend des règles visant à accélérer et à rendre plus exécutoires les expulsions d’immigrants en situation irrégulière, en particulier ceux qui ne respectent pas l’ordre de quitter le pays dans un délai de sept jours contenu dans la fiche d’expulsion. À la deuxième infraction, les chefs de police pourront procéder directement au rapatriement. Cette mesure est présentée comme une mesure d’efficacité administrative, mais en réalité, elle augmente le pouvoir discrétionnaire et réduit le champ des garanties. Lorsque le rapatriement devient un automatisme accéléré, on court le risque que la personne disparaisse du champ des droits et soit traitée comme un objet logistique.
En revanche, le projet de loi maintient les règles qui restreignent le regroupement familial et celles qui reprennent, sous une forme juridique plus élaborée, l’obsession du blocus naval. En effet, il prévoit la possibilité d’interdire le franchissement des eaux territoriales pendant des périodes de trente jours à six mois en cas de menaces à l’ordre public ou à la sécurité nationale. Il s’agit d’une règle délibérément élastique, fondée sur des concepts vagues tels que « menace » et « ordre public », qui peuvent être élargis en fonction du climat politique et médiatique du moment. Et c’est précisément ce flou qui rend la mesure dangereuse : non pas parce qu’elle sera utilisée quotidiennement, mais parce qu’elle peut être utilisée quand cela convient et parce que, entre-temps, l’horizon change. La migration est définitivement traitée comme une question de défense, et non de droits, et la mer comme une frontière militaire, et non comme un espace de sauvetage.
Des mesures sur les flux migratoires avec des retours forcés devraient également être incluses, mesure sur laquelle le Quirinal aurait exprimé ses réserves. Et ce détail, apparemment technique, est politiquement révélateur. Le Quirinal intervient rarement de manière explicite, et lorsqu’il le fait, cela signifie que le seuil de compatibilité constitutionnelle a été trop dépassé. Mais la dynamique est déjà éprouvée : une version extrême est proposée, des critiques sont formulées, les corrections nécessaires sont apportées pour qu’elle soit approuvée et, au final, le système qui en résulte est plus dur que le précédent. C’est la politique comme avancée progressive de l’exception.
Parmi toutes ces mesures, on trouve également le durcissement des peines pour certains délits contre le patrimoine, tels que les cambriolages, avec l’augmentation des peines minimales et maximales. Dans ce cas également, le message est simple : plus de prison, plus de sévérité. Mais l’effet réel est discutable, car l’histoire de la justice pénale montre que le durcissement des peines ne réduit pas automatiquement la criminalité.
Il sert plutôt à renforcer l’image d’un gouvernement « dur », à donner une impression de contrôle. Et pendant ce temps, on continue à surcharger un système pénitentiaire déjà en crise, tandis que la véritable criminalité, celle qui est économique, organisée, celle qui dévore les ressources publiques et les droits, reste généralement en marge du discours sécuritaire.
Au final, ce qui émerge est un projet cohérent. La dissidence est traitée comme un problème d’ordre public, la marginalité comme un risque, la jeunesse comme une alarme, la migration comme une menace. Et sur cette base, on construit un système dans lequel la police dispose de plus d’outils, d’une plus grande marge de manœuvre, de plus de possibilités d’intervention préventive, tandis que le citoyen – en particulier celui qui ne correspond pas aux canons du citoyen « correct » – a moins d’espace, moins de protections, moins de présomption d’innocence sociale.
Cependant, le plus inquiétant n’est pas la norme en soi, mais le climat que ces normes produisent et consolident. Car un pays ne devient pas autoritaire uniquement lorsqu’il interdit formellement la protestation ou lorsqu’il suspend ouvertement la Constitution. Il devient autoritaire lorsqu’il s’habitue à l’idée que la liberté est conditionnée, que l’exception est normale, que certaines personnes sont suspectes par nature, que la force est plus crédible que le droit. Et lorsque l’on s’y habitue, la prochaine étape ne choque plus.
Ce train de mesures sécuritaires ne promet pas vraiment plus de sécurité. Il promet quelque chose de plus précis et de plus inquiétant : la fermeture progressive des espaces de liberté politique et sociale. Il ne s’agit pas d’une simple extension des pouvoirs de contrôle, mais d’une tentative de redessiner le périmètre de ce qu’il est légitime de faire, de dire, de traverser, de répondre. C’est la transformation de la place, de la rue, de la périphérie et même de l’adolescence en territoires suspects, où la liberté n’est plus un droit à part entière, mais une concession révocable.
Et surtout, ce système construit et consolide de nouvelles « classes dangereuses », comme cela se faisait dans les pires moments de l’histoire européenne : les jeunes, les pauvres, les migrants, les enfants des banlieues, des figures sociales traitées non pas comme des citoyens, mais comme des présences qu’il faut discipliner. La dissidence est réécrite comme une perturbation, la marginalité comme une menace, la différence comme un risque. C’est un retour à la logique de l’Ancien Régime, où l’ordre ne coïncide pas avec la justice mais avec la hiérarchie, et où l’État ne garantit pas les droits : il sélectionne les corps, contrôle les territoires, punit les identités.
La question n’est donc pas seulement que « le contrôle fait rarement marche arrière ». La question est que, une fois cette culture politique normalisée, ce qui ne fait pas marche arrière, c’est le seuil même de la démocratie. Car lorsque l’État s’habitue à gouverner par la peur et la répression préventive, il ne protège pas la société : il lui apprend à respirer dans un espace plus restreint.
(1) Maranza est un terme couramment utilisé de manière générique pour désigner un jeune de deuxième génération, presque toujours un homme, souvent né en Italie et d’origine nord-africaine ou nord-africain émigré en Italie, bruyant et s’exprimant généralement dans un langage vulgaire et avec des attitudes de rue, également identifiable par sa tenue vestimentaire. Cette définition a coïncidé avec la diffusion et la circulation du terme dans les médias, avec une connotation négative, intolérante et préjugée.